OTAGES FRANCAIS : informations et actions de sensibilisation
-
 LIBRES ! OTAGES NIGER - AREVA/VINCI - CAPTURES EN SEPTEMBRE 2010
LIBRES ! OTAGES NIGER - AREVA/VINCI - CAPTURES EN SEPTEMBRE 2010
 LIBRES ! OTAGES NIGER - AREVA/VINCI - CAPTURES EN SEPTEMBRE 2010
LIBRES ! OTAGES NIGER - AREVA/VINCI - CAPTURES EN SEPTEMBRE 2010
-
 5 MARS 2011 - AURAY - MOBILISATION POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN ET AU NIGER
5 MARS 2011 - AURAY - MOBILISATION POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN ET AU NIGER
 5 MARS 2011 - AURAY - MOBILISATION POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN ET AU NIGER
5 MARS 2011 - AURAY - MOBILISATION POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN ET AU NIGER
- - AURAY - 5 MARS 2011 - REVUE DE PRESSE COMPLETE DE L’EVENEMENT
- - 5 MARS 2011 - Concert pour les otages
- - 5 MARS 2011 - Conférence pour les otages
- - 5 MARS 2011 - JOURNEE DE MOBILISATION A AURAY : LE REPORTAGE DU JT DE FRANCE 3 BRETAGNE
- - 5 MARS 2011 - MOBILISATION BRETONNE : Auray se mobilise aujourd’hui pour les otages d’Afghanistan ( OUEST-FRANCE)
- - 5 mars 2011 - MOBILISATION POUR LES OTAGES : A Auray : « La médiatisation est indispensable »
- - 5 MARS 2011 - (AURAY 56 Bretagne) JOURNEE DE MOBILISATION POUR LES OTAGES
- - 16 SEPTEMBRE 2012 - Pose d’une banderole à VELAUX pour les otages du Sahel
- - 9 novembre 2013 - RETOUR AU PAYS DE MARC FERRET - VELAUX
- - LIBERATION OTAGES D’ARLIT - 2 NOVEMBRE 2013 - RASSEMBLEMENT PLACE ROYALE NANTES - PHOTOS ET VIDEOS
- - 2 NOVEMBRE 2013 - OTAGES : l’émission "Les dossiers de Téva" sur les familles d’otages
- - Otages Arlit : "Il faut leur donner le temps de se remettre", dit le père de Thierry Dol
- - 5 octobre 2013 - OTAGES NIGER : Nantes : rassemblement de soutien aux otages enlevés au Niger
- - 5 octobre 2013 - Otages d’Arlit : leurs proches envisagent « des actions tous azimuts
- - OTAGES AU SAHEL : "Le temps de la mobilisation générale"
- - 22 septembre 2013 - OTAGES NIGER : Otages français au Sahel : Le Drian réaffirme la mobilisation de l’Etat
- - 21 septembre 2013 - OTAGES NIGER : Ingrid Betancourt et les otages français : « la mobilisation n’est pas suffisante ! »
- - 21 septembre 2013 - OTAGES NIGER : A Nantes, tous avec les otages
- - 21 septembre 2013 - OTAGES NIGER : une centaine de personnes à Meudon pour soutenir les otages
- - "Ça Vous Regarde" sur LCP : : le débat : Otages : François Hollande les a-t-il oubliés ?
- - 19 septembre 2013 - OTAGES SAHEL : Otages : la France doit-elle négocier avec Aqmi ? (JDD/LCP sondage et émission TV)
- - 18 SEPTEMBRE 2013 - OTAGES SAHEL : Les otages du Niger s’affichent sur une mairie parisienne
- - 18 septembre 2013 - OTAGES SAHEL : La famille de Thierry Dol a été reçue ce mercredi au Quai d’Orsay
- - 17 septembre 2013 - Une nouvelle preuve de vie des otages français
- - 21 SEPTEMBRE 2013 - UN RASSEMBLEMENT POUR LES OTAGES A MEUDON
- - 16 septembre 2013 - OTAGES NIGER : Rencontre avec Pascale, la maman de Pierre Legrand
- - 21 septembre 2013 - OTAGES NIGER : Table ronde avec Otages du monde samedi à Nantes (Ouest-France)
- - 16 septembre 2013 - OTAGES NIGER : Emission Décryptage sur Martinique 1ère de ce 16 septembre - Invité : Jean-Louis NORMANDIN
- - 16 septembre 2013 - OTAGES NIGER ; Une nouvelle vidéo des otages au Sahel
- - 5 septembre 2013 - Otages Sahel : "Trois ans après, ça suffit"
- - 21 septembre 2013 - OTAGES SAHEL : 3 ANS DEJA ! LE PROGRAMME DE LA JOURNEE DE MOBILISATION NANTAISE
- - 7 septembre 2013 - OTAGES NIGER - Rassemblement à Nantes, entre 100 et 150 personnes place Royale
- - 22 août 2013 _ OTAGES NIGER : Pascale Robert, la mère de Pierre Legrand, l’otage français retenu au Mali.
- - 3 août 2013 - OTAGES NIGER : nouveau rassemblement place Royale à Nantes
- - 27 juillet 2013 - Otages du Niger : une lettre porteuse d’espoir (Ouest-France)
- - 25 juillet 2013 - OTAGES NIGER : UNE PREUVE DE VIE DES 4 OTAGES (Libération)
- - Otages au Niger : la vie malgré l’attente ( magazine ELLE)
- - 22 juin 2013 - OTAGES SAHEL : RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT POUR LES 1 000 JOURS DE DETENTION DES 4 OTAGES D’ARLIT
- - 7 juillet 2013 - OTAGES NIGER : François Hollande annonce un nouveau dispositif centralisé pour la gestion des otages d’Arlit (RFI)
- - 6 juillet 2013 - OTAGES SAHEL : Nouveau rassemblement pour les otages du Niger à Nantes
- - 22 juin 2013 - SOUTIEN OTAGES DU SAHEL (Article MIDI-LIBRE)
- - 22 juin 2013 - OTAGES SAHEL : Manif’ pour les otages au Niger : "Il en est fini du silence" (LA PROVENCE)
- - 22 juin 2012 - OTAGES SAHEL : 1000 jours - PHOTOS DES MANIFESTATIONS EN FRANCE
- - 22 juin 2013 - OTAGES SAHEL : 1000 jours - Mobilisation pour les otages au Sahel
- - Otages au Niger : le rassemblement de soutien forme un chiffre « 1 000 » à Nantes
- - 20 juin 2013 - OTAGES NIGER : Otages du Niger : selon le Nouvel Obs, Ils seraient en Algérie !
- - 11 juin 2013 - Communiqué de presse de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale le mercredi 12 juin 2013 : Otages français enlevés au Niger il y a 1000 jours
- - 22 juin 2013 _ OTAGES SAHEL : soutien pour les 1000 jours de captivité
- - 1er juin 2013 - OTAGES SAHEL : Otages enlevés au Niger : la cap des 1.000 jours approche
- - 7 mai 2013 - OTAGES SAHEL : les familles des otages sortent de l’ombre
- - 4 mai 2013 - OTAGES SAHEL : Rassemblement mensuel de soutien à Nantes
- - 25 avril 2013 - OTAGES SAHEL :
- - 16 mars 2013 - OTAGES SAHEL : "900 jours, ça suffit"
- - OTAGES SAHEL - 900 JOURS DE CAPTIVITE - MOBILISATION 16 mars 2013
- - 8 février 13 - Otages au Sahel - Alain Legrand : « La vie de mon fils n’a pas de prix ! »
- - 3 janvier 2013 - OTAGES SAHEL : Les otages enlevés au Niger sont vivants, selon Fabius
- - 19 novembre 2012 - OTAGES DU MONDE : Ingrid Betancourt s’engage pour les otages et devient la marraine de l’association pour la libération des Otages d’Arlit
- - 13 octobre 2012 - OTAGES SAHEL : Les islamistes maliens menacent des otages français (Le Figaro)
- - 15 septembre 2012 - OTAGES SAHEL : Les familles des otages du Sahel dénoncent la rumeur du versement d’une rançon de 90 millions d’euros ( FRANCE 3 Pays de Loire)
- - 15 septembre 2012 - OTAGES SAHEL : rassemblement de soutien à Meudon - 2 ans de captivité
- - 5 septembre 2012 - OTAGES AU SAHEL : l’épouse de Daniel LARRIBE témoigne (REFORME)
- - 2 septembre 2012 -OTAGES SAHEL : Françoise Larribe sur RTL : "Deux ans, ça devient insupportable"
- - 29 août 2012 - OTAGES DU SAHEL : outils de communication pour mobilisation du 15 septembre 2012, à MEUDON
- - 16 août 2012 - OTAGES SAHEL : OTAGES DU SAHEL : TEMOIGNAGE Europe 1 - Deux des otages enlevés au Sahel racontent, pour ceux qui restent détenus ( EUROPE 1)
- - 16 août 2012 -700 jours de captivité pour les otages d’Arlit (NIGER) (reportage France 3 pays de la Loire)
- - 16 août 2012 - OTAGES SAHEL : "Qu’est-ce qui bloque ?", demande la mère de Pierre Legrand (LE POINT/NOUVEL OBS/AFP)
- - 16 août 2012 - OTAGES SAHEL : LA SOEUR DE MARC FERRET PREND LA PAROLE (RMC)
- - 16 août 2012 - OTAGES SAHEL : LES PARENTS DE PIERRE LEGRAND PRENNENT LA PAROLE DANS LES MEDIAS
- - 16 août 2012 - OTAGES SAHEL : LES PROCHES DE PIERRE LEGRAND SORTENT DU SILENCE ( I TELE)
- - 14 août 2012 - OTAGES SAHEL : 700 jours de détention pour les quatre otages français
- - 8 juin 2011 - OTAGES SAHEL : Les otages français au Sahel "vivants" et "en bonne santé" (LE POINT.FR)
- - 6 février 2012 - OTAGES NIGER : Les otages d’Areva retenus depuis 18 mois déjà
- - 29 janvier 2012 - 500 jours de captivité - Communiqué des familles Otages au Sahel
- - 29 janvier 2012 - OTAGES NIGER : Martinique : 500 jours de captivité pour Thierry Dol et ses co-détenus
- - 12 décembre 2011 - OTAGES SAHEL : Paris garde tous les "canaux ouverts"
- - 8 décembre 2011 - OTAGES SAHEL : Burkina : des "contacts" pour la libération des otages au Sahel
- - 30 novembre 2011 - OTAGES SAHEL : les familles des otages inquiètes
- - 20 octobre 2011 - 400 jours : René Robert, le grand-père de l’un des otages, Pierre Legrand
- - 20 octobre 11 - 400 jours de captivité pour les 4 otages français au Sahel
- - 3 OCTOBRE 2011 - OTAGES NIGER : Le Niger dispose d’informations "rassurantes" sur les otages français
- - 16 septembre 2011 - OTAGES FRANCAIS AU SAHEL : point presse du quai d’Orsay
- - 16 septembre 2011 - OTAGES NIGER : Il y a un an, 7 otages étaient enlevés. 2 des 3 libérés racontent leur détention
- - 16 septembre 2011 - Quatre Français aux mains d’Aqmi depuis un an ( OUEST- FRANCE)
- - 16 septembre 2011 - OTAGES NIGER : UN AN DE CAPTIVITE : communiqué des familles des 4 otages
- - 28 août 2011 - OTAGES SAHEL : Les quatre Français otages au Niger "se portent bien"
- - 2 août 2011 - OTAGES FRANCAIS : ZOOM DE LA REDACTION DE FRANCE INTER
- - 13 JUILLET 2011 - OTAGES SAHEL : 300 JOURS DE CAPTIVITE- Un message des familles des 4 otages français
- - 18 MAI 2011 - OTAGES SAHEL : Soumeylou Boubeye Maiga, ministre malien des Affaires étrangères s’exprime sur sur FRANCE 24
- - 8 mai 2011 - OTAGES SAHEL : la France redoute toujours Al Quaïda (JDD)
- - 4 mai 2011 - OTAGES SAHEL : Sécurité dans le Sahel : deux députés français en mission dans la région
- - 3 MAI 2011 - OTAGES FRANCAIS DANS LE MONDE : INFLUENCE DE LA MORT DE BEN LADEN SUR LES NEGOCIATIONS POUR LA LIBERATION DES OTAGES FRANCAIS ?
- - 27 avril 2011 - OTAGES NIGER : une video des 4 otages français
- - 22 avril 2011 - OTAGES SAHEL : Aqmi veut « aussi et surtout » que la France se retire d’Afghanistan (article 20 minutes)
- - 9 AVRIL 2011 - OTAGES NIGER : 200 JOURS DE CAPTIVITE POUR LES OTAGES D’ARLIT - Journée de mobilisation à COUFFE (44)
- - 21 mars 2011 - OTAGES NIGER : Selon l’AFP, Aqmi exigerait "au moins 90 millions d’euros" de rançon
- - 10 mars 2011 - OTAGES NIGER : mobilisation dans la commune de Pierre Legrand
- - 9 AVRIL 2011 - OTAGES SAHEL : 200 JOURS - Communiqué de la famille de Pierre LEGRAND
- - 25 février 2011 - OTAGES NIGER : OTAGES NIGER : Le togolais Alex Kodjo Ahonado libre
- - 11 février 2011 - OTAGES NIGER : Une marche pour Thierry DOL, otage français au Sahel, dans sa région natale, la Martinique
- - 6 janvier 2011 - OTAGES MALI/NIGER : Attentat devant l’ambassade du Mali - Un suspect arrêté déclare appartenir au groupe d’AQMI ayant enlevé les 5 français
- - 29 DECEMBRE 2010 - RASSEMBLEMENT POUR HERVE ET STEPHANE A PARIS : un message des familles des otages d’Arlit
- - 25 décembre 2010 - Otages Sahel : interview M.ROBERT, grand-père de Pierre LEGRAND
- - 24 décembre 2010 - OTAGES SAHEL : Un appel des familles des otages pour les 100 jours de captivité
- - 18 novembre 2010 - OTAGES SAHEL : La France sommée de négocier avec Ben Laden
- - 1er OCTOBRE 2010 - OTAGES NIGER : Interview jean-Louis Normandin, LE PARISIEN : "Les ravisseurs veulent montrer qu’ils sont les plus forts".
- - 1er OCTOBRE 2010 - OTAGES NIGER : Nicolas Sarkozy reçoit les familles des otages français du Niger
- - 1er OCTOBRE 2010 - OTAGES SAHEL : la présidente d’Areva arrive à Arlit sous très haute sécurité (RFI)
- - 1 er OCTOBRE 2010 - OTAGES NIGER : que nous apporte la photo des otages ? (Lu sur 20 Minutes)
- - 1 octobre 2010 - OTAGES NIGER/MALI : UNE PREMIERE VIDEO DES OTAGES DIFFUSEE PAR AQMI
- - 28 septembre 2010 - OTAGES SAHEL : : premier contact avec les ravisseurs
- - 22 SEPTEMBRE 2010 - OTAGES NIGER : Hortefeux se rend au Mali pour faire le point
- - 21 septembre 2010 - OTAGES NIGER : L’Aqmi revendique l’enlèvement de Français au Niger
- - 19 SEPTEMBRE 2010 - OTAGE NIGER : Saint-Céré : « Daniel est un type bien »
- - 19 septembre - OTAGE NIGER : Thierry Dole, 28 ans, se sentait menacé
- - 16 septembre 2010 : les otages Français enlevés à leur domicile
-
-
 ACTIONS POUR TOUS LES OTAGES
ACTIONS POUR TOUS LES OTAGES
 ACTIONS POUR TOUS LES OTAGES
ACTIONS POUR TOUS LES OTAGES
- - 1er décembre 2014 - EVENEMENT EN BRETAGNE- CONFERENCE OTAGES A QUIMPERLE au FESTIVAL"PASSEURS DE LUMIERE" (Finistère)
- - 13 octobre 2014 - otages du monde soutient : Concert – La musique plus forte que la haine (mouvement pour la paix)
- - 31 dec 2013 - sur RFI, Messages personnels de soutien aux otages français détenus dans le monde
- - 31 décembre 2013 - SUR RFI, UNE EMISSION SPECIALE "OTAGES FRANCAIS DANS LE MONDE"
- - 15 septembre 2013 - SOUTIEN OTAGES FRANCAIS : Florence Aubenas et Pascale Robert, mère de Pierre Legrand, sensibilisent le public de la fête de l’Humanité
- - 12 JANVIER 2013 - OTAGES SAHEL : Intervention au Mali : l’inquiétude des familles des otages
- - 7 DECEMBRE 2012 - SOLIDARITE OTAGES : conférence de presse à la mairie de Paris
- - 3 décembre 2012 - OTAGES SAHEL : Aqmi menace la France de représailles en cas de guerre au Mali (AFP)
- - 21 novembre 2012 - HAY LES ROSES : Journée des droits de l’enfant - Hervé Guesquière , grand-reporter, rencontre les enfants ayant participé à l’opération "Un dessin pour les otages"
- - 2 décembre 2012 - UNE EQUIPE COURT POUR LES OTAGES A LA SAINTELYON (69)
-
 LIBRE ! OTAGE NIGERIA - Francis Collomp
LIBRE ! OTAGE NIGERIA - Francis Collomp
 LIBRE ! OTAGE NIGERIA - Francis Collomp
LIBRE ! OTAGE NIGERIA - Francis Collomp
- - Tuesday 19 November 2013 -French hostage Francis Collomp home from Nigeria
- - 19 novembre 2013 - OTAGE NIGERIA - L’ex-otage Francis Collomp, seul avec un geôlier lors de son évasion ( PARIS NORMANDIE) Analyse de MARC ANTOINE PEROUSE DE MONTCLOS, chercheur à l’Institut de recherche pour le développement
- - 17 NOV 2013 - OTAGE NIGERIA - L’otage français Francis Collomp, enlevé au Nigeria, s’est évadé
- - 17 novembre 2013 - OTAGES NIGERIA : Evasion de Francis Collomp : « pas de dynamique de libération d’otages »
- - 10 octobre 2013 -Otages en Nigéria : "Le quai d’Orsay me passe la pommade", regrette la femme de Francis Collomp
- - 9 octobre 2013 - OTAGE NIGERIA : Document BFMTV - L’épouse de l’otage français au Nigeria Francis Collomp confie sa colère
- - OTAGE NIGERIA - OCTOBRE 2013 - 10 mois de mobilisation pour Francis Collomp
- - 27 septembre 2013 - OTAGE NIGERIA : publication d’une video Preuve de vie sur le net
- - 27 septembre 2013 _ OTAGE NIGERIA : Ansaru diffuse une vidéo de l’otage Francis Collomp
- - 15 septembre 2013 - OTAGE NIGERIA : UN PIQUE NIQUE SOLIDAIRE A L’ILE DE LA REUNION
- - 15 septembre 2013 - OTAGE NIGERIA : Un pique-nique pour la libération de l’ingénieur français, enlevé au Nigéria
- - 28 août 2013 - OTAGE FRANCAIS AU NIGERIA : Francis Collomp privé de retraite complémentaire faute d’un "certificat de vie"
- - 26 août 2013 - OTAGE NIGERIA : OTAGE NIGERIA : 250 jours de captivité pour l’otage Francis Collomp
- - 21 AOÜT 2013 6 OTAGE NIGERIA - 245 jours de captivité pour Francis Collomp
- - 5 août 2013 - OTAGE NIGERIA : Nouvelle mobilisation pour Francis Collomp (Journal de la Réunion)
- - 23 mai 2013 - OTAGE NIGERIA : La famille de Francis Collomp est "rassurée" sur le sort de l’otage, après une entrevue avec Laurent Fabius
- - 12 MARS 2013 - OTAGES NIGERIA : La femme de Francis Collomp évoque une nouvelle preuve de vie
- - 11 mars 2013 OTAGE NIGERIA : L’otage français Francis Collomp au Nigeria est vivant
- - 25 février 2013 - OTAGE NIGERIA : Didier Le Bret doit recevoir A-M Collomp
- - 20 décembre 2012 - OTAGE NIGERIA - un français enlevé dans le Nord du Nigéria
-
 LIBRE ! Georges Vandenbeusch, prêtre enlevé au Cameroun, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013
LIBRE ! Georges Vandenbeusch, prêtre enlevé au Cameroun, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013
 LIBRE ! Georges Vandenbeusch, prêtre enlevé au Cameroun, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013
LIBRE ! Georges Vandenbeusch, prêtre enlevé au Cameroun, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2013
- - 9 octobre 2014 - OTAGES CAMEROUN/NIGERIA - Un otage de Boko Haram
- - 26 mars 2014 - NIGERIA : Témoignage du Père Georges Vandenbeusch, ex-otage de Boko Haram
- - 1er janvier 2014 - OTAGES NIGERIA : "J’étais sous un arbre pendant un mois et demi" raconte l’ex-otage français"
- - 1er janvier 2014 - OTAGE NIGERIA : Père Georges : "ces jours m’ont paru terriblement longs"
- - 1er janvier 2014 - OTAGE NIGERIA - Père Georges Vandenbeusch : "Ces jours m’ont paru terriblement longs"
- - 31 DECEMBRE 2013 - OTAGE CAMEROUN : le prêtre français libéré arrivé à Yaoundé souriant et "en bonne santé"
- - 31 décembre 2013 - OTAGES CAMEROUN : libération du prêtre français Georges Vandenbeusch, enlevé dans le nord du pays
- - 25 décembre 2013 - OTAGE CAMEROUN/NIGERIA : des « nouvelles rassurantes » du père Georges
- - 25 décembre 2013 - Otages français : des « nouvelles rassurantes » du père Georges Vandenbeusch
- - Soutien au père Georges Vandenbeusch a été enlevé dans la nuit du 13 au 14 novembre au Nord du Cameroun.
- - 15 novembre 2013 - OTAGE CAMEROUN/NIGERIA - Enlevé au Cameroun, le père Vandenbeusch est probablement détenu au Nigeria
-
 LIBRE ! Serge LAZAREVIC, enlevé au Mali, depuis le 24 novembre 2011
LIBRE ! Serge LAZAREVIC, enlevé au Mali, depuis le 24 novembre 2011
 LIBRE ! Serge LAZAREVIC, enlevé au Mali, depuis le 24 novembre 2011
LIBRE ! Serge LAZAREVIC, enlevé au Mali, depuis le 24 novembre 2011
- - 13/12/2014 - Serge Lazarevic : "Je n’étais plus un être humain" (France 2)
- - 10 décembre 2014 - OTAGE SAHEL : Exclusif RFI : Un ex-otage d’Arlit commente la libération de Lazarevic
- - 10 décembre 2014 - OTAGE SAHEL - Serge Lazarevic libre : Mohamed Akotey, le négociateur touareg devenu indispensable
- - 10 décembre 2014 -VIDEO FRANCE 2. « Je suis heureux d’être libre, juste libre », dit Serge Lazarevic
- - 9 décembre 2014 - OTAGE SAHEL : Immense soulagement après la libération de Serge Lazarevic
- - LIBRE ! 23 novembre 2014 - OTAGES NIGER : Le président nigérien « optimiste » sur la libération de l’otage français Lazarevic
- - 18 novembre 2014 - Vidéo de Serge Lazarevic : "C’est la preuve de vie qu’on attendait" - Interview de Patricia Philibert, Secrétaire Générale d’Otages du Monde
- - 22 novembre 2013 - DEUX ANS DEJA ! — CONFERENCE DE PRESSE A PARIS - REVUE DE PRESSE
- - 24 novembre 2013 - OTAGES MALI : 2 ANS DEJA !
- - 29 octobre 2013 - OTAGES MALI : Le cri de colère du comité de soutien de Serge Lazarevic
- - OTAGE NIGER : 19 juin 2013 - Diane LAZAREVIC, fille de SERGE LAZAREVIC , otage au Niger, adresse un message à son père par le canal de RFI
- - 4 janvier 2013 _ OTAGES SAHEL : Fabius poursuit ses rencontres avec les familles des otages
- - 24 novembre 2012 - 1 an de captivité pour les 2 otages au Mali : rassemblement des familles devant l’hôtel de ville de Paris
- - 22 novembre 2012 - OTAGES SAHEL : COMMUNIQUE OTAGES DU MONDE ET COMITE DE SOUTIEN PHILIPPE VERDON ET SERGE LAZAREVIC
-
 LIBRES ! - Libérés le 19 avril 2014 - JOURNALISTES DISPARUS SYRIE : Didier FRANCOIS et EDOUARD ELIAS - le 6 juin 2013 et NICOLAS HENIN et PIERRE TORRES, enlevés le 22 juin 2013
LIBRES ! - Libérés le 19 avril 2014 - JOURNALISTES DISPARUS SYRIE : Didier FRANCOIS et EDOUARD ELIAS - le 6 juin 2013 et NICOLAS HENIN et PIERRE TORRES, enlevés le 22 juin 2013
 LIBRES ! - Libérés le 19 avril 2014 - JOURNALISTES DISPARUS SYRIE : Didier FRANCOIS et EDOUARD ELIAS - le 6 juin 2013 et NICOLAS HENIN et PIERRE TORRES, enlevés le 22 juin 2013
LIBRES ! - Libérés le 19 avril 2014 - JOURNALISTES DISPARUS SYRIE : Didier FRANCOIS et EDOUARD ELIAS - le 6 juin 2013 et NICOLAS HENIN et PIERRE TORRES, enlevés le 22 juin 2013
-
 Didier François et Edouard Elias, enlevés le 6 juin 2013
Didier François et Edouard Elias, enlevés le 6 juin 2013
 Didier François et Edouard Elias, enlevés le 6 juin 2013
Didier François et Edouard Elias, enlevés le 6 juin 2013
-
 Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
 Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
- - 7 AVRIL 2014 - OTAGES EN SYRIE : UNE CONFERENCE AU HAVRE
- - 26 mars 2014 - Otage en Syrie, le Rouennais Pierre Torres serait "bien traité"
- - 6 janvier 2014 - Soutien aux otages en Syrie : la famille de Pierre Torres témoigne
- - 9 octobre 2013 - OTAGES SYRIE / Syrie : le nouveau marché des otages ( I TELE)
- - 5 janvier 2014 - OTAGES SYRIE : Otages français en Syrie : "La situation parait particulièrement bloquée", dit le père de Nicolas Hénin (Souce RTL)
- - 6 septembre 2013 - OTAGES SYRIE : Syrie : Didier François et Edouard Elias, otages depuis 3 mois
- - 6 septembre 2013 - OTAGES SYRIE : OTAGES SYRIE : A Lille, une banderole pour les journalistes enlevés en Syrie
- - OTAGES SYRIE - 6 septembre 2013 :Rassemblement de solidarité sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour
- - 14 juillet 2013 - OTAGES SYRIE : Les deux journalistes français enlevés en Syrie sont vivants
- - UNE PETITION POUR LA LIBERATION DE DIDIER FRANCOIS ET EDOUARD ELIAS
- - 9 juillet 2013 - JOURNALISTES DISPARUS EN SYRIE : Mobilisation pour les journalistes français disparus en Syrie
-
-
 Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
 Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
Nicolas Hénin et Pierre Torrès, enlevés le 22 juin 2013
- - 7 AVRIL 2014 - UNE CONFERENCE SUR LES OTAGES EN SYRIE A SCIENCES PO LE HAVRE, AVEC LES PARENTS DE PIERRE TORRES
- - 5 Janvier 2014 - Otages français en Syrie : "La situation parait particulièrement bloquée", dit le père de Nicolas Hénin
- - 6 février 2014 (video) Otages en Syrie : les parents de Pierre Torrès veulent garder espoir
- - OTAGES SYRIE : une conférence le 6 février à Rouen
- - 10 octobre 2013 - OTAGES SYRIE : Le Haut-Normand Pierre Torrès otage en Syrie (article PARIS NORMANDIE)
- - 9 octobre 2013 - OTAGES SYRIE : Deux journalistes français enlevés en Syrie - Interview de Jean-Louis NORMANDIN
- - 10octobre 2013 - OTAGES SYRIE : Le Haut-Normand Pierre Torrès otage en Syrie
- - 9 octobre 2013 - OTAGES SYRIE : "Nous trouvons le temps très long", confie le père de Nicolas Hénin
- - 25 avr. 2014 - Ex-otages en Syrie - Nicolas Hénin et Pierre Torrès : Retour à la liberté - Tv5 monde -
- - 20 avril 2014 : LES 4 JOURNALISTES FRANCAIS OTAGES EN SYRIE LIBRES
- - 20 avril 2014 - RETOUR DE CAPTIVITE DES OTAGES EN SYRIE : INTERVIEW EXCLUSIVE DE NICOLAS HENIN POUR ARTE
- - 12 avril 2014 - OTAGES EN SYRIE : Les portraits des otages décrochés de la mairie de Palaiseau
- - 7 avril 2014 - OTAGES EN SYRIE - "ZONE INTERDITE", Une conférence à l’ univesité Paris-Dauphine
- - 5 avril 2014 - SOUTIEN AUX OTAGES EN SYRIE : WE DE MOBILISATION POUR LES 4 JOURNALISTES
- -
 1er AVRIL 2014 : 300 jours de captivité pour Didier François et Edouard Elias
1er AVRIL 2014 : 300 jours de captivité pour Didier François et Edouard Elias - - 15 mars 2014 - OTAGES SYRIE : Un tournoi de foot pour soutenir les otages
- - 6 mars 2014 - EUROPE 1 : 9 mois de captivité pour les 4 otages en Syrie : Hervé Ghesquière, invité de Nicolas Poincaré, dans Europe Soir
- - 6 mars 2014 :Otages en Syrie : Une banderole posée devant l’Université Paris-Dauphine (Reportage M6)
- - 5 mars 2014 - SOUTIEN BRETON AUX OTAGES EN SYRIE
- - 1er mars 2014 - Rassemblement Place de la République pour les otages en Syrie
- - Samedi 1er mars - Affichage d’une banderole sur la Mairie du 3ème arrondissement de Paris
- - 22 février 2014 - SOUTIEN OTAGES SYRIE : Les collégiens bretons soutiennent les otages en Syrie
- - #6Février un tweet pour la libération des otages en Syrie
- - 5 février 2014 - OTAGES SYRIE : Le Parlement européen rend hommage aux journalistes otages en Syrie
- - 6 février 2014 - OTAGES SYRIE : francetvinfo consacre une soirée aux journalistes otages en Syrie
- - 11 janvier 2014 - OTAGES SYRIE : Rassemblement de soutien mensuel place de la République
- - 7 janvier 2014 - OTAGES SYRIE - Les journalistes otages en syrie - Emission de Pascale CLARK
- - 6 janvier 2014 - OTAGES SYRIE - Soutien aux otages en Syrie : une banderole affiché au CONSEIL REGIONAL d’Ile-de-France
- - OTAGES SYRIE : soirée information 6 janvier 2014 à PARIS
- - OTAGES EN SYRIE - 11 JANVIER 2013 - RASSEMBLEMENT PLACE DE LA REPUBLIQUE
- - 6 décembre 2013 - LONDRES : soutien aux otages en Syrie à la résidence de l’ambassadeur de France
- - 7 décembre 2013 - Rassemblement à Paris pour les otages en Syrie
- - 6 décembre 2013 - ROUEN - Le club de la presse haut-normand organise une soirée consacrée aux journalistes français otages en Syrie.
- - 6 décembre 2013 : Soutien nantais aux otages en Syrie et à tous les otages du monde
- - 6 décembre 2013 - DIJON : Des ballons pour « libérer » les journalistes otages en Syrie
- - 6 décembre 2013 -OTAGES SYRIE : A LYON, lâcher de ballons pour les journalistes otages en Syrie
- - 6 décembre 2013 - OTAGES SYRIE : LE PROGRAMME COMPLET DES RASSEMBLEMENTS
- - OTAGES SYRIE : Mobilisons-nous pour les otages à Strasbourg
- - Rassemblement à DIJON vendredi 6 décembre à 12h30 pour les otages en Syrie
- - 6 décembre 2013 - OTAGES SYRIE : La Haute-Normandie en soutien aux otages en Syrie
- - 6 décembre 2013 - COMMUNIQUE DES CLUBS DE LA PRESSE FRANCAIS - Pour la libération de Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres
- - 9 NOVEMBRE 2013 6 OTAGES SYRIE : Rassemblement de soutien aux journalistes otages en Syrie (Reportage Photo )
- - 9 novembre 2013 - Rassemblement de soutien aux 4 journalistes otages en Syrie à Paris
- - 6 NOVEMBRE 2013 - JOURNALISTE OTAGES EN SYRIE : LE CONCERT DE SOUTIEN ORGANISE PAR EUROPE 1
- - 6 novembre 2013 -OTAGES EN SYRIE : Syrie : les artistes se mobilisent pour les otages
-
-
 OTAGE MALI - Gilbert Rodriguez Leal, enlevé par le Mujao au NORD-MALI, le 20 novembre 2012
OTAGE MALI - Gilbert Rodriguez Leal, enlevé par le Mujao au NORD-MALI, le 20 novembre 2012
 OTAGE MALI - Gilbert Rodriguez Leal, enlevé par le Mujao au NORD-MALI, le 20 novembre 2012
OTAGE MALI - Gilbert Rodriguez Leal, enlevé par le Mujao au NORD-MALI, le 20 novembre 2012
- - 17 Novembre 2014 6 OTAGE MALI - La famille de l’otage français Gilberto Rodrigues Leal demande à ses ravisseurs de dire la vérité sur sa mort
- - 22 avril 2014 - L’Elysée annonce le décès probable de Gilberto Rodrigues Leal
- - Mali : Les proches de Gilberto Rodrigues Leal demandent à ses ravisseurs de sortir du silence
- - 2 décembre 2013 - OTAGES MALI : La famille de Gilberto Rodrigues réclame des preuves de vie aux ravisseurs
- - 24 novembre 2013 - OTAGE MALI - La famille de l’otage lozérien au Mali lance un appel
- - 22 NOVEMBRE 2013 - OTAGES MALI - CONFERENCE DE PRESSE COMMUNE SOUTIEN SERGE LAZAREVIC ET GILBERT RODRIGUES - PRESS CLUB DE PARIS - REVUE DE PRESSE ET PHOTOS DE LA CONFERENCE
- - OTAGES MALI - Gilberto Rodrigues Léal, otage français depuis un an au Mali
- - 1 an de captivité au MALI -Gilbert Rodrigues
- - 16 novembre 2013 -OTAGE MALI : Langogne soutient Gilberto Rodrigues Léal enlevé au Mali il y a un an
- - 16 novembre 2013 - OTAGE MALI - Un rassemblement en Lozère pour les 1 an de captivité
- - 13 juillet 2013 - OTAGE SAHEL : PLUS DE 250 PERSONNES A BANASSAC ( Lozère) POUR SOUTENIR GILBERT RODRIGUES
- - 13 juillet 2013 — OTAGES SAHEL : Un rassemblement le 13 juillet en Lozère pour Gilberto Rodrigues Leal
- - 25 juin 2013 - OTAGES SAHEL ; David Rodrigues : "J’espère que ça aidera Gilbert à resister" (Midi Libre)
- - 2 mai 2013 - OTAGE SAHEL : David Rodriguez, le frère de Gilbert, otage au Mali, sort du silence
- - 26 NOVEMBRE 2012 - OTAGE MALI : Nord Mali : Première apparition de l’otage français Rodriguez Leal Gilberto dans une vidéo du MUJAO
-
 RODOLFO CAZARES SOLIS, OTAGE AU MEXIQUE, enlevé par des narcotrafiquants en juillet 2011
RODOLFO CAZARES SOLIS, OTAGE AU MEXIQUE, enlevé par des narcotrafiquants en juillet 2011
 RODOLFO CAZARES SOLIS, OTAGE AU MEXIQUE, enlevé par des narcotrafiquants en juillet 2011
RODOLFO CAZARES SOLIS, OTAGE AU MEXIQUE, enlevé par des narcotrafiquants en juillet 2011
- - 10 décembre 2014 - OTAGE MEXIQUE - Non, Serge Lazarevic n’était pas le dernier otage français dans le monde (20 minutes)
- - 9 juillet 2014 - OTAGE MEXICAIN - 3 ans sans nouvelle de Rodolfo Cazares
- - OTAGE MEXIQUE : Samedi 17 novembre : concert de soutien à Rodolfo Cazares
- - 9 janvier 2014 - OTAGE MEXIQUE : Rodolfo CAZARES, deux ans et demin en janvier 2014, depuis son enlèvement
- - 4 janvier 2014 - OTAGE FRANCAIS MEXIQUE : Rodolfo Cazares, l’otage oublié de la France
- - 1er novembre - OTAGES MEXIQUE - le huitième otage français (dont personne ne parle) Par BFMTV
- - OTAGES MEXIQUE - 2 ans depuis l’enlèvement du franco-mexicain Rodolfo CAZARES
- - 12 décembre 2012 - OTAGES MEXIQUE : Ludivine BARBIER CAZARES (épouse de l’otage Rodolfo CAZARES) et Frédérique SANTAL-TSCHUMI (soeur de l’otage Olivier TSCHUMI) reçues à l’Ambassade du Mexique à Paris
- - 2 décembre 2012 - SOUTIEN OTAGES : Concert Vincent Scotto à Pernes-les-Fontaines dédié au chef d’Orchestre Rodolfo Cazarès, sans oublier tous les autres otages
- - 28 octobre 2012 - OTAGES MEXIQUE : UN MESSAGE DE LUDIVINE BARBIER-CAZARES, épouse de l’otage franco-mexicain RODOLFO CAZARES aux visiteurs du site d’Otages du Monde
- - 13 octobre 2012 - OTAGE FRANCAIS AU MEXIQUE : Rodolfo Cazares Solis, chef d’orchestre marié à une iséroise, est l’otage d’un cartel de la drogue au Mexique
- - 2 octobre 2012 - OTAGE MEXIQUE : un concert pour l’otage franco-mexicain Rodolfo Cazares
-
 SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2014 A CARHAIX ( 29)
SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2014 A CARHAIX ( 29)
 SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2014 A CARHAIX ( 29)
SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2014 A CARHAIX ( 29)
-
 SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DU CHANT DE MARIN (PAIMPOL - BRETAGNE) 9/10/11 AOÛT 2013 - Photos / Videos de la mobilisation
SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DU CHANT DE MARIN (PAIMPOL - BRETAGNE) 9/10/11 AOÛT 2013 - Photos / Videos de la mobilisation
 SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DU CHANT DE MARIN (PAIMPOL - BRETAGNE) 9/10/11 AOÛT 2013 - Photos / Videos de la mobilisation
SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL DU CHANT DE MARIN (PAIMPOL - BRETAGNE) 9/10/11 AOÛT 2013 - Photos / Videos de la mobilisation
- - PAIMPOL ( Bretagne) SOUTIEN DU FESTIVAL DU CHANT DE MARIN - 9,10 et 11 août 2013 : REPORTAGE DE FRANCE Ô - JT du samedi 10 août sur la mobilisation pendant le festival
- - SOUTIEN FESTIVAL CHANT DE MARIN - PAIMPOL - 9,10 et 11 août 2013 : l’interview de Pierre MORVAN, Président du festival, sur le plateau de FRANCE 3 BRETAGNE (9 août 2013)
- - 9,10 et 11 août 2013 - Paimpol (Bretagne) : TOUTES LES PHOTOS ET VIDEOS DE LA MOBILISATION PENDANT LE FESTIVAL DU CHANT DE MARIN
- - 9/10/11 AOUT 2013 - FESTIVAL DU CHANT DE MARIN - PAIMPOl : action de sensibilisation
-
 SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL VIEILLES CHARRUES - CARHAIX (29) - JUILLET 2013
SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL VIEILLES CHARRUES - CARHAIX (29) - JUILLET 2013
 SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL VIEILLES CHARRUES - CARHAIX (29) - JUILLET 2013
SOUTIEN BRETAGNE - FESTIVAL VIEILLES CHARRUES - CARHAIX (29) - JUILLET 2013
-
 SOUTIEN VAUCLUSE - 27 juillet 2013 - PERN-LES-FONTAINES : Le festival Blues Rhinoférock s’engage pour les otages
SOUTIEN VAUCLUSE - 27 juillet 2013 - PERN-LES-FONTAINES : Le festival Blues Rhinoférock s’engage pour les otages
 SOUTIEN VAUCLUSE - 27 juillet 2013 - PERN-LES-FONTAINES : Le festival Blues Rhinoférock s’engage pour les otages
SOUTIEN VAUCLUSE - 27 juillet 2013 - PERN-LES-FONTAINES : Le festival Blues Rhinoférock s’engage pour les otages
- - 1er décembre 2014 - CONFERENCE OTAGES DU MONDE : une rencontre à Quimperlé au lycée Kerneuzec, dans le cadre du festival Les passeurs de lumière
- - 17, 18 et 19 octobre 2014 : Otages du Monde, association invitée d’ honneur du salon du livre de Hays les Roses.
- - ETE 2014 : CAMPAGNE DE SOUTIEN A SERGE LAZAREVIC ET RODOLFO CAZARES
- - 27 avril 2014 - TOUS AU VENTOUX POUR LES OTAGES DU MONDE !
DOCUMENTATION SUR LES OTAGES
-
 A SPECTS JURIDIQUES - Droit des Otages et Disparus
A SPECTS JURIDIQUES - Droit des Otages et Disparus
 A SPECTS JURIDIQUES - Droit des Otages et Disparus
A SPECTS JURIDIQUES - Droit des Otages et Disparus
-
 JUILLET 2010 : LOI "Action extérieure de la France "( REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LIBERATION PAR LES OTAGES
JUILLET 2010 : LOI "Action extérieure de la France "( REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LIBERATION PAR LES OTAGES
 JUILLET 2010 : LOI "Action extérieure de la France "( REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LIBERATION PAR LES OTAGES
JUILLET 2010 : LOI "Action extérieure de la France "( REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LIBERATION PAR LES OTAGES
- - JUILLET 2010 : PROJET DE LOI "ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE" : Compte rendu intégral de la séance du 5 juillet 2010
- - LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat (article 22 et 23 - relatif aux remboursement des frais pour la libération des otages)
- - 15 juillet 2010 - Intervention de Monsieur Hervé FERON (Député de Meurthe et Moselle - Maire de Tomblaine) dans l’hémicycle lors de la Commission Paritaire Mixte sur l’action extérieure de l’Etat
- - 13 JUILLET 2010 - Les otages « illégitimes » devront payer les opérations de secours (RUE 89)
- - 7 juillet 2010 - DROIT OTAGES : Les otages français vont-ils devoir payer leur libération ? (TV5 MONDE°
- - 5 juillet 2010 - DROIT FRANCAIS - OTAGES : Frais de secours : Féron dénonce "une remise en cause de la liberté de la presse"
- - 7 juillet 2010 - Projet de loi, adopté lundi, sur l’« action extérieure de la France » (Analyse du journal LIBERATION)
- - 7 JUILLET 2010 - PROJET DE LOI KOUCHNER : JEAN-LOUIS NORMANDIN, ANCIEN OTAGE AU LIBAN
- - 5 jullet 2010 - OTAGES FRANCAIS : Les otages priés de payer leurs frais de libération
- - 31 DECEMBRE 2013 - DROIT DES OTAGES : En droit, qu’est-ce qu’un otage ? Par Pierre Magnan |FRANCE TV INFO
- - 9 OCTOBRE 2013 - Indemnisation des personnes victimes de prise d’otages - Adoption de la proposition de loi au Sénat - COMPTE RENDU INTEGRAL DES DEBATS (PROVISOIRE)
- - Proposition de loi visant à l’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages 6- Rendu analytique officiel du 9 octobre 2013
- - Mercredi 9 octobre 2013 - DROIT DES OTAGES : examen de la proposition de loi visant à l’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages - Intervention de Mme Kalliopi Ango Ela, sénatrice EELV
- - DROIT DES OTAGES : le rapport de la commission des lois concernant la proposition de loi visant à l’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages disponible sur le site du SENAT.
- - 24 septembre 2013 - PRISE D’OTAGE - DROIT DES OTAGES : BIENTÔT UNE LOI SUR L’INDEMNISATION DES PERSONNES VICTIMES DE PRISE D’OTAGES ?
- - 20 juin 2013 - L’OTAGE EN DROIT Patrick Morvan Professeur à l’université Panthéon-Assas(*) Co-directeur du Master 2 de criminologie
- - 5 octobre 2011 - ONU - LUTTE CONTRE TERRORISME : LA SIXI�?ME COMMISSION ACH�?VE SON EXAMEN DES MESURES VISANT À LUTTER CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL
- - 4 juin 2010 - NATION UNIES : Le Conseil des droits de l’homme tient une réunion-débat sur la protection des journalistes dans les conflits armés
- - 4 mai 2010 - LEGISLATION OTAGES : Le coût du risque doit-il être assumé par les médias, par Yves Eudes et Xavier Ternisien
- - 14 MAI 2008 - DISPARITION FORCEES : PROJET DE LOI autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
- - 8 jullet 08 - Yolande Boyer, sénatrice, remet la proposition de loi sur le statut de l’otage à Ingrid Betancout, au cours de sa visite au Palais du Luxembourg.
- - 4 juin 08 - ACTES DE PIRATERIE/ PRISES D’OTAGES : La résolution de l’ONU sur la lutte contre la piraterie va changer les choses ? (Article site Portail des sous-marins)
- - Décembre 2006 - Par Aurélia Grignon : LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE EN MATI�?RE PÉNALE :
- - Décembre 2006 - Article Aurélia Grignon, juriste : un manque de législation spécifique au service des victimes de prise d’otage
- - JURISPRUDENCE JUIN 2006 : PRISE D’OTAGES SUR L’ILE DE JOLO EN 2000 : RESPONSABILITE CIVILE DE L’AGENCE DE VOYAGES
- - Texte de la convention internationale contre la prise d’otages (17/12/1979)
- - Adhesion France à Convention Internationale contre la prise d’otages - Rapport Collange
- - Rapport d’Emilie Martinez, étudiante en DESS Droit International, sur Otages Du Monde - Septembre 2006
-
-
 A SPECTS PSYCHOLOGIQUES
A SPECTS PSYCHOLOGIQUES
 A SPECTS PSYCHOLOGIQUES
A SPECTS PSYCHOLOGIQUES
- - 10 décembre 2014 - Comment se reconstruit un ex-otage ? Interview de Carole Damiani, psychologue (Source : Pourquoi docteur ?)
- - 12 décembre 2014 - Quelle vie pour l’otage et ses proches après la captivité ? (source SANTE MAGAZINE)
- - 10 décembre 2014 - A leur retour, les otages face à la confusion des sentiments
- - 18 juillet 08 - Ingrid Betancourt et les ex-otages : comment revivre ? Une interview de jean-Jacques LE GARREC, ex-otage à Jolo et membre d’Otages du Monde
- - 10 DECEMBRE 2014 - Otages, la vie d’après (reportage video FRANCE TV)
- - 10 décembre 2014 - OTAGES PSYCHOLOGIE : A leur retour, les otages face à la confusion des sentiments
- - 10 décembre 2014 - Retour de Serge Lazarevic : examens médicaux et psychologiques, débriefing avec la DGSE, ce qui attend l’ex-otage | AFP
- - 29 juin 2011 - Ex otage : des conséquences psychologiques lourdes (témoignage Jean-louis Normandin)
- - 4 juillet 2008 - OTAGES PSYCHOLOGIE : François Lebigot, psychiatre militaire : « Ingrid Betancourt a peut-être plus la capacité qu’un autre pour retrouver sa sérénité » ARTICLE PAU DANS LE PARISIEN
- - 30 octobre 2013 - OTAGES : aspects psychologiques - Intervention du psychologue Cyril COSAR, sur France 3
- - 3 octobre 2013 - SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE - STRESS POST-TRAUMATIQUE : RÉALITÉ ET PRISE EN CHARGE
- - 23 août 2013 - FRANCE INFO : Quarante ans après, le preneur d’otages à l’origine du "syndrome de Stockholm" raconte
- - 18 décembre 2012 - Le syndrome de Stockholm par Serge Tisseron sur France Inter
- - 22 août 2013 - LE SYNDROME DE STOCKHOLM - Radio Classique
- - Décembre 2010 - OTAGES NIGERIA - A Canadian taken from an oil rig off the coast of Nigeria talks about his nine-day ordeal, expressing sympathy for his captors even though they shot him
- - Adaptation psychologique aux prises d’otages - article de GARDEN-BRECHE, F. [France]
- - 3 juillet 08 - Quel suivi psychologique pour un ex-otage ? le psychiatre François Ducrocq explique ce qui attend Ingrid Betancourt avant de retrouver une vie normale.
- - 6 juillet 08 - LIBERATION D’OTAGES : Aspects psychologique : après l’euphorie, vient l’épuisement - Témoignage Roger Auque, ex-otage du Liban
- - Dossier SHEFFER MARS 07 FRANCE 5 - Bibliographie de l’émission Enlevements/Séquestrations
- - Bibliographie sur le syndrome de Stockolm
- - Définition du syndrome de Stockholm
- - L’adaptation psychologique aux prises d’otages (Journal International de Victimologie)
- - Le syndrome de Stockholm, article publié par les Docteurs Torres et Grenier-Boley
-
 ACTIONS DE SENSIBILISATION 2007 à 2012
ACTIONS DE SENSIBILISATION 2007 à 2012
 ACTIONS DE SENSIBILISATION 2007 à 2012
ACTIONS DE SENSIBILISATION 2007 à 2012
-
 Journée de mobilisation pour les otages et disparus - 25 SEPTEMBRE 2007 - la conférence, le concert.
Journée de mobilisation pour les otages et disparus - 25 SEPTEMBRE 2007 - la conférence, le concert.
 Journée de mobilisation pour les otages et disparus - 25 SEPTEMBRE 2007 - la conférence, le concert.
Journée de mobilisation pour les otages et disparus - 25 SEPTEMBRE 2007 - la conférence, le concert.
-
 1 AOUT 2010 - LA NUIT DE LA PHOTO
1 AOUT 2010 - LA NUIT DE LA PHOTO
-
 LES RENDEZ-VOUS D’OTAGES DU MONDE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES JUILLET 2009
LES RENDEZ-VOUS D’OTAGES DU MONDE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES JUILLET 2009
 LES RENDEZ-VOUS D’OTAGES DU MONDE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES JUILLET 2009
LES RENDEZ-VOUS D’OTAGES DU MONDE - FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES JUILLET 2009
-
 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX - du 17 au 19 juillet 09
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX - du 17 au 19 juillet 09
 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX - du 17 au 19 juillet 09
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX - du 17 au 19 juillet 09
-
 Ceux qui font les vieilles charrues
Ceux qui font les vieilles charrues
 Ceux qui font les vieilles charrues
Ceux qui font les vieilles charrues
-
 En direct du stand
En direct du stand
-
 Vieilles Charrues 2009 : Paroles de festivaliers
Vieilles Charrues 2009 : Paroles de festivaliers
 Vieilles Charrues 2009 : Paroles de festivaliers
Vieilles Charrues 2009 : Paroles de festivaliers
- - Rencontre avec Jean-Marc L’Hostis, responsable du village associatif et solidaire du festival
- - JUILLET 2009 : OTAGES DU MONDE AU FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX
-
- - JANVIER 07 - EVENEMENT BDE SCIENCES PO/OTAGES DU MONDE : Une conférence-débat sur le thème des otages à Sciences Po Paris
- - MARDI 26 JUIN 2012 à l’HIPPODROME DE COMPIEGNE - JOURNEE DE SOUTIEN AUX OTAGES
- - 14 septembre 2011 - "Comment protéger les journalistes sur les zones de conflit ?" Rencontre au parlement Européen - Participation d’Otages du Monde
- - 12, 13 et 14 août 2011 - Festival du Chant de Marin à Paimpol (Bretagne - 22) : Rendez-vous sur le stand d’Otages du Monde
- - 27 juin 2011 : quatre sportifs sautent en chute libre pour les otages du monde à Peronne (Picardie)
- - 27 juin 2011 - Des sportifs effectuent un saut en chute libre pour les otages du monde
- - 27 JANVIER 2011 - RENCONTRE AVEC LES LYCEENS DES CORDELIERS A DINAN (22 - BRETAGNE) : LES SECONDES TRAVAILLENT SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE...
-
-
 ACTUALITES 2009 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2009 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
 ACTUALITES 2009 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2009 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
-
 ACTUALITES 2010 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2010 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
 ACTUALITES 2010 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2010 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN DECEMBRE 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN NOVEMBRE 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN OCTOBRE 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN SEPTEMBRE 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN AOUT 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN JUILLET 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN JUIN 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN MAI 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN AVRIL 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN MARS 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN FEVRIER 2010
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN JANVIER 2010
-
 ACTUALITES 2011 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2011 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
 ACTUALITES 2011 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2011 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN DECEMBRE 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN NOVEMBRE 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN SEPTEMBRE 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN AOUT 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN OCTOBRE 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE EN JUILLET 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN JUIN 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN MAI 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN AVRIL 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN MARS 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES EN FEVRIER 2011
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES EN JANVIER 2011
-
 ACTUALITES 2012 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2012 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
 ACTUALITES 2012 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2012 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN DECEMBRE 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN NOVEMBRE 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN OCTOBRE 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN SEPTEMBRE 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN AOUT 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN JUILLET 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN JUIN 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE DES OTAGES DANS LE MONDE EN MAI 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN AVRIL 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES OTAGES DANS LE MONDE EN MARS 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE EN JANVIER 2012
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE EN FEVRIER 2012
-
 ACTUALITES 2013 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2013 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
 ACTUALITES 2013 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2013 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN DECEMBRE 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN NOVEMBRE 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN OCTOBRE 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN SEPTEMBRE 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN AOUT 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN JUILLET 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN JUIN 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN MAI 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN AVRIL 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN MARS 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN FEVRIER 2013
- - ACTUALITE DES PRISES D’OTAGES EN JANVIER 2013
-
 ACTUALITES 2014 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2014 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
 ACTUALITES 2014 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
ACTUALITES 2014 SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE - INFORMATION QUOTIDIENNE
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE EN JUIN 2014
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES EN MAI 2014
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES EN AVRIL 2014
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES EN MARS 2014
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES EN FEVRIER 2014
- - TOUTE L’ACTUALITE SUR LES PRISES D’OTAGES EN JANVIER 2014
-
 BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE
 BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE
-
 Films et reportages
Films et reportages
 Films et reportages
Films et reportages
- - My Kidnapper :film about Mark Henderson’s return to Colombia to meet the kidnappers that held him for 8 months in 2003
- -
12 janvier 2010 - Emission sur les otages sur RCF Morbihan Radio Sainte Anne - - 2 janvier 2010 - SUR LA CHAINE PARLEMENTAIRE Liban - 1985 - 1988 Le temps des otages
- - MAI 1985 - MAI 1988 - OTAGES AU LIBAN - Retrospective video de l’INA
- - Un reportage de Michel Peyrard : "Sur les traces d’Ingrid" (Envoyé spécial)
- - Appel de Florence Aubenas pour la libération des journalistes otages dans le monde à l’occasion de la 17eme journée internationale de la liberté de la presse du 3 mai 2007.
- - VOIR AUSSI LES FILMS ET REPORTAGES DANS LES RUBRIQUES : "Toutes les videos sur le combat pour la libération d’Ingrid Betancourt et les otages en Colombie" et "Témoignages d’otages et de familles d’otages "
- - Juin 07 - COMPLEMENT D’ENQUETE : JEAN-LOUIS NORMANDIN, otage au Liban, témoigne.
- - Françoise Claustre, "la captive du désert", de Raymond Depardon
- - Au Japon, les otages ne sont pas des héros
- - 6 septembre 2013 - PIRATERIE MARITIME : Saisissant "A Hijacking" (fiche ciné Blog Goord Morning Africa)
- - 27 décembre 2011 - Une video pour les otages du Monde - Yves Hernandez
- - 14 février 2010 - Dans l’islam des révoltes », de Philippe Rochot
- - Livres publiés par les otages de Jolo (Philippines - 2000)
- - Les références bibliographiques (Français/ Anglais)
-
-
 Chansons pour les otages
Chansons pour les otages
 Chansons pour les otages
Chansons pour les otages
- - 6 juin 2014 - Dax : une chanson pour les otages
- - Où es-tu ? Une chanson pour les otages - Patrick BRUEL
- - Pour Ingrid Betancourt : World from hell - Music by 1bugs
- - RAP pour Ingrid Betancourt par Olivier MOLEMA
- - 15 janvier 08 - OTAGES COLOMBIE : "INGRID,NOUS T’AIMONS" de Michaël Berreby
- - Ingrid Betancourt : une chanson écrite par Pascal Lefevre
- - "Dans la jungle" de Renaud - la video
- - BALTIMORE, un CD pour les Otages du Monde
- - Une chanson de Cecilem pour Ingrid Betancourt
- - Avril 07 - Une chanson pour Marc Beltra, disparu en Colombie
- - La Rage au coeur, une chanson pour Ingrid Bétancourt, écrite par Jimmy PIERRE
- - Pour Guy-André KIEFFER, une chanson de Raphaël LEPINEUX
- - Corriya : Vérité en otage
-
 CHIFFRES SUR LES OTAGES
CHIFFRES SUR LES OTAGES
 CHIFFRES SUR LES OTAGES
CHIFFRES SUR LES OTAGES
- - CHIFFRES SUR LES OTAGES : Les précédentes prises d’otages marquantes au Japon
- - 26 février 2014 - JOURNALISTES OTAGES DANS LE MONDE : liste publiée par RSF
- - LES PRISES d’OTAGES EN AFRIQUE DEPUIS 2012
- - 15 juin 2011 - Documentation sur les otages - " Risk management : assurance enlèvement "- Article publié par Le Nouvel Economiste
- - 29 MAI 2010 - OTAGES ALGERIE - le phénomène prend de l’ampleur en Algérie
- - Décembre 2010 - RAPPORT ANNUEL DE REPORTERS SANS FRONTIERES : plus de journalistes pris en otages dans le monde en 2010
- - LES CHIFFRES SUR LE NOMBRE D’OTAGES DANS LE MONDE ESTIME PAR LES COMPAGNIES D’ASSURANCE
- - 26 juillet 2010 - OTAGES DANS LE MONDE : Les autres otages exécutés dans le monde
- - LES PRISES D’OTAGES DANS LE MONDE EN JANVIER 2010
- - 25 janvier 2010 - OTAGES DANS LE MONDE : Les rapts de Français explosent dans le monde (LE FIGARO)
- - 15 janvier 2010 - PIRATERIE MARITIME : Le BMI publie son rapport annuel sur la piraterie
- - PRISES D’OTAGES, VIOLENCES : LES HUMANITAIRES DUREMENT TOUCHES DEPUIS 2008
- - 15 décembre 09 - LES OTAGES FRANCAIS DANS LE MONDE
- - OTAGES : 2007 - LES CHIFFRES DE RSF
- - CHIFFRES 2008 sur les prises d’otages : la France, deuxième pays concerné après la Chine (Etude HISCOX)
-
 CONSEILS AUX VOYAGEURS
CONSEILS AUX VOYAGEURS
 CONSEILS AUX VOYAGEURS
CONSEILS AUX VOYAGEURS
- - 2014 - SECURITE DES VOYAGEURS : le site incontournable
- - SEPTEMBRE 2013 - RISQUES PAYS : un blog intéressant à consulter avant de voyager
- - SEPTEMBRE 2013 - LE SITE ARIANE DE FRANCE DIPLOMATIE : UN FIL DE SECURITE
- - SEPTEMBRE 2013 - CONSEILS AUX VOYAGEURS - FRANCE DIPLOMATIE : le site à consulter avant tout déplacement dans les zones à risque
- - 27 janvier 2010 - CONSEILS EXPATRIES : La sécurité, un enjeu critique pour les entreprises (dans la revue LE PETIT JOURNAL)
- - Le site du Ministère des Affaires Etrangères
-
 ENGLISH INFORMATION
ENGLISH INFORMATION
-
 HUMANITAIRES ET PRISES D’OTAGES - NOS FORMATIONS
HUMANITAIRES ET PRISES D’OTAGES - NOS FORMATIONS
 HUMANITAIRES ET PRISES D’OTAGES - NOS FORMATIONS
HUMANITAIRES ET PRISES D’OTAGES - NOS FORMATIONS
- - 9 mai 2011 - HUMANITAIRES OTAGES :"Il y a une psychose au sein des ONG"
- - 26 janvier 2011 - POSITION DE MEDECINS SANS FRONTIERES - Guerre contre la terreur au Sahel : l’humanitaire face à la raison d’Etat
- - 27 JUILLET 2010 - OTAGES DU MONDE SUR RTL : FAUT-IL POURSUIVRE L’ACTION HUMANITAIRE AU SAHEL ?
- - 15 juillet 2010 - FORMATIONS OTAGES DU MONDE (VIDEO LE TELEGRAMME - Article du 15 juillet 2010)
- - 5 juin 2010 : PREMIERE FORMATION POUR LES HUMANITAIRES DES PETITES ASSOCATIONS EN BRETAGNE (REVUE DE PRESSE)
- - FORMATION DES HUMANITAIRES : OTAGES DU MONDE LANCE LA PREMIERE FORMATION POUR LES VOLONTAIRES DES PETITES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
- - 30 mars 2010 - OTAGES MALI : L’ex-otage français au Mali Pierre Camatte parle sur RFI
- - 13 avril 2010 - OTAGES CICR : Le CICR victime de nombreux enlèvements - 20 minutes
- - 24 juin 2009 - L’insécurité menace l’action humanitaire : UN DOSSIER DU JOURNAL LA CROIX
- - 6 janvier 2010 - OTAGES HUMANITAIRES : Reportage LES AILES DE L’ESPOIR (VIDEO "REPORTERS")
- - 30 juin 2002 - CICR : Attitude du CICR en cas de prise d’otages
- - PRISES D’OTAGES : LES HUMANITAIRES DUREMENT TOUCHES EN 2008
-
 INGRID BETANCOURT
INGRID BETANCOURT
 INGRID BETANCOURT
INGRID BETANCOURT
-
 INGRID BETANCOURT : TOUTES LES ACTIONS DE SOUTIEN DE 2004 A 2008
INGRID BETANCOURT : TOUTES LES ACTIONS DE SOUTIEN DE 2004 A 2008
 INGRID BETANCOURT : TOUTES LES ACTIONS DE SOUTIEN DE 2004 A 2008
INGRID BETANCOURT : TOUTES LES ACTIONS DE SOUTIEN DE 2004 A 2008
-
 Juillet 06 - Carhaix, Festival des Vieilles Charrues : toutes les photos, tous les reportages !
Juillet 06 - Carhaix, Festival des Vieilles Charrues : toutes les photos, tous les reportages !
 Juillet 06 - Carhaix, Festival des Vieilles Charrues : toutes les photos, tous les reportages !
Juillet 06 - Carhaix, Festival des Vieilles Charrues : toutes les photos, tous les reportages !
- - Interview d’Olivia Ruiz
- - Interview de Lugo, le lauréat du tremplin des Vieilles Charrues
- - Interview de Cyril, batteur du groupe Bumcello
- - Interview de Babylon Circus
- - ECOUTER L’INTERVIEW AUDIO, SUR FREQUENCE 3, de Sarah, bénévole à ODM
- - Interview des Cowboys Fringants
- - Interview de Yann Rivoal, directeur des Vieilles Charrues
- - Interview de Jack Lang
- - Interview du guitariste des HUSHPUPPIES
- - Interview de Rhesus
- - La galerie photos des Vieilles Charrues
- - Interview de Philippe MARLU
- - Festival des Vieilles Charrues
-
 16 et 17 février 2008 : journées de mobilisation à LA MEAUGON (22)
16 et 17 février 2008 : journées de mobilisation à LA MEAUGON (22)
 16 et 17 février 2008 : journées de mobilisation à LA MEAUGON (22)
16 et 17 février 2008 : journées de mobilisation à LA MEAUGON (22)
-

 Journée de mobilisation pour les otages le 27 janvier 2008, à Locoal-Mendon (Morbihan)
Journée de mobilisation pour les otages le 27 janvier 2008, à Locoal-Mendon (Morbihan)

 Journée de mobilisation pour les otages le 27 janvier 2008, à Locoal-Mendon (Morbihan)
Journée de mobilisation pour les otages le 27 janvier 2008, à Locoal-Mendon (Morbihan)
-
 CARHAIX : FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 20, 21 et 22 juillet 2007
CARHAIX : FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 20, 21 et 22 juillet 2007
 CARHAIX : FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 20, 21 et 22 juillet 2007
CARHAIX : FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 20, 21 et 22 juillet 2007
- - MERCI AUX VIEILLES CHARRUES !
- - Vieilles Charrues : la galerie photos
- - OXMO PUCCINO : interview exclusive
- - Le soutien de Jean-Yves LE DRIANT, Président du Conseil Régional de Bretagne
- - Yannick Noah : il ne faut pas oublier ! Continuez la mobilisation !
- - Abd Al MALIK : entretien exclusif
- - Toumast : un entretien passionnant avec le chanteur du groupe, originaire du Niger
- - Galerie photo du dimanche à Carhaix
- - Galerie photo du samedi à Carhaix : les artistes
- - Bernard LAVILLIERS et nos reporters à propos des otages colombiens
- - La galerie des photos (sur le stand ODM) à LA GARENNE)
- - DJ Zebra : "La Liberté est fondamentale".
- - Nelson : "La prise d’otage décridibilise tout mouvement".
- - Lugo : "Nous sommes des citoyens engagés".
-
 FESTIVAL DES TERRE NEUVAS A BOBITAL 6,7 et 8 juillet 2007 : toutes les interviews et videos.
FESTIVAL DES TERRE NEUVAS A BOBITAL 6,7 et 8 juillet 2007 : toutes les interviews et videos.
 FESTIVAL DES TERRE NEUVAS A BOBITAL 6,7 et 8 juillet 2007 : toutes les interviews et videos.
FESTIVAL DES TERRE NEUVAS A BOBITAL 6,7 et 8 juillet 2007 : toutes les interviews et videos.
- - Débat sur les otages avec Gilles Servat, Pat O May et Adair Lemprea
- - Che Sudaka, des coulisses à la scène : un soutien total !
- - Bobital : Trois jours de festival en photos.
- - Renaud fait chanter à l’unisson 45000 personnes pour Ingrid, Clara et les otages colombiens.
- - Adaïr Lamprea : "Hasta la victoria siempre pour les otages".
- - Les bénévoles d’Otages du Monde à Bobital.
- - Simon, chanteur du groupe Debout sur le Zinc : « La vie des gens n’appartient à personne ».
- - Aldebert : « Quand on a la chance d’avoir la liberté, on doit se battre pour celle des autres ».
- - Alan Stivell : "La liberté est le bien le plus précieux".
- - Da Silva : "Le plus grand malheur, c’est l’absence de liberté".
- - Les Terre Neuvas et ODM : rencontre avec Bertrand Hellio.
- - Anis témoigne de son engagement pour Ingrid Betancourt.
- - Matmatah : "La prise d’otage est quelque chose d’inhumain".
-
 Juillet 06 - Festival des Terre Neuvas, à Bobital (22) : toutes les photos, toutes les interviews !
Juillet 06 - Festival des Terre Neuvas, à Bobital (22) : toutes les photos, toutes les interviews !
 Juillet 06 - Festival des Terre Neuvas, à Bobital (22) : toutes les photos, toutes les interviews !
Juillet 06 - Festival des Terre Neuvas, à Bobital (22) : toutes les photos, toutes les interviews !
- - Interview d’Yvon Etienne, chanteur des Goristes
- - La galerie de photos du festival
- - Bob et Mimosas : toujours la pêche pour parler d’ Ingrid !
- - Le soutien sans faille de Mickey 3D
- - Interview de Jean-Philippe "Dynamite" Roy, chanteur du groupe québécois Le Nombre
- - Interview de Clément DIRAT, membre de Beautés Vulgaires
- - Interview de Guizmo - Chanteur de Tryo et de Pause
- - Interview de Didier Wampas
- - Interview de "Djé" - guitariste de Freedom From King Kong
- - Festival des Terres-Neuvas
-
 Juin 2006 - Trégastel (22)
Juin 2006 - Trégastel (22)
 Juin 2006 - Trégastel (22)
Juin 2006 - Trégastel (22)
-
 Mars 06 : concert d’Auray (56) : toutes les photos, toutes les interviews !
Mars 06 : concert d’Auray (56) : toutes les photos, toutes les interviews !
 Mars 06 : concert d’Auray (56) : toutes les photos, toutes les interviews !
Mars 06 : concert d’Auray (56) : toutes les photos, toutes les interviews !
- - 4 mars 06 à Auray(56) : une mobilisation exceptionnelle en Bretagne
- - Concert d’AURAY - MARS 06 : le reportage de France 3 Ouest
- - La galerie photos
- - Mars 06 - Conférence de presse au Petit Théâtre d’Auray - Interview de Fabrice Delloye, père des enfants d’Ingrid Betancourt
- - Interview d’Alain Lanty, pianiste de Renaud
- - Interview d’Olivier Gravelot
- - Interview de Pat O’May, musicien de Gilles Servat
- - Interview de Maëlla Gaubert
- - Interview d’Alex, chanteur d’Armens
- - Interview de Jimmy Pierre
- - Interview de Guy et Liza Guillaume
- - Interview de Gilles Servat
- - Interview de Renaud
- - Interview d’Anne Vanderlove
- - OCTOBRE 2005 : Le concert de soutien au Théâtre du Rond-Point, avec Renaud et 17 artistes
- - 3 janvier 2003 - LA PREMIERE RENCONTRE DES COMITES DE SOUTIEN A INGRID BETANCOURT A ISSY LES MOULINEAUX - TOUTES LES VIDEOS
- - Juin 06 - Soirée cinéma sur le thème des otages à Moëlan-sur-mer (Finistère)
- - Février 07 - LA MEAUGON (22) Concert de soutien en Bretagne - Reportage France 3
- - Juillet 08 - Le festival des Vieilles Charrues soutient les Otages du Monde
- - 6 juillet 2008 - LE FESTIVAL DES TERRES-NEUVAS FETE LA LIBERATION d’INGRID BETANCOURT
- - AGIR POUR INGRID BETANCOURT EN PROVINCE : TOUTES LES INITIATIVES EN FRANCE
- - 7 juin 08 - OTAGES COLOMBIE : LE SOUTIEN DES BRETONS : Locoal-Mendon nomme I. Betancourt "Citoyenne d’Honneur"
- -
 9 février 2008 - Lyon/ Villeurbanne : deux villes engagées pour la cause des otages
9 février 2008 - Lyon/ Villeurbanne : deux villes engagées pour la cause des otages - -
 EUNICE BARBER soutient ODM : elle sera la marraine de Laurent FOSSE, pour le "Grand Raid Manikou", à La Martinique, en décembre 08
EUNICE BARBER soutient ODM : elle sera la marraine de Laurent FOSSE, pour le "Grand Raid Manikou", à La Martinique, en décembre 08 - - 23 janvier 07- EVENEMENT BDE SCIENCES PO/OTAGES DU MONDE : Une conférence-débat sur le thème des otages à Sciences Po Paris
- - 25 février 2007 : concert de soutien pour Ingrid Bétancourt et les otages colombiens en Bretagne
- - Janvier 2007 : La Cie lilloise Théâtre d’Octobre joue « Quelqu’un pour veiller sur moi » de Frank McGuinness
- - Novembre 06 : une pièce de théâtre sur le thème de la captivité présentée par la Comédie de St Etienne
-
-
 Les documents audio
Les documents audio
-
 Les videos
Les videos
 Les videos
Les videos
- - SEPTEMBRE 2010 - INGRID BETANCOURT : SORTIE DU LIVRE "Même le silence a une fin" - Interviews
- - Le reportage de l’émission canadienne Zone Libre sur Ingrid Betancourt et son combat
- - Décembre 07 - Le message de Lorenzo à sa mère, Ingrid Bétancourt, sur RFI
- - 2000 jours de détention pour Ingrid Betancourt et Clara Rojas : point sur la situation par France 3
- - 4 juillet 2007 - OTAGES COLOMBIE : interview de Lorenzo Delloye sur France 24
- - 5 juin 07 - SORTIE DE l’ELYSEE : déclarations de Mélanie Betancourt, la fille d’Ingrid, et Fabrice Delloye, ex-mari d’Ingrid et père de ses enfants.
- - OTAGES COLOMBIENS : VU SUR U.TUBE...UN REPORTAGE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES OTAGES
- - OTAGES COLOMBIE : DECEMBRE 2006 : MESSAGE DE YOLANDA PULECIO BETANCOURT
- - 19 février 07 - OTAGES COLOMBIE : intervention Mélanie Delloye, mairie de Paris
- - Ingrid BETANCOURT : reportage réalisé par Radio Canada une semaine après l’enlèvement d’Ingrid Betancourt
- - 19 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Emission Un jour, Une heure de France 2
- - Mars 07 - OTAGES COLOMBIE : Le président d’Otages du Monde exprime sa position sur l’enlèvement d’Ingrid Betancourt.
- - OCTOBRE 2005 : Le concert de soutien au Théâtre du Rond-Point, avec Renaud et 17 artistes
- - 23 févier 2006 - OTAGES COLOMBIE :Concert de soutien au Zenith de Rouen
- - 19 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Intervention de Mélanie Delloye lors du concert de soutien à la mairie de Paris
- - 23 août 2006 - OTAGES COLOMBIE : Lettre d’un anonyme à Ingrid Betancourt
- - 19 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Clip pour la soirée de soutien à Ingrid Bétancourt du lundi 19 février à l’Hôtel de ville de Paris.
- - 23 février 07 - OTAGES COLOMBIE : L’engagement de Dominique Voynet pour la libération d’Ingrid Betancourt
- - 23 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Le concert de Renaud à Caen, interventions de la famille d’Ingrid
- - 23 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Le spot pour les accords humanitaires diffusé en Colombie pendant la semaine de mobilisation
- - 23 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Le spot de Mélanie Delloye-Betancourt à l’attention des candidats aux élections présidentielles
- - 21 février 07 - OTAGES COLOMBIE : Interview de Mélanie Betancourt
- - Février 2007 France 2 : Ingrid Betancourt, les secrets d’un enlèvement (2eme partie)
- - février 07 - France 2 : Ingrid Betancourt, les secrets d’un enlèvement (3eme partie)
- - Février 07 -France 2 : Ingrid Betancourt, les secrets d’un enlèvement (4éme partie)
- - Qui est Ingrid Betancourt ? Emission 5/5 de Radio Canada
- - INGRID BETANCOURT : Discours d’Ingrid Betancourt à la conférence mondiale des Verts, en 2001
- - Reportage de Radio Canada sur Ingrid BETANCOURT
- - "Cautiverio", le film d’Alberto Muñoz
- - HOMMAGE A ANDREE BERTHELOT
- - 2 juillet 2011 - OTAGES COLOMBIE : Interview avec le commandant de l’Opération Jaque de libération d’otages en Colombie
- - 10 OCTOBRE 2010 - OTAGES COLOMBIE - INGRID BETANCOURT se livre sur RFI
- - 5 OCTOBRE 2010 - OTAGES COLOMBIE : INGRID BETANCOURT : J’avais le devoir de témoigner (Interview quotidien Sud Ouest)
- - 22 septembre 2010 - OTAGES COLOMBIE : sortie du livre d’Ingrid Betancourt, "Même le silence a une fin"
- - 1er décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : Les preuves de vie des otages colombiens diffusées par les FARC
- - AGIR EN PROVINCE POUR INGRID BETANCOURT : APPEL AUX ELUS
- - AGIR POUR INGRID BETANCOURT EN PROVINCE : des affiches pour agir
- - AGIR POUR INGRID BETANCOURT EN ILE DE FRANCE
- - LES MESSAGES DES INTERNAUTES
- - SPOT MOBILISATION POUR INGRID BETANCOURT
- - La pétition pour la libération d’Ingrid Bétancourt et des otages colombiens
- - 3 janvier 08 - OTAGES COLOMBIE : sortie d’un livre contre l’inacceptable," Lettres à maman", par Mélanie et Lorenzo Delloye
- - Toutes les actions à Paris et en Ile de France pour le 6 anniversaire de la prise d’otage d’Ingrid Betancourt
- - TOUTES LES ACTIONS EN FRANCE POUR LE 6eme ANNIVERSAIRE DE LA PRISE D’OTAGE D’INGRID BETANCOURT
- - OTAGES COLOMBIE - MOBILISATION DU 1er MARS 2008 : "Pour Ingrid Betancourt : on a plus le temps !"
- - 23 mars 08 - OTAGES COLOMBIE - Ingrid Betancourt : la face méconnue d’une détention
- - Novembre 07 : Interview exclusive de Lorenzo Delloye
- - 14 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : la ville de Saint-Brieuc élève le portrait d’Ingrid Betancourt sur sa mairie
- - TOUTES LES ARCHIVES DE L’INA SUR LA PRISE D’OTAGE D’INGRID BETANCOURT
- - Février 2006 - OTAGES COLOMBIE - Article paru dans France soir - "Mobilisation politique sur tous les fronts pour Ingrid Betancourt"
- - 2000 ème jour détention Ingrid Betancourt : interview d’Adair Lampréa
- - Les artistes et écrivains soutiennent Ingrid Betancourt
- - 16 août 2007 - OTAGES COLOMBIE : 2000 jours de détention - les videos et photos de la conférence de presse de Mélanie, Lorenzo et Fabrice Delloye à Paris Plage
- - 14 Juin 2007 - OTAGES COLOMBIENS : Fabrice Delloye, père des enfants d’Ingrid, demande des preuves de vie
- - OTAGES COLOMBIE : EMISSION RTBF INGRID BETANCOURT "DITES MOI" 2002
- - Cellule de crise pour Ingrid Betancourt : Questions écrites posées par les parlementaires en juin 2006
-
-
 LA QUESTION DES RANçONS
LA QUESTION DES RANçONS
 LA QUESTION DES RANçONS
LA QUESTION DES RANçONS
- - 22 août 2014 - Laurent Fabius : "La France ne paie pas de rançon"
- - 29 juiet 2014 : Paying Ransoms, Europe Bankrolls Qaeda Terror
- - 13 octobre 2013 - changement de doctrine, choix « payant » ? FRANCE CULTURE
- - 16 juin 2013 - RANCON OTAGES - Doctrine : Le G8 veut interdire les rançons pour les otages à l’étranger La liberté ne doit pas payer les terroristes
- - 18 mars 2013 - RANçON Otages : la France ne veut plus payer
- - DEBAT : FAUT-IL PAYER LES RANÇONS ?
-
 LES CAHIERS D’OTAGES DU MONDE
LES CAHIERS D’OTAGES DU MONDE
 LES CAHIERS D’OTAGES DU MONDE
LES CAHIERS D’OTAGES DU MONDE
-
 MEDIATISATION DES OTAGES : Réflexions, analyses
MEDIATISATION DES OTAGES : Réflexions, analyses
 MEDIATISATION DES OTAGES : Réflexions, analyses
MEDIATISATION DES OTAGES : Réflexions, analyses
-
 2009 - Prix Bayeux des correspondants de guerre : conférences ODM
2009 - Prix Bayeux des correspondants de guerre : conférences ODM
 2009 - Prix Bayeux des correspondants de guerre : conférences ODM
2009 - Prix Bayeux des correspondants de guerre : conférences ODM
- - 10 décembre 2014 - Libération de l’otage Serge Lazarevic : Survivre au portrait destructeur livré par les médias. par Philippe Rochot. BLOG
- - 20 août 2014 - OTAGES SYRIE : OTAGES SYRIE : James Foley : pourquoi les Américains ne médiatisent pas les prises d’otages ?
- - 10 octobre 2013 - MEDIATISATION DES OTAGES : Faut-il médiatiser le sort des otages ? (BFM TV)
- - 29 décembre 2010 - OTAGES EN AFGHANISTAN : « Leur vie tient à la médiatisation » (Article 20 minutes)
- - PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANTS DE GUERRE : Un débat sur le thème : "Reporters de guerre, témoins en péril ?" - endirect sur FRANCE 3 web
- - 26 août 2010 - JOURNALISTES OTAGES AFGHANISTAN : Les enjeux de la médiatisation (LE MONDE)
- - 17 février 2010 - Entretien directeur Reporter Sans Frontière (TELERAMA ) : “On ne sait plus très bien ce qui pourrait aider les otages...”
- - 16 février 2010 - AFGHANISTAN - Emission TELERAMA sur médiatisation des otages
- - 12 janvier 2010 - OTAGES DANS LE MONDE : Comment ne pas les oublier ?
- - 20 juin 08 - LA MEDIATISATION DES OTAGES :(article du Figaro - 20 juin 08) pour l’otage français en Afghanistan, la presse a gardé le silence
-
-
 OTAGES LIBAN
OTAGES LIBAN
 OTAGES LIBAN
OTAGES LIBAN
- - 31 janvier 2012 - OTAGES LIBAN : portrait Christian Joubert, ex-otage au Liban
- - 12 décembre 2011 - OTAGES LIBAN : Ahmad Zeidan libéré, ses ravisseurs ont « disparu » dans la nature
- - 23 octobre 09 - Nomination au poste d’Ambassadeur de Roger Auque, ex-otage du Liban, membre fondateur d’Otages du Monde
- - Témoignage de Jean-Paul Kauffmann
- - Témoignage de Roger Auque
- - Jean-Louis Normandin, ex-otage au Liban, reçoit la légion d’honneur
- - Juin 07 - COMPLEMENT D’ENQUETE : JEAN-LOUIS NORMANDIN, otage au Liban, témoigne.
- - mai 1985-mai 1988 - OTAGES DU LIBAN : LES VIDEOS DE L’INA
-
 OTAGES PHILIPPINES
OTAGES PHILIPPINES
 OTAGES PHILIPPINES
OTAGES PHILIPPINES
- - 17 SEPTEMBRE 2013 OTAGES PHILIPPINES : Philippines : 150 otages échappent aux insurgés
- - 1er février 2012 - OTAGES PHILIPPINES : un Suisse et un Néerlandais enlevés dans le sud
- - 2 janvier 2012 - OTAGES PHILIPPINES : rançon pour un otage australien
- - OTAGE PHILIPPINES - 3 mars 2010 : Un ancien otage vient remercier Benoît XVI de ses interventions
- - 27 février 2010 - OTAGES PHILIPPINES : la police annonce la libération de deux otages chinois
- - 11 juillet 09 - OTAGES PHILIPPINES : Libération de l’otage italien Eugenio Vagni aux Philippines
- - 2000 - OTAGES DE JOLO (Philippines) : Livres-témoignages publiés par les otages de Jolo
- - JUIN 2007 - OTAGES PHILIPPINES : Le père Giancarlo Bossi, prêtre italien, libéré le 19 juillet 07, après 39 jours de détention
-
 OTAGES AFGHANISTAN
OTAGES AFGHANISTAN
 OTAGES AFGHANISTAN
OTAGES AFGHANISTAN
- - 17 NOV 2013 - OTAGE AFGHANISTAN : Pierre Borghi, l’autre otage qui a réussi à s’évader en avril 2013
- - 9 mai 2011 - OTAGE AFGHANISTAN : les talibans menacent de juger pour espionnage un jeune touriste, otage canadien
- - 2 décembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : deux otages,un néerlandais et un afghan, libérés en Afghanistan
- - 12 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Enquête sur la mort d’une otage britannique
- - 9 octobre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Une otage britannique tuée par ses ravisseurs en Afghanistan
- - 7 août 2010 - AFGHANISTAN : Afghanistan : 8 occidentaux exécutés
- - 9 septembre 2009 - OTAGES AFGHANISTAN : Libération d’un journaliste irlandais otage des taliban
- - 30 avril 2007 - Article de l’Express - Otages français : "Le terrible marché", par Eric Pelletier
- - 9 juillet 07 - OTAGES AFGHANISTAN : relations Allemagne / Afghanistan : au sujet de l’engagement allemand en Afghanistan
- - 13 août 07 - OTAGES AFGHANISTAN : Les enlèvements d’étrangers en Afghanistan depuis 2001
- - 14 avril 07 - OTAGES AFGHANISTAN : video des 2 otages français, Céline Cordelier et Eric Damfreville expédiée par leurs ravisseurs
- - 15 mai 2007 - OTAGES AFGHANISTAN : libération d’Eric Damfreville
-
 OTAGES AFGHANISTAN : HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONNIIER, LIBRES !
OTAGES AFGHANISTAN : HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONNIIER, LIBRES !
 OTAGES AFGHANISTAN : HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONNIIER, LIBRES !
OTAGES AFGHANISTAN : HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONNIIER, LIBRES !
-
 INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
 INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
- - 13 mai 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : "Il faut hurler notre désespoir pour eux"
- - 12 et 3 MAI 2011 - OTAGES EN AFGHANISTAN : l’angoisse des parents des otages
- - 12 mai 2011 - 500 jours : émission spéciale sur la Chaîne parlementaire
- - 24 FEVRIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : La libération des otages en Afghanistan est complexe, dit Juppé
- - 29 décembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN :"Un otage, c’est un résistant" Jean-Louis Normandin, Président d’Otages du Monde, pour EUROPE1
- - 21 JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : le nouveau chantage de Ben Laden}} (LE PARISIEN)
- - 21 janvier 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : Ben Laden lie le sort des otages au retrait français d’Afghanistan
- - 10 JANVIER 2010 - OTAGES AFGHANISTAN :Fillon optimiste sur une "issue favorable"
- - 1er JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : REPORTAGES TV après la publication du communiqué des Talibans
- - 1er JANVIER 2010 - Otages en Afghanistan : les talibans accusent, Paris répond
- - 1er JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : Paris ne "prête pas attention à nos exigences", estiment les talibans
- - 23 NOVEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Les familles et proches de Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière reçus à l’Elysée
- - 16 novembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Le président de la république se dit "moins inquiets" pour Hervé et Stéphane que pour les otages français au Mali
- - 25 OCTOBRE 2010 - 300 JOURS DEJA... HERVE ET STEPHANE, OTAGES EN AFGHANISTAN - LE CONCERT DE SOUTIEN DE FRANCE TELEVISION
- - OTAGES AFGHANISTAN : Angers solidaire des journalistes otages en Afghanistan
- - 29 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : 9 mois de captivité - Rassemblement à Paris devant France TV (video)
- - 25 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : « Il y a des fausses libérations et donc des fausses joies » - Une interview de Georges Malbrunot
- - 24 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Otages en Afghanistan : un espoir de libération avant Noël
- - 10 septembre 2010 : appel des musulmans de France pour libérer les journalistes otages
- - 28 août 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un nouvel espoir en une libération prochaine pour les familles
- - 18 août 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : CLAUDY LEBRETON, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES COTES D’ARMOR ET PRESIDENT l’Assemblée des Départements de France, ECRIT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
- - 6 mois de captivité : les manifestations de mobilisation en France
- - 28 JUIN 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : mobilisation pour les 6 mois de détention, à Chambéry
- - OTAGES AFGHANISTAN : 177e jour de captivité : les soutiens se multiplient
- - 22 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes otages : Hervé Morin et Patrick de Carolis à Kaboul
- - 17 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Montauban soutient les journalistes otages
- - 14 juin 2010 - OTAGES DU MONDE : interview de Marlène MARY, membre du Conseil d’Administration de l’association Otages du Monde et déléguée régionale en PACA
- - 3 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : quand reverront-ils la France ? Une émission de la chaine parlementaire en replay
- -
 28 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENTS 150 JOURS - LES PHOTOS - LES VIDEOS - REVUE DE PRESSE
28 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENTS 150 JOURS - LES PHOTOS - LES VIDEOS - REVUE DE PRESSE - - Vendredi 21 mai - OTAGES AFGHANISTAN : les actions du we (Bretagne)
- -
 28 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, leurs portraits affichés à Rennes
28 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, leurs portraits affichés à Rennes - -
 7 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : VILLE DE BAYEUX : une banderole sur l’hôtel de ville
7 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : VILLE DE BAYEUX : une banderole sur l’hôtel de ville - -
 29 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un rassemblement à Marseille pour Hérvé et Stéphane
29 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un rassemblement à Marseille pour Hérvé et Stéphane - - 16 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Des nouvelles de Stéphane et Hervé, otages en Afghanistan (Télérama)
- - 18 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Entretien JF Julliard (Reporters sans frontières)
- - 19 Février 2010 - Otages Afghanistan : Journalistes france tv : le SNJ veut voir Hervé Morin
- - 21 février 2010 - OTAGES AFGANISTAN : Réaction de RSF après les déclaration du général Georgelin sur le coût des opérations menées pour la libération des 2 journalistes de France TV
- - 25 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : pas de "communication sur le coût" des recherches (Défense)
- - 28 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : « On ne fait pas le minimum pour les otages d’Afghanistan » (Dans le Grand Entretien de RUE 89)
- - 29 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : nouveaux rassemblements de soutien en France pour les 2 reporters de France TV
- - 8 AVRIL 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : interview de Philippe Rochot sur RTL
- - 11 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Nouvelle vidéo des deux journalistes français otages en Afghanistan
- - 11 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : une video des deux otages de France TV sur internet (FRANCE INFO)
- - 12 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Otages français : les taliban veulent procéder à un échange
- - 13 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : "La médiatisation des otages ne fait qu’augmenter leur valeur marchande". Georges Malbrunot
- - 22 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Grands reporters otages : message chaque jeudi dans les JT de France 2 et France 3
- - 25 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : 116 jours de détention pour les 2 reporters de France TV (manifestation à Montpellier)
- - 5 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Afghanistan : les journalistes en Kapisa, selon Bernard Kouchner
- - 19 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Rassemblement à Strasbourg pour les journalistes français enlevés en Afghanistan
- - 25 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Action de soutien St Brieuc / Art Rock : revue de presse
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Saint-Brieuc : les confrères de Stéphane et Hervé étaient à St Brieuc pour les soutenir, accueilli par le maire de la ville (la video)
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Saint Brieuc /Festival Art Rock : Olivia Ruiz dédie son concert aux 2 otages de France Tv
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA VILLE DE SAINT BRIEUC ET DU FESTIVAL ART ROCK (LA VIDEO DE FRANCE 3)
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : La ville de St Brieuc - Bretagne) soutient Hervé et Stéphane et affiche leur portrait
- - 20 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : HERVE ET STEPHANE - Interview L’HUMANITE : Stéphane Bern « Ils ne sont pas partis prendre des vacances en Afghanistan »
- - 20 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : La mairie de SAINT-BRIEUC (Bretagne) affiche le portrait de Stéphane et Hervé à la veille du festival ART ROCK
- - 16 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Négociations "difficiles" sur les otages français en Afghanistan
- - 28 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : soutien de la mairie de Saint-Ouen
- - 29 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : L’un des journalistes otages enseigne au Mont-Houy (Valentiennes - LA VOIX DU NORD)
- - 17 avril 2010 : OTAGES AFGHANISTAN : Les familles des otages reçues par Sarkozy
- - AVRIL 2010 - LE GROUPE DIONYSOS SOUTIENT HERVE ET STEPHANE, OTAGES EN AFGHANISTAN
- - 22 avril 2010 - OTGES AFGHANISTAN : rappel de la prise d’otages des 2 reporters deFrance TV sur les chaines du groupe tous les jeudis (la video)
- - REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DES INTERNAUTES
- - 14 avril 2010 - CREATION D’UN COMITE DE SOUTIEN POUR HERVE ET STEPHANE
- - 12 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : France Tv devrait diffuser la video des otages ce soir
- - 12 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : le SNJ-CGT de France Télévisions est inquiet
- - 8 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Les dernières nouvelles seraient rassurantes. (Video BFM TV°
- - MANIFESTATION DU 8 AVRIL : LE REPORTAGE DE FRANCE 3 Interview de Paul Nahon
- - LES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN A HERVE ET STEPHANE- 8 AVRIL 2010 à PARIS
- - 8 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Rassemblement à Paris pour deux reporters otages en Afghanistan
- - 8 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES AMIS DE STEPHANE ET HERVE
- - 29 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : MANFESTATION DE SOUTIEN A PARIS
- - 27 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Au FIGRA, un élan unanime pour ne pas oublier les journalistes de France 3 en Afghanistan
- - 29 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : NOUVELLE JOURNEE DE SOUTIEN A HERVE ET STEPHANE POJUR LE 90e JOUR DE PRISE D’OTAGE
- - 19 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : JOURNEE DE MOBILISATION DES CLUBS DE LA PRESSE POUR LES 2 REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN
- - 19 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Montpellier - 250 personnes pour soutenir les otages français retenus en Afghanistan
- - 19 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : NOUVELLE MOBILISATION A LILLE
- - 14 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Les journalistes otages en Afghanistan (Emission MEDIA LE MAG sur France 5)
- - 14 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un reportage sur MEDIA LE MAG sur France 5
- - 9 mars 2010 - OTAGES AFGNANISTAN : rassemblement à Toulouse
- - 2 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes enlevés : "preuves de vie très récentes", selon le SNJ
- - 9 mars 2010 - DES RASSEMBLEMENTS EN FRANCE POUR LE SOUTIEN AUX OTAGES EN AFGHANISTAN
- - SOUTIEN AUX JOURNALISTES OTAGES EN AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENTS DE SOUTIEN LE 9 MARS
- - 22 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Vives réactions après les propos du patron des armées sur le soût des otages
- - 22 février 2010 - Journalistes otages en Afghanistan : la polémique relancée sur le coût des recherches (L’express)
- - 16 févier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Questions médias : réflexion sur les otages journalistes (TELERAMA)
- - 28 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : près de 200 journalistes à Paris pour la liberté de la presse
- - 27 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes otages : message de Patrick de Carolis
- - 26 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN - LIBERTE DE LA PRESSE : manifestation de journalistes jeudi (Reporters sans Frontières)
- - 26 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes otages : la situation est “périlleuse”, selon Sarkozy
- - 20 janvier 2010 - POLEMIQUE JOURNALISTES - OTAGES : un communiqué de la SCAM (Société civile des auteurs multimedias) : une polémique indigne
- - 19 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : la chonique de Stéphane Guillon FRANCE INTER
- - 18 janvier 2010 - LES COMMUNIQUES EN REACTION AUX PROPOS DE L’ELYSEE CONCERNANT LES GRANDS-REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN
- - 15 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Arnaud Hamelin, Président de la Fédération française des agences de presse (et de l’agence Sunset Presse) publiait un communiqué en réaction aux propos présumés de Nicolas Sarkozy
- - 7 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : L ’UNESCO condamne les attaques contre des journalistes en Afghanistan
- - 7 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Otages France 3 : L’ire de Sarkozy - Les journalistes de la chaine choqués par les propos
- - 5 janvier 2010 - OTAGES FRANCAIS AFGHANISTAN : Nahon "optimiste" au sujet des journalistes français
- - 31 décembre 09 - OTAGES AFGHANISTAN : Deux journalistes de France Télévisions enlevés en Afghanistan
- - 31 décembre 09 - OTAGES AFGHANISTAN : Deux journalistes français enlevés en Afghanistan
-
 LES ACTIONS DE SOUTIEN
LES ACTIONS DE SOUTIEN
 LES ACTIONS DE SOUTIEN
LES ACTIONS DE SOUTIEN
-
 7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
 7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
-
 AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
 AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
-
 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
- - 19 JUILLET 2010 - OTAGES DU MONDE : interview de Jonathan BOISSAY pour le site du festival des Vieilles Charrues
- - Jean-Philippe QUIGNON, co-président du festival, adresse un message de soutien aux otages
- - MERCI AUX ARTISTES !
- - Des festivaliers solidaires !
- - Toutes les photos des Vieilles Charrues !
- - 30 DECEMBRE 2010 - OTAGES AFHANISTAN : un an de captivité des 2 journalistes français ( Interview de Martine Gauffeny, Déléguée Générale OTAGES DU MONDE, sur France 3 Bretagne)
- - 30 JUIN 2011 -MOELAN SUR MER (BRETAGNE) LE CINEMA LE KERFANY FETE LA LIBERTION D’HERE ET STEPHANE
- - 26 JUIN 2011 - SOUTIEN AUX OTAGES DU MONDE au festival des Droits Humains de L’HAY les ROSES ( Val de Marne)
- - 29 JUIN 2011 : RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LA LIBÉRATION D’HERVÉ ET STÉPHANE
- - 27 JUIN 2011 - 18 MOIS DE CAPTIVITE POUR HERVE ET STEPHANE : Un exploit sportif en Picardie pour les otages du Monde
- - 11 JUIN 2011 - Nuit de la Photo à Orange
- - 12 MAI 2011 - 500 jours - MOELAN SUR MER (BRETAGNE - 29) : le coup de pouce aux otages du cinéma LE KERFANY
- - 13 mai 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : les manifestations parisiennes
- - 12 mai 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : 500 jours de captivité - le soutien de BAYEUX
- - 12 mai 2011 - Le coup de pouce aux otages de la ville de Saint-Brieuc et des briochins (22 - Bretagne)
- - 6 MAI 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : le soutien de RUTH SOUFFLER et SANDY SCORDO, championnes de Karaté
- - 28 AVRIL 2011 - "10.000 dessins d’enfants" pour la liberté de Ghesquière et Taponier
- - 24 février 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : soutien en Amérique centrale...
- - 10 février 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : mobilisation à MIRAMAS (13 - PROVENCE)
- - 2 FEVRIER 2011 - Rassemblement à Paris pour les 400 jours de captivité d’Hervé Guesquière et Stéphane Taponier
- - 28 JANVIER 2011 - PERNES LES FONTAINES : soutien des SUBARUS lors du passage du 14ème rallye Historique de Monte Carlo
- - HERVE ET STEPHANE : RASSEMBLEMENTS PREVUS EN FEVRIER-MARS
- - 11 JANVIER 2011 -OTAGES AFGHANISTAN : UN COMITE DE SOUTIEN CREE A L ASSEMBLEE NATIONALE
- - 7 JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : A Avignon, soutien du Conseil Général
- - 29 DECEMBRE 2010 - 1 AN DE CAPTIVITE POUR HERVE ET STEPHANE : RASSEMBLEMENT A MARSEILLE
- - 29 décembre 2010 - 1 an déjà pour Hervé et Stéphane : les bretons se mobilisent à AURAY
- - 29 DECEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : ACTIONS DE SOUTIEN EN FRANCE le 29 décembre 2010 marquant l’année de détention d’Hervé Guesquière et de Stéphane Taponier
- - 25 DECEMBRE 2010 : OTAGES SAHEL ET AFGHANISTAN -REPORTAGE DE FRANCE BRETAGNE CE 25 DECEMBRE
- - 25 DECEMBRE 2010 - JOUR DE NOEL : SOUTIEN DES MONTAGNARDS AUX OTAGES
- - 23 DECEMBRE 2010 - OTAGES EN AFGHANISTAN : 80 000 SIGNATURES DE LA PETITION REMISES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
- - 14 DECEMBRE 2010 - MOELAN SUR MER (Bretagne - 29), la mairie et 32 COMMERCES AFFICHENT LES PORTRAITS D’HERVE ET STEPHANE !
- - 16 décembre 2010 - "UN DESSIN POUR LEUR LIBERTE" - PERN LES FONTAINES - (Vaucluse)
- - 16 décembre 2010 - MOELAN SUR MER - BRETAGNE (29) - OTAGES AFGHANISTAN : le soutien des sauveteurs en mer
- - 7 DECEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENT A LYON
- - 1er DECEMBRE 2010 - BAYEUX LANCE L’OPERATION "UN DESSIN POUR LEUR LIBERTE"
- - 14 décembre 2010 - SOIREE DE SOUTIEN A MOELAN SUR MER (29-BRETAGNE)
- - 24 NOVEMBRE 2010 - DES DESSINS D’ENFANTS POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN - Otages du Monde partenaire de cette action
- - 29 novembre 2010 -SOUTIEN HERVE ET STEPHANE - LILLE - Conférence- débat
- - 30 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DU MONDE DE LA VOILE A LA ROUTE DU RHUM
- - 22 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE PLOUBAZLANEC (22- BRETAGNE)
- - 25 OCT 2010 - UNE EMISSION SPECIALE SUR FRANCE E /RFI
- - 23 OCTOBRE 2010 OTAGES AFGHANISTAN - LILLE : La mobilisation s’amplifie en faveur de la libération des otages d’Afghanistan - La Voix du Nord
- - 22 OCTOBRE 2010 : OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE PLOUBAZLANEC (22- BRETAGNE)
- - 25 OCTOBRE 2010 - CONCERT DE SOUTIEN AU ZENITH
- - 8 OCTOBRE 2010 - PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANT DE GUERRE : rassemblement de soutien pour Hervé et Stéphane
- - 4 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE PAIMPOL ( BRETAGNE - 22)
- - 16 SEPTEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : soutien de la mairie de TOMBLAINE (Meurthe et Moselle)
- - 24 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : les associations de soutien reçues à l’Elysée
- - SUR LA BLOGOSPHERE...
- - 2 septembre 2010 - LE CONSEIL GENERAL DES COTES-D’ARMOR ELEVE LA BANDEROLLE DE SOUTIEN SUR SA FACADE
- - LA VILLE DE LANNION (22- BRETAGNE) AFFICHE LA BANDEROLLE DE SOUTIEN
- - 2 SEPTEMBRE 2010 - RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN A PARIS
- - STEPHANE ET HERVE : 250e JOUR DE DETENTION : RASSEMBLEMENT A PARIS
- - 23 AOUT 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LES SOUTIENS BRETONS SE MULTIPLIENT
- - 21 MAI 2010 - FESTIVAL ART ROCK A SAINT BRIEUC (22 -BRETAGNE) : LE SOUTIEN D’OLIVIA RUIZ ET DE LA MAIRIE DE SAINT-BRIEUC
- - 1 AOUT 2010 - LA NUIT DE LA PHOTO - GUIDEL (56 - BRETAGNE)
- - 6 AU 8 AOUT 2010 - FESTIVAL DU BOUT DU MONDE - CROZON (29 - BRETAGNE) - SOUTIEN AUX 2 REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN
- - VAUCLUSE - 11 JUILLET 2010 - 128 SUBARU ONT COURU POUR HERVE ET STEPHANE
- - 15 JUILLET 2010 - CONCERT DE SOUTIEN EN BRETAGNE ANNE VANDERLOVE, marraine de l’association, a chanté pour les otages du monde
- - 7 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Bayeux soutient les otages d’Afghanistan
-
- - 28 février 2014 - Hervé Ghesquière raconte aux enfants sa vie d’otage en Afghanistan
- - 23 novembre 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : FRANCE 3 - EMISSION PIECES A CONVICTION "SPECIALE AFGHANISTAN"
- - 30 août 2011 - OTAGES AGHANISTAN : Stéphane Taponier - Retour sur terre après une vie d’otage
- - TOUTES LES PHOTOS, TOUTES LES VIDEOS SUR LA LIBERATION D’HERVE ET STEPHANE
- -
12 MAI 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DES BRETONS, A MOELAN-SUR-MER
-
-
 OTAGES BANDE DE GAZA
OTAGES BANDE DE GAZA
 OTAGES BANDE DE GAZA
OTAGES BANDE DE GAZA
-
 Informations sur GILAD SHALIT, franco-Israélien
Informations sur GILAD SHALIT, franco-Israélien
 Informations sur GILAD SHALIT, franco-Israélien
Informations sur GILAD SHALIT, franco-Israélien
- - 18 octobre 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA : Le soldat Gilad Shalit dit être en bonne santé
- - 18 octobre 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA : Guilad SHALIT est arrivé en Israël après 5 an de captivité
- - 11 OCTOBRE 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA : Vers une libération de Gilad Shalit ?
- - 26 juin 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA : 5 ans de captivité de Guilad SHALIT : Nicolas Sarkhozy écrit à l’otage
- - 22 JUIN 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA - Bientôt cinq ans de captivité du soldat franco-israélien Shalit
- - 14 JUIN 2011 : OTAGE BANDE DE GAZA : Après une libération de Shalit, Paris pourrait parler au Hamas
- - 6 JUIN 2011 - Le père de Gilad Shalit dépose une plainte en France contre le Hamas
- - 8 JUIN 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA : Martine Aubry rencontre le père de Gilad Shalit
- - 8 JUIN 2011 - OTAGE BANDE DE GAZA : Gilad Shalit, l’otage oublié
- - OTAGE BANDE DE GAZA - 25 mai 2011 - Israël est incapable de localiser Gilad Shalit à Gaza
-
-
 OTAGES BENIN
OTAGES BENIN
-
 OTAGES BURKINA FASO
OTAGES BURKINA FASO
-
 OTAGES CAMEROUN
OTAGES CAMEROUN
 OTAGES CAMEROUN
OTAGES CAMEROUN
-
 2013 ELEVEMENT DE LA FAMILLE MOULIN-FOURNIER - CAMEROUN
2013 ELEVEMENT DE LA FAMILLE MOULIN-FOURNIER - CAMEROUN
 2013 ELEVEMENT DE LA FAMILLE MOULIN-FOURNIER - CAMEROUN
2013 ELEVEMENT DE LA FAMILLE MOULIN-FOURNIER - CAMEROUN
- - 20 avril 2013 - OTAGES CAMEROUN/NIGERIA : La famille Moulin-Fournier de retour en France
- - 19 avril 2013 - OTAGES CAMEROUN/NIGERIA : Otages du Nigéria libérés
- - 18 mars 2013 - OTAGES CAMEROUN / NIGERIA : Une deuxième vidéo des sept otages enlevés au Cameroun reçue par des journalistes nigérians
- - 28 février 2013 - OTAGES CAMEROUN : PARIS, France, 28 février 2013/African Press Organization (APO)/ - Quai d’Orsay - Déclarations du porte-parole
- - 27 février 2013 - OTAGES CAMEROUN : la France "ne négocie pas" dans ces conditions
- - 25 février 2013 - Vidéo des otages français au Cameroun : "Des images terriblement choquantes", selon Fabius
- - 19 février 2013 - OTAGES CAMEROUN : OTAGES CAMEROUN : Six étrangers enlevés dans le sud du Nigeria
- - 18 janvier 2015 - OTAGES CAMEROUN - Boko Haram : près de 80 otages dans une attaque au nord du Cameroun
- - 27 novembre 2014 - OTAGES CAMEROUN : Libération d’otages dans l’Est du Cameroun
- - 11 octobre 2011 - Otages Cameroun : libération de 27 otages chinois et camerounais
- - 19 mai 2014 - OTAGES CAMEROUN - Boko Haram : les otages chinois probablement emmenés au Nigeria
- - 9 avril 2014 - OTAGES CAMEROUN - Recherche des otages au Cameroun : les autorités toujours mobilisées
- - 7 JANVIER 2014 - OTAGES CAMEROUN : Des réfugiés centrafricains libèrent deux responsables du HCR-Cameroun retenus en otage (APA)
- - 17 février 2011 - OTAGES CAMEROUN : libération des otages enlevés à Bakassi
- - 1er OCTOBRE 2010 - OTAGES CAMEROUN : Amerigo Vespucci : Fin de la prise d’otages
- - 18 mai 2010 - PIRATERIE MARITIME : un marin lituanien otage au large de l’Afrique occidentale
- - 18 mars 2010 - OTAGES CAMEROUN : Les sept otages chinois libérés au Cameroun
-
-
 OTAGES CENTRAFRIQUE
OTAGES CENTRAFRIQUE
 OTAGES CENTRAFRIQUE
OTAGES CENTRAFRIQUE
- - 26 janvier 2015 - OTAGES CENTRAFRIQUE : Le ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports enlevé
- - 23 janvier 2015 - OTAGES CENTRAFRIQUE - Claudia Priest, humanitaire française retenue en Centrafrique, est libre
- - 21 JANVIER 2015 - OTAGES CENTRAFRIQUE - Centrafrique : une employée de l’ONU libérée, une humanitaire française toujours otage
- - 19 janvier 2015 - OTAGES CENTRAFRIQUE : Un troisième enlèvement en Centrafrique
- - OTAGE CENTRAFRIQUE : Une Française membre d’une ONG a été enlevée ce lundi à Bangui, en Centrafrique.
- - 27 novembre 2014 - OTAGES CENTRAFRIQUE : Centrafrique : Vingt-six otages libérés par le FDPC (source RFI)
- - 15 mars 2010 - OTAGE CENTRAFRIQUE : Libération des 2 otages français de l’ONG Triangle
- - 19 février 2010 - OTAGES CENTRAFRIQUE : plus de 10 personnes prises en otage par la LRA
- - 12 mars 2010 - OTAGES COLOMBIE ; deux otages doivent être libérés
- - 19 février 2010 - OTAGES CENTRAFRIQUE : plus de 10 personnes prises en otage par la LRA, selon une source militaire
-
 OTAGES COLOMBIE
OTAGES COLOMBIE
 OTAGES COLOMBIE
OTAGES COLOMBIE
-
 ROMEO LANGLOIS, Journaliste français otage en Colombie 2012
ROMEO LANGLOIS, Journaliste français otage en Colombie 2012
 ROMEO LANGLOIS, Journaliste français otage en Colombie 2012
ROMEO LANGLOIS, Journaliste français otage en Colombie 2012
- - 12 février 2013 _ OTAGE COLOMBIE : Roméo Langlois Roméo Langlois Sophie Daret MEDIAS - Le journaliste Roméo Langlois raconte dans un livre, « Jungle Blues », sa captivité en Colombie...
- - 27 juin 202 - OTAGES COLOMBIE : Arrestation d’une femme impliquée dans l’enlèvement de Roméo Langlois
- - 20 JUIN 2012 - OTAGES COLOMBIE : DIFFUSION DU REPORTAGE DE ROMEO LANGLOIS : " A BALLES REELLES"
- - 1er février 2012 - OTAGE COLOMBIE : Le journaliste Roméo Langlois est arrivé en France
- - 30 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE - LIBERATION DE ROMEO LANGLOIS
- - 28 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Une chaîne de télévision diffuse des images de Langlois en captivité
- - 27 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Roméo Langlois libéré mercredi ?
- - 23 mai 2012 - OTAGES COLOMBIE - Roméo Langlois : la France espère que sa capture ne devienne pas un "enlèvement"
- - 30 avril 2012 - OTAGE COLOMBIE - Colombie : Roméo Langlois | Le possible Silence des Farc (VIDEO U TUBE)
- - 10 mai 2012 - OTAGES COLOMBIE : La communication, l’autre guerre de la guérilla des Farc en Colombie (article EL WATAN)
- - 10 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : le journaliste français dans une impasse
- - 9 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Roméo Langlois : un échange humanitaire proposé
- - 8 mai 2012 - OTAGES COLOMBIE - Un "débat" en échange de Roméo Langlois ?
- - 7 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : message ambigu des Farc sur le sort du journaliste Langlois
- - 6 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Sur Twitter, LES FARC annoncent la libération rapide de Romeo Langlois, sain et sauf (source Patria Grande)
- - 6 mai 2012 - OTAGES COLOMBIE - un espoir pour Roméo Langlois
- - 6 MAI 2012 - OTAGE COLOMBIE - - Roméo Langlois : les Farc revendiquent sa capture dans une vidéo
- - 6 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Les FARC confirment qu’ils détiennent Roméo LANGLOIS
- - 5 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Roméo Langlois, un journaliste qui défend la vérité -Par Atenco Edition : Les Autres Amériques
- - 5 mai 2012 - OTAGES COLOMBIE : L’enlèvement d’un Français en Colombie ravive les interrogations sur la stratégie des Farc (Nouvel Observateur)
- - 2 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : Le ministère de la Justice colombien estime qu’on ne peut parler de "prisonniers de guerre " en Colombie
- - 2 mai 2012 _ OTAGES COLOMBIE : L’armée colombienne n’interviendra pas pour libérer Langlois
- - 2 mai 2012 - OTAGE COLOMBIE : le journaliste français « prisonnier de guerre » ?
- - 29 avril 2012 - OTAGES COLOMBIE : Un journaliste français porté disparu en Colombie
- - 30 avril 2012 - OTAGE FRACAIS COLOMBIE :reportage de la télévsion colombienne RADIO CARACOL
- - 30 avril 2012 - OTAGE COLOMBIE : Roméo Langlois otage des FARC : « Pas de certitude absolue », selon Juppé
- - 29 avril 2012 - OTAGE COLOMBIE : Roméo Langlois, un fin connaisseur des Farc ( Nouvel obs/AFP)
- - 30 avril 2012 - OTAGE FRANCAIS COLOMBIE : La Colombie demande aux Farc de libérer Roméo Langlois
- - 28 avril 2012 - OTAGE COLOMBIE : Un journaliste français fait prisonnier par les FARC en Colombie
-
 Juillet 08 - OTAGES COLOMBIE
Juillet 08 - OTAGES COLOMBIE
 Juillet 08 - OTAGES COLOMBIE
Juillet 08 - OTAGES COLOMBIE
-
 Opération EMMANUEL décembre 07 : tentative de libération de Clara Rojas, son fils et la sénatrice Gonsalez Perdomo
Opération EMMANUEL décembre 07 : tentative de libération de Clara Rojas, son fils et la sénatrice Gonsalez Perdomo
 Opération EMMANUEL décembre 07 : tentative de libération de Clara Rojas, son fils et la sénatrice Gonsalez Perdomo
Opération EMMANUEL décembre 07 : tentative de libération de Clara Rojas, son fils et la sénatrice Gonsalez Perdomo
- - 29 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : Libération des 3 otages : les pays et organismes garant de la mission (Infographie)
- - 15 novembre 07 - OTAGES COLOMBIE : FRANCE 24 - L’interview de H. Chavez, président du Vénézuela, à propos des négociations avec les FARC pour l’échange de prisonniers
- - 23 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : Libération de trois otages des Farc : Piedad Cordoba craint des complications
- - 23 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : Bogota ne veut pas interférer dans la libération des trois otages des Farc
- - 21 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE les FARC confirment leur intention de libérer trois otages
- - 18 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : Les FARC ont donné l’ordre de libérer un groupe d’otages (agence cubaine)
- - 17 décembre 07 - OTAGES SOMALIE : les ravisseurs ont déplacé le journaliste enlevé (chef coutumier)
- - 23 novembre 2014 - OTAGES COLOMBIE : La libération des otages des Farc prend un retard inquiétant
- - 21 novembre 2014 OTAGES COLOMBIE : Un membre des Farc extradé pour enlèvement d’Américains
- - 2& novembre 2014 - OTAGES COLOMBIE :: la libération des otages "est en cours"
- - 19 novembre 2014 - OTAGES COLOMBIE :
- - 17 novembre 2014 - OTAGES COLOMBIE : Otages Colombie : l’UE demande aux Farc de libérer les otages immédiatement et sans conditions
- - 5 janvier 2014 - LES DISPARITIONS EN COLOMBIE : L’affaire MARC BELTRA, français disparu en décembre 2003, àla frontière de la Colombie et du Brésil
- - 29 SEPTEMBRE 2013 - OTAGE COLOMBIE : Jesse Jackson accepte d’aider à la libération d’un otage américain
- - 28 août 2013 - OTAGES COLOMBIE : Claman al Eln por la liberación del ingeniero secuestrado en Antioquia (Ils demande à L’ELN la libération de l’ingéneiur enlevé à Antioquia)
- - 15 juin 2013 - OTAGES COLOMBIE : Colombie : deux otages libérés Les deux touristes espagnols avaient été enlevés le 17 mai dans le nord du pays.
- - 1 juin 2012 - COLOMBIE - Les Farc en Colombie sont-elles toujours une menace ?
- - 5 septembre 2012 - COLOMBIE : La Colombie ouvre des négociations avec les Farc - Interview ROMEO LANGLOIS ( France culture)
- - 3 avril 2012 - OTAGES COLOMBIE : Colombie. En images : les Farc ont libéré leurs plus anciens otages (LE TELEGRAMME)
- - 2 avril 2012 - OTAGES COLOMBIE : les plus anciens otages des Farc ont retrouvé la liberté
- - 2 avril 2012 - OTAGES COLOMBIE : À la rescousse des otages des Farc
- - 24 Mars 2012 - OTAGES COLOMBIE : Incertitude sur la date de libération des otages des Farc
- - 21 mars 2012 - OTAGES COLOMBIE : Les Farcs vont relâcher leurs otages
- - 6 mars 2012 - OTAGES COLOMBIE : Les Colombiens attendent la libération des otages des Farc (JOURNAL LA CROIX)
- - 26 février 202 - OTAGES COLOMBIE : La guérilla des Farc renonce aux enlèvements de civils en Colombie
- - 6 décembre 2011 - OTAGES COLOMBIE : Arrivée à Bogota de la Caravane de la Liberté, pour la libération de tous les otages détenus par les guérillas
- - Samedi 26 novembre 2011 - OTAGES COLOMBIE : 4 militaires exécutés par la guérilla des FARC
- - 26 novembre 2011 - OTAGES COLOMBIE - CARAVANE DE LA LIBERTE : arivée à Bogota le 6 décembre 2011
- - 15 novembre 2011 - OTAGES COLOMBIE : 7000 km pour rappeler le sort des otages
- - 5 NOVEMBRE 2011 - OTAGES CLOMBIE : Alfonso Cano, dernier chef historique des Farc, a été tué
- - 31 octobre 2011 -EX- OTAGE CLOMBIE : Un ancien otage des FARC devient gouverneur d’un état colombien
- - 18 octobre 2011 - OTAGES COLOMBIE : une otage de 10 ans libérée
- - 5 OCTOBRE 2011 - OTGES COLOMBIE :
- - 30 juillet 2011 - OTAGES COLOMBIE : Cinq employés d’une entreprise pétrolière enlevés
- - 19 juillet 2011 - OTAGES COLOMBIE : libération de deux hommes politiques pris en otage
- - 9 JUIN 2011 - OTAGES COLOMBIE : 3 Chinois enlevés par les FARC
- - 9 JUIN 2011 - OTAGES DU MONDE : trois employés chinois d’une entreprise pétrolière enlevés
- - 30 mai 2011 - OTAGES COLOMBIE : Bogota rejette une offre des Farc
- - 11 mars 2011 - OTAGES COLOMBIE : expulsion de toute société qui payera des rançons
- - 16 FEVRIER 2011 - OTAGES COLOMBIE : deux otages libérés par la guérilla des FARC
- - 13 FEVRIER 2011 - OTAGES COLOMBIE : Polémique autour d’une nouvelle libération d’otages en Colombie
- - 13 février 2011 - OTAGES COLOMBIE : de nouvelles libérations d’otagres des FARC attendues ce dimanche
- - 31 JANVIER 2010 - OTAGES COLOMBIE : La libération de cinq otages des FARC annoncée pour jeudi et dimanche prochain
- - 21 JANVIER 2011 - OTAGES COLOMBIE : une personne libérée par l’ELN remise au CICR à Choco
- - 7 janvier 2011 - OTAGES COLOMBIE : les Farc lancent une nouvelle attaque et un message politique
- - 3 JANVIER 2011 - OTAGES COLOMBIE : Betancourt demande aux Farc de libérer les otages
- - 27 DECEMBRE 2010 -OTAGES COLOMBIE - DES MILLIERS DE DEPLACES (VIDEO)
- - 23 septembre 2010 - OTAGES COLOMBIE : Le chef militaire des Farc tué au combat en Colombie
- - 29 JUILLET 2010 - OTAGES COLOMBIE : La guérilla des Farc propose un dialogue au président colombien élu Santos
- - 14 juin 2010 - OTAGES COLOMBIE : un quatrième otage des Farc libéré depuis dimanche
- - 14 JUIN 2010 - OTAGES COLOMBIE : EUPHORIE AU FOYER DU GENERAL MENDIETA, OTAGE LIBERE APRES 12 ANS DE CAPTIVITE
- - 14 juin 2010 - OTAGES COLOMBIE : Así fue la exitosa operación que permitió el rescate de Mendieta, Murillo y Delgado
- - OTAGES COLOMBIE : LES FREQUENCES RADIOS POUR ECOUTER L’EMISSION LAS VOCES DEL SECUESTRO
- - 14 janvier 2010 - CLARA ROJAS - EX OTAGE COLOMBIE : Le retour de Clara Rojas à la vie politique (Interview en espagnol sur Radio Caracol)
- - 4 mars 2010 - OTAGES COLOMBIE : l’absence obsédante pour des dizaines d’enfants d’otages
- - Janvier 2010 - OTAGES COLOMBIE : LAS VOCES DEL SECUESTRO : le fondateur de la radio colombienne pour les otages menacé de mort
- - 28 décembre 09 - OTAGES COLOMBIE : L’Eglise propose aux FARC de négocier sur le sol européen
- - 3 février 09 - OTAGES COLOMBIE : Les FARC de Colombie ont libérés le politicien Alan Jara, retenu en otage pendant plus de 7 ans
- - Novembre 2009 - CARAVANE POUR LA LIBERTE : le cicuit des motards de la Liberté
- - 28 octobre 09 - OTAGES COLOMBIE : ’Cordoba asked France to allow FARC to open office in Paris’
- - 20 avril 09 - OTAGES COLOMBIE : Clara Rojas dans On est pas couché (Ruquier)
- - OTAGES COLOMBIE : EXTRAIT DE CAUTIVERIO
- - OTAGE COLOMBIE : une liste des séquestrés sur "las voces del secuestro"
- - 27 décembre 07 - DROGUE COLOMBIE : reportage de France 24 : les damnés de la coca
- - OTAGES COLOMBIE : « NE PLUS ACCEPTER L’INACCEPTABLE ! » par Patricia Mamet-Soppelsa, membre du bureau d’Otages du Monde
- - 17 décembre 07 - OTAGES COLOMBIE : Le Venezuela servirait de "sanctuaire" à plusieurs camps des FARC (El Pais)
- - OTAGES COLOMBIE - 2007 - RFI : une initiative pour parler aux otages colombiens
- - 5 juin 07 - LE PIEGE COLOMBIEN, reportage de Patricia Allemonière, grand-reporter
- - 2 juillet 07 -COLOMBIE : un reportage de France 24 sur l’économie de la drogue en Colombie
- - Un dossier de l’Express sur les FARC
- - Janvier 2006 - Déclaration de Mr Philippe Douste-Blazy sur le problème des otages en Colombie
-
-
 OTAGES COREE DU NORD
OTAGES COREE DU NORD
-
 OTAGES COTE-D’IVOIRE
OTAGES COTE-D’IVOIRE
 OTAGES COTE-D’IVOIRE
OTAGES COTE-D’IVOIRE
- - 3 juin 2011 - OTAGES COTE-IVOIRE : Côte d’Ivoire : le directeur du Novotel d’Abidjan "torturé" ?
- - 29 MAI 2011 - OTAGES COTE IVOIRE : OTAGES COTE D’IVOIRE : Des miliciens ayant participé au rapt d`étrangers à Abidjan ont été arrêtés
- - 20 mai 2011 - OTAGES COTE-IVOIRE :Les hôtels de paix...et l’enlèvement de Stéphane Frantz Di Rippel, au Novotel d’Abidjan (Rédigé par Pierre-Olivier Sur, avocat à la Cour
- - 6 avril 2011 - OTAGES COTE-D’IVOIRE : un maloin parmi les otages français
- - 3 mai 2011 - OTAGES COTE D’IVOIRE : Otages français en Côte d’Ivoire : toujours aucune piste
-
 OTAGES EN HAITI
OTAGES EN HAITI
 OTAGES EN HAITI
OTAGES EN HAITI
- - 12 mars 2010 - OTAGES HAITI : enlèvement puis libération d’une employée belge de MSF
- - 8 janvier 2010 - OTAGES HAITI : Les autorités policières assurent avoir consolidé le climat sécuritaire en 2009
- - 2 mai 2008 - OTAGE HAITI : la libération de M. Jean-Michel Maurin, coopérant français,( Déclaration Bernard Kouchner)
- - 4 avril 08 - OTAGES HAITI : Kidnapping : Deux otages libérés à Pétion-Ville
- - 19 mai 2008 - OTAGES HAITI : un fonctionnaire français pris en otage
- - 14 décembre 07 - OTAGES HAITI : Environ 200 personnes enlevées en Haïti en 2007, selon l’ONU
-
 OTAGES EN IRAK
OTAGES EN IRAK
 OTAGES EN IRAK
OTAGES EN IRAK
- - 7 juin 2014 - OTAGES IRAK - Ramadi : l’EIIL s’empare de l’université et prend des otages
- - 12 mars 2010 - OTAGES IRAK : un ex-otage évoque les tortures (Le Figaro)
- - 1 janvier 2020 - OTAGE IRAK : L’ex-otage Peter Moore rentre aujourd’hui en Grande-Bretagne
- - 30 juillet 2009 - OTAGES IRAK : des craintes pour la vie des otages britanniques en Irak (video/ article en anglais Times on Line)
- - Article de l’Express : Otages d’Irak, la stratégie de l’innommable par Alain Louyot
- - IRAK : série noire de massacres et enlèvements - Juin 2006
-
 OTAGES GUINEE
OTAGES GUINEE
-
 OTAGES IRAN
OTAGES IRAN
 OTAGES IRAN
OTAGES IRAN
- - Nouvel article16 mai 2010 - Reportage EUROPE 1 : Le Sénégal accuse l’Elysée
- - 17 mai 2010 - OTAGE IRAN : Libération de Clotilde Reiss : la revue de presse
- - 16 mai 2010 - OTAGE IRAN : Clotilde Reiss de retour
- - 11 février 2010 - OTAGES IRAN : Clotilde Reiss “échangée” contre l’assassin de Chapour Bakhtiar ?
- - 4 décembre 09 - OTAGES IRAN : Les cinq Britanniques à Dubaï, "soulagés" après 7 jours de détention en Iran (France 24 - Video)
- - 22 septembre 09 - OTAGE IRAN : Ahmadinejad évoque un échange de prisonniers pour libérer Clotilde Reiss
- - 29 juillet 09 - OTAGE IRAN : APPEL A LA LIBERATION DE CLOTHILDE REISS
- - 3 juillet 08 - OTAGES ISRAEL : Pour l’Iran, les otages de 82 sont vivants
-
 OTAGES KENYA
OTAGES KENYA
 OTAGES KENYA
OTAGES KENYA
- - 29 juin 2012 - OTAGES KENYA : quatre humanitaires étrangers enlevés, leur chauffeur kényan tué
- - 23 octobre 2011 - OTAGE KENYA/SOMALIE : UNE PETITION lancée par des amis de Marie DEDIEU : demande d’éclaircissements sur les circonstances de sa mort en captivité
- - 18 octobre 2011 - OTAGES KENYA : Le Kenya hanté par le spectre des enlèvements de touristes
- - 20 SEPTEMBRE 2011 - OTAGE KENYA : Transfert d’un otage britannique, en Somalie
- - OTAGES KENYA - 12 SEPTEMBRE 2011 - Un Britannique tué et un autre enlevé près de Lamu au Kenya
- - 3 OCTOBRE 2011 - OTAGE KENYA - Enlèvement d’une Française : un employé de maison arrêté
- - 3 OCOBRE 2011 - OTAGE KENYA/SOMALIE : Enlèvement de Marie Dedieu : La DGSE participe à l’enquête (France-Soir)
- - 30 SEPTEMBRE 2011 - OTAGES KENYA : une ressortissante française a été enlevée en face de l’île de Lamu
-
 OTAGES LIBAN
OTAGES LIBAN
-
 OTAGES LYBIE
OTAGES LYBIE
 OTAGES LYBIE
OTAGES LYBIE
-
 Infirmières bulgares
Infirmières bulgares
 Infirmières bulgares
Infirmières bulgares
- - 12 juillet 07 - INFIRMIERES BULGARES : « Mme Sarkozy devrait témoigner »
- - 6 octobre 07 - OTAGES LYBIE : Une infirmière bulgare : "Khadafi avait besoin d’otages vivants"
- - 24 août 07 - Infirmières Bulgares : "Cecilia doit parler..." chronique de Christophe Barbier dans l’EXPRESS
- - Juillet 07 -LA LIBERATION DES INFIRMIERES BULGARES
- - OTAGES LYBIE - 7 février 2014 - Libération de deux Italiens enlevés en janvier
- - 5 juin 2010 - OTAGE LYBIE : Max Göldi espère vivre ses derniers jours d’otage à Tripoli
- - 20 avril 2010 - OTAGES LYBIE : l’ex-otage suisse, Rachid Hamdani, sort de son silence
- - 18 mars 2010 - OTAGES LYBIE : Amnesty International a lancé mercredi dans le monde entier une action urgente en faveur de la libération immédiate du Suisse Max Göldi par la Libye.
- - OTAGES LYBIE ; LE RETOUR DE L’ OTAGES SUISSE - ITV Jean-Louis Normandin, vice-président d’OTAGES DU mONDE (TV SUISSE TSR1)
- - 8 janvier 2010 - OTAGES LYBIE : L’un des avocats des infirmières bulgares défendra les deux Suisses
- - 3 janvier 10 - OTAGES LYBIE : Le procès de l’otage suisse en Libye Rachid Hamdani a été reporté, comme celui de Max Göldi samedi
- - 10 décembre 09 - OTAGES LYBIE : Message des otages suisses en Lybie
- - 16 décembre 09 - OTAGES LYBIE : Campagne de solidarité avec les Suisses retenus en Lybie - les organisations des droits humains demandent leur libération
-
-
 OTAGES MADAGASCAR
OTAGES MADAGASCAR
-
 OTAGES MEXIQUE
OTAGES MEXIQUE
 OTAGES MEXIQUE
OTAGES MEXIQUE
- - 1er octobre 2013 - OTAGES MEXIQUE : 73 otages secourus par la police
- - 16 octobre 2012 - OTAGE MEXIQUE : soutien d’ODM à l’otage suisse Olivier Tschumi
- - 25 juin 2012 : concert de soutien à l’otage suisse OLIVIER TSCHUMI en l’Eglise Notre Dame de Passy à PARIS
- - 25 JUIN 2012 - OTAGE MEXIQUE - UN CONCERT DE SOUTIEN A PARIS POUR L’OTAGE SUISSE OLIVIER TSCHUMI
- - 265 octobre 2011 - OTAGE MEXIQUE : Ressortissant suisse enlevé au Mexique : la famille continue à se battre (source 24 H - Suisse)
- - 24 JUILLET 2011 - OTAGE MEXIQUE : Frédérique Santal tremble pour son frère enlevé
- - 10 septembre 09 - OTAGES MEXIQUE : prise d’otages dans un avion à Mexixo
-
 OTAGES MOZAMBIQUE
OTAGES MOZAMBIQUE
-
 OTAGES NIGERIA
OTAGES NIGERIA
 OTAGES NIGERIA
OTAGES NIGERIA
- - 24 janvier 2015 - OTAGES NIGERIA : Boko Haram libère 190 otages au Nigeria
- - 21 janvier 2015 - OTAGE NIGERIA - Libération de Nitsch Eberhard Robert, citoyen allemand, enlevé en juillet 2014 au Nigeria par Boko Haram
- - 16 novembre 2014 - OTAGE NIGERIA : L’ex-otage, Francis Collomp, un an après son évasion : "Je ne suis pas complètement libre" (Interview Outremer 1ere La réunion)
- - 17 août 2014 - OTAGES NIGERIA : 85 otages de Boko Haram libérés
- - 10 août 2014 - OTAGES NIGERIA : nouveau rapt massif par Boko Haram dans le Nord
- - 7 juillet 2014 : OTAGES NIGERIA : des images des reporters de Marie-Claire sur la route pour Chibok
- - 6 juillet 2014 - Otages Nigeria : 63 femmes otages échappent à leurs ravisseurs islamistes
- - 10 juin 2014 - OTAGES NIGERIA : 20 nouvelles femmes enlevées
- - 27 mai 2014 - OTAGES NIGERIA : Les jeunes filles enlevées par Boko Haram ont été localisées
- - 13 MAI 2014 OTAGES NIGERIA RASSEMBLEMENT DE SOUTIENA PARIS
- - 12 MAI 2014 OTAGES NIGERIA / Boko Haram montre les jeunes filles otages
- - 3 mai 2014 - OTAGES NIGERIA - Mobilisation en faveur des lycéennes nigérianes
- - 26 MARS 2014 - NIGERIA : Témoignage du Père Georges Vandenbeusch, ex-otage de Boko Haram
- - OTAGES NIGERIA : Laurent Fabius voit dans la vidéo de l’otage Francis Collomp "un appel à discussion"
- - 20 juin 2013 - OTAGE FRANCAIS NIGERIA : Libération de Benjamin Elman, otage depuis le 13 juin 2013
- - 10 mars 2013 - OTAGES NIGERIA // La mort des sept otages étrangers au Nigeria se confirme
- - 23 août 2012 - OTAGES NIGERIA : libération de 4 otages enlevés debut août 2012
- - 9 mars 2012 - OTAGES NIGERIA : Le groupe islamiste Boko Haram nie toute implication dans la mort de deux otages italien et britannique tués
- - 8 MARS 2012 - OTAGES NIGERIA : deux otages britannique et italien tués
- - 29 février 2012 - OTAGES NIGERIA : Des pirates font 2 otages au large du Nigeria
- - 11 décembre 2010 - OTAGES NIGERIA - (syndrome de Stockholm) A Canadian taken from an oil rig off the coast of Nigeria talks about his nine-day ordeal, expressing sympathy for his captors even though they shot him
- - 18 AOUT 2011 - OTAGES NIGERIA - Rançon "conséquente" pour le père de Mikel, footballeur du club de Chelsea FC
- - 4 AOUT 2011 - OTAGES NIGERIA : le rôle d’Aqmi en question dans la prise d’otage des deux Européens
- - 16 mars 2007 - OTAGES NIGERIA : Libération du français
- - 8 février 2007 - OTAGES NIGERIA : OTAGES NIGERA : Une Philippine et un Français enlevés
- - 9 février 2007 - OTAGES NIGERIA : Deux otages italiens , Francesco Arena et Cosma ROUSSO et témoignent (RFI)
- - 13 MAI 2011 - OTAGE NIGERIA : Un Britannique et un Italien enlevés au Nigeria
- - 17 NOVEMBRE 2010 - OTAGES NIGERIA : DEUX FRANCAIS LIBERES
- - 18 novembre 2010 - OTAGES NIGERIA : les deux otages enlevés le 8 nov libérés
- - 24 septembre 2010 - OTAGES NIGERIA : "Sur le marché de l’otage, le Français est bien coté"
- - 23 septembre 2010 - OTAGES NIGERIA : l’exploitant du navire déjà pris pour cible
- - 23 septembre 2010 - OTAGES NIGERIA : Les otages français au Nigeria localisés par le mouvement séparatiste Mend
- - 24 avril 2010 - OTAGES NIGERIA : Deux otages allemands libérés au Nigeria
- - 14 avril 2010 - OTAGES NIGERIA : quatre otages étrangers libérés
-
 OTAGES PAKISTAN
OTAGES PAKISTAN
 OTAGES PAKISTAN
OTAGES PAKISTAN
- - 26 décembre 2013 - OTAGE PAKISTAN - Diffusion d’une video de l’otage américain Warren Weinstein
- - 29 avril 2012 - OTAGE PAKISTAN : Assassinat du délégué du CICR enlevé
- - 30 avril 2012 - OTAGE PAKISTAN : le CICR avait eu des contacts avec les ravisseurs de Khalil Dale
- - 17 mars 2012 - OTAGES PAKISTAN - La Suisse dément toute rançon
- - 15 mars 2012 - OTAGES SUISSE AU PAKISTAN : évasion ou libération ?
- - 15 mars 2012 - OTAGES PAKISTAN : Les ex-otages suisses ont échappé aux talibans
- - OTAGES PAKISTAN : Nouvelles images des otages suisses
- - 15 JUILLET 2011 - OTAGES SUISSES AU PAKISTAN : L’enquête sur les otages au Pakistan piétine, le DFAE sur les dents (La Tribune de Genève)
-
 OTAGES PEROU
OTAGES PEROU
-
 OTAGES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ( RDC)
OTAGES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ( RDC)
 OTAGES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ( RDC)
OTAGES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ( RDC)
- - CONGO (EX BELGE) : Il y a 50 ans les paras belges sautaient sur Stanleyville
- - OTAGE RDC - 1er septembre 2014 - Une employée de MSF otage depuis plus d’un an enfin libre
- - 11 juillet 2014 OTAGES République démocratique du Congo : “Tous ensemble pour libérer les otages”, plaide MSF
- - 9 Avril 2014 - République Démocratique du Congo (RDC) : République Démocratique du Congo : Médecins sans Frontières (MSF) inquiet pour des otages
- - 19 octobre 2013 - OTAGES RDC - Trois prêtres catholiques de Mbau otages des hommes armés depuis une année
- - 18 octobre 2013 - OTAGES RDC - Nord-Kivu : 21 pêcheurs pris en otage par des présumés FDLR sur le lac Edouard
- - 17 OCT 2013 / OTAGES RDC : 4 femmes otages des FDLR depuis 9 ans échappent à leurs ravisseurs
- - 13 avril 2010 - OTAGES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : 8 agents du CICR, dont un Suisse enlevés par des miliciens dans l’est
-
 OTAGES RUSSIE
OTAGES RUSSIE
-
 OTAGES SAHEL (NIGER- MALI- MAURITANIE - SUD-ALGERIE)
OTAGES SAHEL (NIGER- MALI- MAURITANIE - SUD-ALGERIE)
 OTAGES SAHEL (NIGER- MALI- MAURITANIE - SUD-ALGERIE)
OTAGES SAHEL (NIGER- MALI- MAURITANIE - SUD-ALGERIE)
-
 OTAGES ALGERIE
OTAGES ALGERIE
 OTAGES ALGERIE
OTAGES ALGERIE
- - 23 décembre 2014 - OTAGES ALGERIE - L’assassin d’Hervé Gourdel tué par l’armée algérienne
- - 21 novembre 2011 - OTAGES ALGERIE : Nouvelles révélations : 2,6 millions de dollars largués par avion pour libérer les marins du Blida (DNA Dernières Nouvelles d’Algérie)
- - 21 novembre 2011 - OTAGES ALGERIE : Affaire du rapt des touristes allemands Le procès renvoyé au 16 janvier 2012
- - 15 novembre 2011 - OTAGE ALGERIE : un médecin enlevé à Tizi Ouzou
- - 29 MAI 2011 - OTAGES ALGERIE - le phénomène prend de l’ampleur : 117 kidnapping en 2010
- - OTAGES SAHEL - 19 mai 2011 - L’otage italienne d’Aqmi est "vivante"
- - 21 FEVRIER 2011 - OTAGE ITALIENNE AU SAHEL ; Al Arabiya diffuse une revendication audio d’Al Qaîda
- - 4 FEVRIER 2011 - OTAGE ALGERIE : Une Italienne enlevée par des hommes en armes dans le sud de l’Algérie
- - 7 JUILLET 2010 - OTAGES ALGERIE : Après l’enlèvement d’un jeune entrepreneur à Fréha (Tizi Ouzou), la mobilisation citoyenne s’accentue
- - 31 mai 2010 - OTAGES ALGERIE : SÉQUESTRÉ PAR DES TERRORISTES DURANT 23 JOURS À BAGHLIA
- - 19 mai 2010 - OTAGE ALGERIE : Un citoyen kidnappé à Béni Zmenzer
- - 17 octobre 2010 - OTAGE ALGERIE : Les terroristes cèdent à la pression populaire
- - 7 février 2010 - OTAGES ALGERIE : La Grande-Bretagne donne l’alerte
- - 9 janvier 2010 - OTAGE ALGERIE : BOUIRA - L’ingénieur kidnappé retrouvé vivant
- - 7 janvier 2010 - RANÇONS OTAGES : L’Espagne appuie l’idée algérienne d’interdire le paiement de rançons aux terroristes
- - 7 janvier 2010 - OTAGES ALGERIE : un ingénieur kidnappé dans la province de Bouira
-
 OTAGES MALI
OTAGES MALI
 OTAGES MALI
OTAGES MALI
-
 OTAGE MALI : Philippe Verdon, otage au Mali , capturé en novembre 2011 - Exécuté par ses ravisseurs
OTAGE MALI : Philippe Verdon, otage au Mali , capturé en novembre 2011 - Exécuté par ses ravisseurs
 OTAGE MALI : Philippe Verdon, otage au Mali , capturé en novembre 2011 - Exécuté par ses ravisseurs
OTAGE MALI : Philippe Verdon, otage au Mali , capturé en novembre 2011 - Exécuté par ses ravisseurs
- - 22 août 2013 - OTAGES SAHEL : En Dordogne, un hommage à Philippe Verdon, l’otage exécuté au Mali
- - 22 août 2013 - OTAGE SAHEL : une cérémonie en hommage à Philippe Verdon
- - JUILLET 2013 - DECES DE PHILIPPE VERDON, OTAGE AU SAHEL : LES PRECISIONS APPORTEES PAR SON PERE SUR LE SITE DU COMITE DE SOUTIEN
- - OTAGE NIGER : L’Elysée confirme la mort de l’otage Philippe Verdon
- - 14 juillet 2013 - OTAGE SAHEL : Mali : le corps de l’otage français Philippe Verdon retrouvé près de Tessalit
- - 20 mars 2013 - OTAGE MALI : Aqmi annonce l’exécution de l’otage Philippe Verdon - Prudence du côté du Quay d’orsay et du comité de soutien
- - 19 mai 2014 - OTAGES MALI : Paris réclame la libération des otages à Kidal
- - 18 mai 2014 - OTAGES MALI - 6 morts dans des affrontements à Kidal, environ 30 otages
- - 17 avril 2014 - OTAGES MALI - cinq otages humanitaires libérés }}
- - 11 février 2014 - Otages Nord-Mali : le Mujao revendique l’enlèvement des cinq employés du CICR
- - OTAGES MALI - 25 novembre 2013 - trois otages enlevés il y a deux ans toujours retenus par les jihadistes
- - 2 novembre - MALI : 2 journalistes de RFI assassinés par leurs ravisseurs à Kidal - La colère et l’émotion à la rédaction de RFI
- - 2 nov 2013 - OTAGES MALI 6Journalistes français de RFI tués au Mali : ce que l’on sait
- - 2 novembre 2013 - OTAGES MALI : Mali : deux journalistes français exécutés
- - 15 avril 2013 - OTAGE SUISSE AU MALI : Une Suissesse enlevée dans le Nord
- - 30 août 2012 : Comment a évolué le dossier malien depuis janvier 2012 ? (France Culture)
- - 21 août 2012 - OTAGES MALI : Al-Jazeera interviewe des occidentaux enlevés par AQMI
- - 12 juin 2012 - OTAGES MALI : La France et le Niger inquiets par la menace jihadiste dans le nord du Mali (PAR RFI)
- - 11 juin 2012 - OTAGES MALI - Rassemblement de soutien à Philippe Verdon et Serge Lazarevic
- - 17 mai 2012 - OTAGE SAHEL : Un otage espagnol menacé d’exécution par des islamistes au Mali
- - 2 mai 2012 — OTAGES MALI : Deux demandes de rançon pour libérer des otages Européens et Algériens
- - 25 AVRIL 2012 - OTAGE MALI : Libération de l’otage suisse enlevée dans le Nord Mali le 15 avril
- - 24 abril 2012 - OTAGE MALI - L’otage suisse enlevée dans le nord du Mali libérée et évacuée au Burkina
- - 7 avril 2012 - OTAGES FRANCAIS AU SAHEL / Mali : la France ne doit pas oublier ses otages (comité de soutien)
- - 15 avril 2012- OTAGES MALI : Aqmi diffuse une vidéo des deux Français capturés au Mali en novembre dernier
- - 4 avril 2012 - MALI : Paris conseille aux Français de quitter le Mali
- - 3 mars 2012 - OTAGES MALI : Arrivée à Bamako du ministre espagnol des affaires étrangères
- - 24 février 2012 - OTAGES MALI : il y a cent jours l’enlèvement de Philippe Verdon et Serge Lazarevic
- - 18 janvier 2012 - OTAGES AU MALI - Création d’un comité de soutien pour Philippe Verdon et Serge Lazarevic
- - 5 janvier 2012 - OTAGES FRANCAIS AU MALI (Philippe Verdon et Serge Lazarevic) - la parole aux victimes (Blog Good Morning Africa)
- - 28 novembre 2011 - OTAGES MALI - Emoi sur le sort du touriste néerlandais enlevé au Mali
- - 27 novembre 2011 - OTAGES COLOMBIE : Enlèvement au Mali : une voiture des ravisseurs des deux Français "localisée"
- - 24 novembre 2011 - OTAGES MALI - Des soldats français à la recherche des otages (LE PARISIEN)
- - 24 novembre 2011 - OTAGES MALI : Alain Juppé confirme l’enlèvement des deux Français
- - 24 novembre 2011 - OTAGES MALI : deux géologues français enlevés dans le nord du pays
- - 26 avil 2011 - MALI : Le gouvernement rassure sur la sécurité sur son territoire
- - 18 avril 2011 - OTAGES MALI : des risques importants de prise d’otages selon l’ambassade de France
- - 24 août 2010 : OTAGES ESPAGNOLS MALI : Les deux otages espagnols retenus au Mali sont arrivés à Barcelone
- - 23 août 2010 - OTAGES MALI : le gouvernement espagnol recommande prudence et discrétion jusqu’à la fin du processus de libération des deux otages humanitaires
- - 23 août 2010 - OTAGES MALI : Al Qaïda au Maghreb islamique relâche deux otages espagnols
- - 14 août 2010 - OTAGE MALI : Aqmi a demandé à un otage, militaire Malien, d’intégrer ses rangs
- - 12 août 2010 - OTAGES MALI /MAURITANIE : Mauritanie : un Malien condamné pour le rapt de trois Espagnols
- - FEVRIER 2010 - OTAGE MALI : LIBERATION DE PIERRE CAMATTE (Reportage Télévision espagnol)
- - 8 juin 2009 - OTAGES MALI/NIGER : Le Mali s’engage pour l’otage suisse enlevé en janvier 2009 avec son épouse, au Niger
- - 20 avril 2010 - OTAGES MALI : Quand seront libérés Albert Vilalta et Roque Pascual, otages d’AQMI au Mali ? (Par RFI)
- - 22 avril 2010 - OTAGES MALI : le témoignage de Philomène Kaboré, ex-otage d’AQMI
- - 19 avril 2010 - OTAGES MALI : ATT a reçu les deux ex otages italiens à Koulouba (Primature)
- - 18 avril 2010 - OTAGES MALI : Un couple d’Italiens, ex otage d’AQMI, reconnaissant envers le président malien
- - 10 mars 2010 - OTAGES MALI : libération d’une seule otage, espagnole (24/24)
- - 10 mars 2010 - OTAGES MALI : l’Espagnole et l’Italienne détenues par Al-Qaïda libérées (source diplomatique)
- - 2 mars 2010 - OTAGES MALI : "sort préoccupant" mais leur "vie pas en danger" (par Angola Press)
- - 14 février 2010 - OTAGES MALI : nouveau refus de Bamako de libérer des islamistes
- - 22 janvier 2010 - OTAGES MALI : les otages espagnols vont bien
- - 8 décembre 2009 - OTAGES MALI : Al-Qaïda revendique le rapt d’un Français et de trois Espagnols
- - 7 janvier 2010 - OTAGES MALI : Le président malien appelle à une réunion sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne
- - 31 décembre 09 - OTAGES MALI : Al-Qaïda veut sept millions de dollars pour les otages espagnols, selon la presse
- - 29 décembre 09 - OTAGES MALI : 3 humanitaires espagnols, otages au Mali depuis novembre 2009
- - OTAGES MALI - 30 DECEMBRE 09 : un otage espagnol au plus mal ?
- - 28 décembre 09 - OTAGES AU MALI : Un Français, trois Espagnols et deux Italiens séquestrés
- - 30 novembre 09 - OTAGES MALI : COMMERCE D’OTAGES AU MALI : Le nouveau visage du terrorisme
-
-
 OTAGES NIGER
OTAGES NIGER
 OTAGES NIGER
OTAGES NIGER
-

 Michel Germaneau : otage français enlevé au Niger le 19 avril 2010
Michel Germaneau : otage français enlevé au Niger le 19 avril 2010

 Michel Germaneau : otage français enlevé au Niger le 19 avril 2010
Michel Germaneau : otage français enlevé au Niger le 19 avril 2010
-
 MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
 MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
- - 21 août 2013 - OTAGES SAHEL : une rue "Michel Germaneau" à Marcoussis
- - 10 avril 2012 - OTAGES SAHEL : Révélations sur les circonstances de la mort de l’otage français Michel GERMANEAU
- - OTAGE SAHEL : 24 JUILLET : Il y a un an, AQMI annonçait le décès de l’otage français Michel Germaneau
- - 26 SEPTEMBRE 2010 - OTAGES NIGER : Michel Germaneau a été tué par Targui (Sources du nord du Mali) ] : Michel Germaneau aurait été tué par Targui (VU sur RIIONFO.NET
- - DECES DE MICHEL GERMANEAU : LES REACTIONS DES INTERNAUTES
- - 7 août 2010 - OTAGE NIGER : A Noaillan, près de Bordeaux, l’ultime hommage des amis de Michel Germaneau, otage d’Al Quaida
- - UN PORTRAIT DE MICHEL GERMANEAU : L’ingénieur sans frontières
- - 28 juillet 2010 - OTAGE MALI - MICHEL GERMANEAU - SUR FRANCE 24, L’INTERVIEW DE FRANCIS CHOURAQUI, PRESIDENT D’OTAGES DU MONDE
- - 26 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : Reportage du JT ARTE sur l’exécution de Michel GERMANEAU - L’avis du président d’Otages du Monde sur le raid tenté pour le libérer
- - 26 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : MICHEL GERMANEAU - TOUTES LES VIDEOS et REPORTAGES
- - 25 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : « Soit Michel Germaneau a été exécuté, soit les terroristes sont en passe de le faire » dit le maire de Marcoussis
- - 25 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : Michel Germaneau : pas de revendication précise
- - 23 JUILLET 2010 - MICHEL GERMANEAU, OTAGE AU MALI : LES VIDEOS ET REPORTAGES AUDIO
- - 23 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : Otage français : Paris confirme son rôle dans le raid mauritanien
- - 23 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : raid militaire mené au Mali : la France confirme avoir apporté un "soutien technique"
- - La mobilisation pour Michel Germaneau s’amplifie !
- - LE CLIP DE SOUTIEN DES AMIS DE MICHEL GERMANEAU
- - 17 JUILLET 2010 - OTAGES NIGER UN REPORTAGE DE FRANCE 3 NATIONAL
- - 17 JUILLET 2010 - OTAGE NIGER : Un représentant d’une association iséroise enlevé au Niger (Le Dauphiné Libéré)
- - 13 juillet 2010 - REPORTAGE SUR MICHEL GERMANEAU AU JT DE FRANCE 2 (Philippe ROCHOT)
- - PRESENTATION DE ENMILAL, l’association de Michel GERMANEAU
- - 13 juillet 2010 - OTAGE FRANCAIS AU NIGER : Inquiétude au sujet de l’otage du Sahel
- - 12 juillet 2010 - OTAGES NIGER : Al-Qaeda menace de tuer Michel Germaneau, un otage français enlevé au Niger
- - Mai 2010 - OTAGE NIGER : Les amis de Michel Germaneau qualifient de "grostesque" l’accusation de trahison portée à son chauffeur
- - 2 juin 2010 - OTAGES SAHARA : Al Qaida transforme le Sahara en poudrière (Analyse Le Figaro)
- - 26 avril 2010 - OTAGES NIGER : Prise d’otage au Niger : AQMI défie Flintlock (article TEMOUST)
- - 28 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Enlèvement du tourisme français au Niger : Affaire Camatte bis ?
- - 23 avril 2010 - OTAGES NIGER : Un Français et un Algérien enlevés au Niger (article 20 minutes)
- - 19 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Enlèvement d’un Français et d’un Algérien au Niger : Les otages seraient détenus au Mali
- - 26 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Prise d’otages d’un français et de son chaufeur algérien : l’armée malienne en alerte maximale
- - 25 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Enlèvement d’un algérien et d’un français au Niger : Les otages transférés au nord du Mali
- - 25 avril 2010 - OTAGES MALI : PAIEMENT DE RANÇON POUR LES OTAGES ALGÉRIEN ET FRANÇAIS ENLEVÉS AU NIGER
- - 23 avril 2010 - OTAGES NIGER : Un Français et un Algérien enlevés dans le nord du Niger
-
-
 OTAGES NIGER AREVA -JUIN 2008
OTAGES NIGER AREVA -JUIN 2008
 OTAGES NIGER AREVA -JUIN 2008
OTAGES NIGER AREVA -JUIN 2008
- - 25 juin 08 - OTAGES NIGER : communiqué officiel MNJ
- - 27 juin 08 - OTAGES NIGER : Les ex-otages d’Areva au Niger en France
- - 26 juin 08 - OTAGES NIGER : Les quatre otages français libérés
- - 25 juin 08 - OTAGES NIGER : la guerre de l’uranium
- - 25 juin 08 - OTAGES NIGER : Le MNJ dit que les otages sont menacés
- - 22 juin 08 - OTAGES NIGER : Niger : Des Français d’Areva otages ?
- - Otages NIGER : une pétition lancée par la famille d’Antoine Deloey, mort au Niger en 201 :
- - 7 jullet 2011 - OTAGES NIGER : Otages tués au Niger : ouverture d’une information judiciaire
- - 3 FEVRIER 2011 - OTAGES NIGER : Le deuxième otage français au Niger n’a pas été exécuté
- - 1er février 2011 - OTAGES NIGER : La famille de Vincent Delory se constitue partie civile
- - 26 juin 08 - OTAGES NIGER : Quatre otages français libérés au Niger
- - 6 mai 2010 - OTAGE NIGER : Al Qaïda revendique l’enlèvement de l’otage français au Niger
- - 26 mai 2010 - OTAGE NIGER : Trois djihadistes condamnés à mort menacent la France de représailles et évoque le sort de l’otage français Michel Germaneau
- - 17 mai 2010 - OTAGE NIGER/MALI : le chauffeur Algérien inculpé
- - 14 mai 2010 - OTAGE NIGER : Al Qaïda poste un message audio de l’otage français au Niger
- - 28 AVRIL 2010 - NIGER : Niger, cette crise humanitaire que cachent les jeux de pouvoir (source : YOUPHIL)
- - 29 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : L’otage algérien, compagnon du touriste français, libéré au Mali
- - 27 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : L’Algérie ne paiera pas de rançon
-
- - 19 novembre 2014 - OTAGES MALI : deux adolescents enlevés dans le nord du pays
- - Les otages tués dans le Sahel et au Nigeria depuis 2009 (Source JEUNE AFRIQUE)
- - 11 décembre 2011 - OTAGE SAHEL : Réunion "5+5" à Nouakchott : vers un état-major non permanent en cas de crises
- - 7 décembre 2011 - OTAGES SAHEL : Sahel, la bataille des otages
- - 9 décembre 2011 - OTAGES SAHEL : Al Qaida diffuse les photos de 5 otages
- - 29 août 2011 -OTAGES SAHEL :PRISE D’OTAGES, VERSEMENT DE RANÇON ET TRAFIC D’ARMES Quelles réponses de la conférence d’Alger ?
- - 23 mai 2011 - OTAGES SAHEL : Crise du Nord : Prises d’otages par les groupes terroristes : Les ministres adhèrent à la criminalisation du paiement de rançons
- - 20 JANVIER 2011 - OTAGES MALI : Paris évoque "un risque imminent" d’enlèvement au Nord-Mali
- - 16 JANVIER 2011 - OTAGES NIGER : l’HOMMAGE TOULOUSAIN A VINCENT DELORY
- - OTAGES NIGER : 9 tués dans l’opération au Mali pour libérer les otages (AFP)
- - 13 JANVIER 2011 - OTAGES NIGER - Décès des 2 otages : la version officielle mise à mal
- - NIGER : RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITE A RENNES (BRETAGNE), LE 15 JANVIER 2011
- - 11 janvier 2011 - OTAGES NIGER : Belmokhtar (Aqmi) a commandité le rapt des deux Français
- - 11 JANVIER 2011 - OTAGES NIGER : Nicolas Sarkozy reçoit les familles des 2 otages tués au Niger
- - 10 JANVIER 2011 - OTAGES NIGER : une marche blanche à Linselles pour les deux jeunes français tués au Niger, le prochain week-end ?
- - 10 JANVIER 2011 - OTAGES NIGER : L’intervention française au Niger justifiée ? "Tout se joue dans les premières 24h"
- - 10 JANVIER 2010 - OTAGES NIGER : REVUE DE PRESSE OTAGES : A la Une (SUR RFI) : la guerre contre le terrorisme
- - 9 JANVIER 2011 - OTAGES NIGER : SUR RTL, REACTION DE JEAN LOUIS NORMANDIN, président d’OTAGES DU MONDE
- - 8 janvier 2011 - OTAGES NIGER : les otages auraient été tués
- - 7 janvier 2011 - OTAGES NIGER : 2 français enlevés au Niger
- - 29 octobre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN / NIGER :
- - 30 septembre 2010 - OTAGES SAHEL : Diffusion d’une image des otages français, un "signe encourageant" pour la France
- - 30 SEPTEMBRE 2010 - OTAGES NIGER/MALI : La chaîne de télévision Al Djazira a diffusé jeudi des photos des cinq otages français enlevés le 16 septembre au Niger par des membres d’Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI).
- - 18 septembre 2010 - OTAGES NIGER : Paris ciblé par l’Aqmi au Sahel
- - INTERVIEW
- - Sans titre21 juillet 2010 - OTAGES MAURITANIE : 12 ans pour l’accusé principal
- - OTAGES MAURITANIE : Rebondissements dans l’affaire des otages espagnols en Mauritanie
- - OTAGES MAURITANIE : Espagnols enlevés en Mauritanie : prison à vie requise contre quatre accusés
- - 16 mars 2010 - OTAGES SAHEL : Sept pays de la zone sahélo-saharienne planchent sur le terrorisme à Alger (AFP)
- - 17 mars 2010 - OTAGES SAHEL : Sahel : Sept pays condamnent prises d’otages et paiement de rançons
- - 16 mars 2010 - OTAGES TERRORISME SAHEL :Al-Qaïda s’impose à la réunion ministérielle des pays du Sahel
- - 13 mard 2010 - OAGES MAURITANIE : La question des otages d’AQMI à la une en Mauritanie
- - OTAGES SAHEL : Transfert vers l’Algérie et la Mauritanie de quatre personnes suspectes « enlevées » dans le nord du Mali Carte du Mali, de l’Algérie et leurs voisins.
- - 3 décembre 09 - OTAGES SAHEL : A la Une : les rapts se multiplient dans la zone sahélienne
- - 27 septembre 2010 - OTAGES SAHEL : Réunion à Matignon sur la menace terroriste
- - 26 septembre 2010 - OTAGES NIGER : Françoise Rudetzski : "Je suis révoltée !"
- - 3 décembre 2009 - OTAGES SAHEL - Je kidnappe, tu kidnappes, ils kidnappent (un article de Courrier International)
-
-
 OTAGES SOMALIE
OTAGES SOMALIE
 OTAGES SOMALIE
OTAGES SOMALIE
-
 Décembre 07 : prise d’otage de Gwen LE GOUIL, journaliste français
Décembre 07 : prise d’otage de Gwen LE GOUIL, journaliste français
 Décembre 07 : prise d’otage de Gwen LE GOUIL, journaliste français
Décembre 07 : prise d’otage de Gwen LE GOUIL, journaliste français
- - 8 avril 2008 - LE SOUVENIR DE GWENLAOUEN LE GOUIL, ex-otages en Somalie
- - 2 février 08 - OTAGES SOMALIE : TEMOIGNAGE DE GWEN LE GOUIL SUR LE SITE RUE 89
- - 26 décembre 07 - OTAGE SOMALIE : Le journaliste français Gwen Le GOUIL, libéré lundi, est arrivé à Paris.
- - 21 décembre 07 - OTAGES SOMALIE : Journaliste français enlevé en Somalie : un comité poursuit les négociations
- - 18 décembre 07 - OTAGES SOMALIE Journaliste enlevé en Somalie : les autorités excluent le recours à la force
- - 17 décembre 07 - OTAGES SOMALIE : Le journaliste français enlevé en Somalie "va bien", selon un chef coutumier
- - 16 décembre 07 - OTAGES SOMALIE : Un journaliste français enlevé en Somalie par des inconnus
-
 Juillet 08 - OTAGES SOMALIE
Juillet 08 - OTAGES SOMALIE
 Juillet 08 - OTAGES SOMALIE
Juillet 08 - OTAGES SOMALIE
- - 25 juillet 08 - OTAGES SOMALIE : Un cargo japonais et son équipage pris en otages par des pirates au large de la Somalie
- - 25 juillet 08 - OTAGES SOMALIE : Un cargo japonais et son équipage pris en otages par des pirates au large de la Somalie
- - 23 juillet 08 - OTAGES SOMALIE - Les otages allemands en danger de mort
- - JUILLET 2008 - OTAGES SOMALIE (Info Anglais / français) : Les otages allemands, enlevés en juin dernier, en danger de mort
- - 22 juillet 2008 : Trois Allemands et un Français otages des pirates depuis un mois
-
 Otages Allemands et français enlevés le 24 juin 08
Otages Allemands et français enlevés le 24 juin 08
 Otages Allemands et français enlevés le 24 juin 08
Otages Allemands et français enlevés le 24 juin 08
-
 OTAGES SOMALIE : PRISE D’OTAGES DU VOILIER LE PONANT LE 4 AVRIL 08
OTAGES SOMALIE : PRISE D’OTAGES DU VOILIER LE PONANT LE 4 AVRIL 08
 OTAGES SOMALIE : PRISE D’OTAGES DU VOILIER LE PONANT LE 4 AVRIL 08
OTAGES SOMALIE : PRISE D’OTAGES DU VOILIER LE PONANT LE 4 AVRIL 08
- - 11 juin 2012 - OTAGES SOMALIE - 0 à 15 ans de réclusion requis contre les six accusés somaliens du Ponant
- - 25 mai 2012 - OTAGES SOMALIE : D’ex-otages du voilier Le Ponant racontent leur épreuve
- - 22 mai 2012 - OTAGES SOMALIE : Affaire du voilier LE PONANT : L’identification des pirates somaliens, un vrai casse-tête (LA CROIX)
- - 22 mai 202 - OTAGES SOMALIE : Thibault GARREC, ex-otage du PONANT : « Il faut qu’ils soient punis »
- - 17 juillet 2010 - OTAGES SOMALIE : Reconstitution de la prise d’otages du Ponant
- - 21 mars 2010 - OTAGES SOMALIE : La diffusion du reportage sur la prise d’otage du Ponant sur France 2, le 22 mars,menacée ?
- - 9 avril 2008 - OTAGES SOMALIE : Deux Provençales, Emmanuelle CHABERT et Natacha COMMER, otages des pirates (LA PROVENCE)
- - 15 avril 2010 - OTAGES SOMALIE (PONANT) : voir l’interview de Thibault Garrec et de sa famille.
- - 9 avril 08 - OTAGES SOMALIE : « Ils vont bien mais nous sommes très inquiets »
- - 7 juin - OTAGES SOMALIE - Libération de 11 otages détenus par des pirates somaliens
- - 29 avril 2014 - OTAGES SOMALIE : Des pirates somaliens relâchent leurs otages après avoir été repérés
- - 23 février 2014 - OTAGES SOMALIE : Deux ingérieurs kényans enlevés à Mogadiscio
- - 18 octobre 2013 - OTAGES SOMALIE - Voilier La Tanit : les trois pirates somaliens condamnés à 9 ans de prison
- - OTAGES SOMALIE - LaTanit : trois pirates somaliens présumés devant les assises à Rennes (Reportage France 3 Bretagne
- - 18.07.2013 - OTAGES ESPAGNOLES SOMALIE : libération de deux jeunes femmes humanitaires (MSF) après 644 jours de captivité
- - 27 août 2012 - OTAGES SOMALIE : Denis Allex, le plus ancien otage français
- - 11 juillet 2012 - OTAGE SOMALIE : Trois ans de détention pour le français DENIS ALLEX, un agent de la DGSE
- - 22 juin 2012 - OTAGES SOMALIE :
- - 21 juin 2012 _ OTAGES SOMALIE : L’Afrique du Sud se réjouit de la libération d’otages en Somalie
- - 21 mars 2012 - OTAGES SOMALIE : L’otage britannique Judith Tebbutt libérée en Somalie
- - 21 janvier 2012 - OTAGES SOMALIE : Un Américain enlevé dans le centre de la Somalie
- - 11 janvier 2012 - OTAGES SOMALIE : Des otages occidentaux capturés par des islamistes ont été vendus à des pirates somaliens
- - 25 novemre 2011 - OTAGES SOMALIE : libération d’un navire italien capturé en avril en mer d’Arabie
- - 15 novembre 20111 - OTAGES SOMALIE : les pirates somaliens devant la justice française pour le rapt de Jean-Yves et Bernadette Delanne, en septembre 2008
- - OTAGE KENYA / SOMALIE : L’otage française morte en Somalie : les ravisseurs cherchent à vendre la dépouille de Marie Dedieu
- - 3 novembre 2011 - OTAGES SOMALIE : Alger annonce la libération de 25 marins otages de pirates somaliens
- - 19 OCTOBRE 2011 - OTAGES SOMALIE - Marie Dedieu, l’otage française en Somalie, est morte
- - 18 JUILLET 2011 - OTAGES SOMALIE : le pétrolier grec détourné et son équipage ont été relâchés
- - 30 mai 2011 -OTAGES SOMALIE : OTAGES SOMALIE : Une demande de rançon a été formulée à l’affréteur jordanien du MV Blida
- - 21 mai 2011 - OTAGES SOMALIE : Enlèvement d’un yacht : des pirates somaliens plaident coupables aux USA
- - 15 mai 2011 - OTAGES SOMALIE : un navire danois libère 16 Iraniens otages de pirates
- - 14 avril 2011 -OTAGES SOMALIE - Le nombre d’actes de piraterie au plus haut depuis le début de l’année
- - 23 février 2011 - OTAGES SOMALIE : Quatre Américains otages de pirates somaliens tués sur leur yacht
- - 29 DECEMBRE 2010 - OTAGE SOMALIE : une preuve de vie de l’espion français (Article LE PARISIEN)
- - 25 juillet 2010 - OTAGE SOMALIE : La journaliste et ex-otage Amanda Lindhout crée une fondation
- - 3 juin 2010 - OTAGES SOMALIE ; Les otages d’un cargo reprennent leur navire
- - 2 juin 2010 - OTAGES SOMALIE : Un cargo pris en otage dans le golfe d’Aden
- - 22 novembre 09 - OTAGES SOMALIE : interview du patron de l’Alakrana : "Je ne cesse de penser à la petite fille de 12 ans, otages des pirates !" (article du journal El Mundo - En espagnol)
- - 25 novembre 09 - OTAGES SOMALIE : une reporter ex-otage torturée (par AFP)
- - 9 décembre 09 - OTAGES SOMALIE : la canadienne Amanda Lindhout de retour chez elle
- - 7 mai 2010 - OTAGES SOMALIE - PIRATERIE MARITIME : La Russie relâche des pirates et réclame une meilleure législation
- - 15 mai 2010 - OTAGES SOMALIE : Amanda Lindhout, ex-otage canadienne en Somalie crée une fondation pour envoyer des Somaliennes à l’université
- - 5 mai 2010 - OTAGES SOMALIE : Des pirates attaquent un pétrolier au large de la Somalie
- - 3 mai 2010 - PIRATERIE MARITIME : Les islamistes prennent un repaire de pirates
- - 3 mai 2010 - OTAGES SOMALIE : Les islamistes somaliens s’attaquent aux pirates
- - 3 mai 2010 - OTAGES SOMALIE : un vraquier panaméen détourné par des pirates
- - 20 avril 2010 - OTAGES SOMALIE : Les pirates somaliens se trompent et attaquent un navire de guerre (La Tribune de Genève)
- - 21 avril 2010 - OTAGES SOMALIE : vraquier panaméen détourné par des pirates somaliens
- - 20 avril 2010 - OTAGES SOMALIE (PIRATERIE MARITIME) : Des pirates somaliens s’emparent de trois navires thaïlandais
- - 19 avril 2010 - PIRATERIE GOLFE ADEN : Malgré les pirates, deux plaisanciers bordelais refusent de renoncer à une croisière dans le golfe d’Aden
- - 19 novembre 2008 - PIRATERIE MARITIME - Anne-Sophie Ave, délégué général d’Armateurs de France : "La lutte contre la piraterie passe par l’adaptation du droit international"
- - 6 avril 2010 - OTAGE FRANCAIS EN SOMALIE : les milices Shehab réitèrent leurs conditions pour relâcher leur otage français
- - 6 mars 2010 - PIRATERIE MARITIME SOMALIE : Un thonier- concarnois pris à partie (Ouest-France)
- - 9 mars 2010 - OTAGES SOMALIE : le couple britannique otage "n’est pas en danger", selon le président
- - 6 février 2010 - PIRATERIE SOMALIE : Les Seychelles s’engagent à juger les pirates somaliens (Le Matin CH )
- - 19 Février 2010 - PIRATES SOMALIE - Sur DIRECT 8 : CHASSE AUX PIRATES
- - PIRATERIE SOMALIE : Retour au pays des pirates - une émission de Thalassa
- - 15 janvier 2010 - PIRATERIE MARITIME : PIRATERIE - LES SOLUTIONS JURIDIQUES, FINANCI�?RES ET TECHNOLOGIQUES
- - 9 janvier 2010 - PIRATERIE MARITIME : Comment les pirates arrêtés sont jugés ? Le point...
- - 27 août 2009 - OTAGES SOMALIE : L’agent français otage raconte son évasion
- - 26 décembre 2009 - PIRATERIE SOMALIE - en 2009 : 9 navires attaqués - 209 otages
- - 3 décembre 09 - PIRATERIE SOMALIE : Les pirates somaliens créent une "bourse" pour gérer leurs revenus
- - 16 novembre 09 - OTAGES SOMALIE : Lutter contre la corruption pour mieux combattre la piraterie
- - 4 novembre 09 - OTAGES SOMALIE : La saison des pirates est rouverte
- - 29 juillet 09 - OTAGES SOMALIE : la force ou la négociation ? (Le débat de France 24)
- - 27 août 09 - OTAGES SOMALIE : Le récit de l’agent français qui a échappé aux islamistes
- - 11 août 09 : OTAGES SOMALIE : Libération des quatre expatriés d’Action contre la Faim en Somalie (communique ONG ACF)
- - 4 août 09 - OTAGES SOMALIE : Vague de libération d’otages
- - 14 juillet 09 - OTAGES SOMALIE : Enlèvements d’étrangers en Somalie : de nombreux précédents
- -

Les 2 employées de MSF, otages depuis le 26 décembre, libérées mercredi 2 janvier
-
-
 OTAGES SOUDAN
OTAGES SOUDAN
 OTAGES SOUDAN
OTAGES SOUDAN
- - 19 juillet 2014 - OTAGES SOUDAN : trois humanitaires soudanais libérés après un mois de captivité
- - 20 mars 2010 - OTAGE SOUDAN - DARFOUR : L’ex-otage au Darfour Gauthier Lefèvre dit avoir été bien traité
- - 20 mars 2010 - OTAGE DARFOUR : Le combat quotidien de Gauthier Lefèvre, victime du plus long rapt au Darfour
- - 19 mars 2010 - OTAGES DARFOUR : arrivée de Gauthier lefebvre à l’aéroport , ex-otage du CIR au Soudan
- - 14 mars 2010 - OTAGES SOUDAN :LES 2 OTAGES FRANCAIS LIBRES !
- - 2 mars 2010 - OTAGES SOUDAN : 100 jours de captivité pour les deux humanitaires otages au Darfour
-
 OTAGES SYRIE
OTAGES SYRIE
 OTAGES SYRIE
OTAGES SYRIE
-
 26 novembre 2013 - OTAGES SYRIE : Magnus Falkehed, journaliste, et Niclas Hammarstrom, photographe free lance,kidnappés
26 novembre 2013 - OTAGES SYRIE : Magnus Falkehed, journaliste, et Niclas Hammarstrom, photographe free lance,kidnappés
 26 novembre 2013 - OTAGES SYRIE : Magnus Falkehed, journaliste, et Niclas Hammarstrom, photographe free lance,kidnappés
26 novembre 2013 - OTAGES SYRIE : Magnus Falkehed, journaliste, et Niclas Hammarstrom, photographe free lance,kidnappés
- - 7 février 2015 - OTAGE SYRIE : Incertitude sur le sort d’une otage américaine de l’État islamique
- - Otage japonais en Syrie : la communauté internationale condamne l’exécution de Kenji Goto par l’EI
- - 21 janvier 2015 - OTAGES SYRIE - OTAGES JAPONAIS EN SYRIE - Daech menace de tuer deux otages japonais - L’appel à l’aide du Japon à la France
- - 20 janvier 2015 - OTAGES SYRIE : Otages japonais de Daesh : Le Japon « ne pliera pas » face au terrorisme
- - 16 janvier 2015 - OTAGES SYRIE - Italie : deux anciennes humanitaires otages en Syrie de retour à Rome
- - 15 janvier 2015 - OTAGES SYRIE - Libération de deux otages italiennes en Syrie-bureau de Renzi
- - OTAGES COLOMBIE : les otages des FARC bientôt libérés ? RFI
- - 17 novembre 2014 - OTAGE SYRIE : John Cantlie, l’otage britannique devenu... "reporter" de l’organisation de l’Etat islamique
- - 17 novembre 2014 _ OTAGES SYRIE : dans l’Eure, « on a tout de suite reconnu Maxime » (France 3 Normandie)
- - 17 novembre 2014 - OTAGES SYRIE : OTAGES SYRIE : Qui est le Français soupçonné d’être l’un des bourreaux de l’État islamique ?
- - 14 novembre 2014 - Otage Syrie - Interview de Nicolas Hénin, ex-otage du groupe armé État islamique, à Radio Canada
- - 16 novembre 2014 - OTAGE SYRIE : L’État islamique affirme avoir décapité l’otage américain Peter Kassig
- - 9 oct 2014 - Otage Syrie : un père franciscain et des chrétiens relâchés par un groupe lié à Al-Qaïda
- - 9 octobre 2014 - Otages Syrie : Libération du Père franciscain Hanna Jallouf, kidnappé par les islamistes
- - 9 octobre 2014 - OTAGE SYRIE : pour les parents de James Foly, informer est vital (Ouest-France)
- - Nouvel article24 août 2014 : Le Qatar libère Peter Théo Curtis, un journaliste américain otage en Syrie depuis 2 ans (source : KAPITALIS)
- - 24 août 2014 - Otage Syrie : un otage allemand de l’Etat islamique a été libéré
- - 21 août 2014 - OTAGES SYRIE : Exécution de James Foley : le bourreau reconnu par d’ex-otages
- - OTAGES SYRIE - 19 août 2014 - L’Etat Islamique annonce avoir décapité le journaliste américain James Foley
- - 30 mars 2014 - OTAGES ESPAGNOLS EN SYRIE : Capturados el pasado 16 de septiembre, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, liberados en Siria tras más de seis meses de secuestro (article EL MUNDO)
- - 30 mars 2014 - Deux journalistes espagnols libérés en Syrie
- - 8 mars 2014 - Otages Syrie : les rebelles ont libérés les religieuses en otage
- - OTAGE SYRIE : Le père Paolo enlevé par des islamistes en Syrie ( La Libre Belgique)
- - 29 janvier 2014 - OTAGE SYRIE : Le père Paolo, homme du dialogue en otage (Le libre Belgique)
- - 8 janvier 2014 - OTAGES SYRIE : Disparus en Syrie, deux journalistes suédois libérés au Liban
- - 7 janvier 2014 - OTAGES SYRIE : l’EIIL a exécuté des dizaines d’otages
- - OTAGES SYRIE - Libération d’un journaliste turc détenu en Syrie
- - Otages Syrie : cinq employés de MSF « pris par un groupe » dans le nord du pays
- - OTAGES SYRIE : ’’Pas de pitié pour les journalistes" ( Jean-Paul Marthoz)
- - 10 décembre 2013 - OTAGES SYRIE : Deux journalistes espagnols ont été capturés en Syrie
- - 4 décembre 2013 - OTAGES SYRIE : le pape lance un appel pour les soeurs de Maaloula et les otages
- - 3 décembre 2013 - OTAGES SYRIE : Des religieuses de Maaloula prises en otage par les rebelles syriens
- - OTAGES SYRIE - 3 décembre 2013 - Attentat suicide à Damas et enlèvement de religieuses par les rebelles
- - OTAGES SYRIE : Jonathan Alpeyrie : "Mes 81 jours de détention" (Paris-Match)
- - 19 octobre 2013 - OTAGES SYRIE : Neuf otages libanais libérés en Syrie, deux otages turcs bientôt relâchés au Liban
- - 13 octobre 2013 - OTAGES SYRIE - Sept membres du CICR ont été enlevés en Syrie
- - 24 septembre 2013 - OTAGES SYRIE : Un journaliste espagnol pris en otage dans la région de Hama, en Syrie
- - 10 septembre 2010 - OTAGE SYRIE : Le journaliste Domenico Quirico, libéré de Syrie : "J’ai rencontré le pays du Mal"
- - 5 août 2013 - Hostage Syria : Jonathan Alpeyrie hostage
- - DIDIER FRANCOIS, d’Europe 1 et le photographe EDOUARD ELIAS, kidnappés le 6 juin dernier en Syrie
- - 27 juillet 2013 - OTAGES SYRIE : Un photographe franco-américain libéré après 81 jours en Syrie
-
-
 OTAGES TCHAD
OTAGES TCHAD
 OTAGES TCHAD
OTAGES TCHAD
-
 OTAGES TCHAD EN 2008
OTAGES TCHAD EN 2008
- - 8 janvier 2010 - INSECURITE TCHAD : Reporters au Tchad : « Les Ailes de l’espoir » sur RTL TVi
- - 11 décembre 2009 - OTAGES TCHAD/MAURITANIE/CENTRAFRIQUE :Ultimatum sur la vie des trois otages français en Afrique
- - 21 décembre 2009 - OTAGES TCHAD : Le CICR lance un nouvel appel pour la libération des deux otages français
- - DECEMBRE 2009 :Otages français au Tchad-Centrafrique : interview de Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie. (VIDEO)
- - 11 novembre 09 - OTAGES TCHAD : Le président du CICR réclame la libération des deux otages au Tchad
-
-
 OTAGES VENEZUELA
OTAGES VENEZUELA
 OTAGES VENEZUELA
OTAGES VENEZUELA
- - 10 aril 2012 - OTAGE VENEZUELA : Un diplomate costaricain retenu en otage au Venezuela
- - 12 novembre 2011 - OTAGES VENEZULA : Une star du baseball retenue en otage pendant 2 jours
- - 11 février 2010 - Décès de Christophe Beck, l’otage oublié
- - OTAGE VENEZUELA : Témoignage de Stéphanie Miñana, otage au Venezuela en 2003
- - 5 juin 07 - OTAGE VENEZUELA : les témoignages de Christophe Beck, otage français au Vénézuela, en 2006 et de ses proches
-
 OTAGES YEMEN
OTAGES YEMEN
 OTAGES YEMEN
OTAGES YEMEN
- - 7 décembre 2014 - Otages Yemen : Qui étaient les deux otages tués au Yémen lors d’une tentative de libération ?
- - 7 décembre 2014 - Otages tués au Yémen : les explications des autorités américaines
- - 6 décembre 2014 - Otages Yémen : deux otages détenus par Al-Qaïda tués lors d’une tentative de libération
- - 4 décembre 2014 - OTAGE YEMEN : Al-Qaïda au Yémen diffuse la vidéo d’un otage américain, menace de l’exécuter
- - 13 février 2013 - Otage Yémen : l’otage sud-africain en vie, rançon maintenue
- - 14 juillet 2012 - OTAGES YEMEN : Un otage français libéré au Yemen
- - 27 avril 2012 - OTAGE YEMEN : LE CICR préoccuppé par l’enlèvement d’un humanitaire français au Yemen
- - 23 avril 2012 - OTAGES YEMEN : Un Français de la Croix-Rouge pris en otage au Yémen
- - 24 novembre 201 - OTAGES EMEN : YÉMEN. L’humanitaire Française enlevée mardi a été libérée
- - 22 novembre 2011 - OTAGES YEMN : Trois personnes, dont une Française, enlevées par des hommes armés au Yémen
- - 16 novembre 2011 - OTAGES YEMEN : OTAGES YEMEN : Une des trois ex-otages français du Yémen originaire de Biarritz
- - 15 novembre 2011 - OTAGES YEMEN : le soulagement à Thil (31) d’où est originaire Pierre Perrault, l’un des 3 otages français (LA DEPECHE)
- - 14 novembre 2011 - OTAGES YEMEN : INTERVIEW DE CHRISTIAN LOMBART, CO-DIRECTEUR D’ONG Triangle : "Il faut continuer !" (Lyon-Métropole)
- - 15 novembre201 - OTAGES YEMEN : retour des 3 otages français en France (RFI)
- - 14 novembre 2011 -OTAGES YEMEN - Les trois ex-otages français au Yémen sont rentrés en France
- - OTAGES YEMEN : 28 mai au 15 novembre 2011 : historique de la prise d’otages
- - 14 novembre 2011 - OTAGE YEMEN : Les trois otages français au Yémen ont été libérés
- - OTAGES YEMEN - 13 novembre 2011 : médiation pour les 3 otages français
- - 4 août 2011 - OTAGE FRANCAIS AU YEMEN : un otage français, 30 ans, humanitaire originaire de Haute-Garonne
- - 27 juillet 2011 -OTAGES YEMEN : les ravisseurs des 3 Français exigeraient une rançon de 12 millions de dollars
- - 27 juillet 2011 - OTAGES YEMEN : les trois otages français seraient aux mains d’éléments d’Al-Qaida
- - 13 SEPTEMBRE 2006 - OTAGES YEMEN : prise d’otages de 4 TOURISTES FRANCAIS (INA)
- - 3 mai 2011 - OTAGES YEMEN :
- - 29 MAI 2011 - OTAGES YEMEN - TROIS HUMANITAIRES FRANCAIS ENLEVES (REVUE DE PRESSE)
- - 19 mai 2010 - OTAGES YEMEN : libération de deux fillettes allemandes
- - 19 mai 2010 - OTAGES YEMEN : libération de deux fillettes allemandes
- - 16 mars 2010 - OTAGES YEMEN : Les corps retrouvés dans le Nord-Est ne sont pas ceux des otages européens
- - 5 juin 2009 - OTAGES YEMEN : Sur neuf étrangers otages dans le nord du Yémen, trois retrouvés morts
- - 15 mars 2010 - OTAGE YEMEN : La découverte de corps au Yémen ravive l’inquiétude sur le sort d’otages occidentaux
- - 12 février 2010 - OTAGES YEMEN : Embrouilles au large (reportage de THALASSA)
- - 11 janvier 2010 - OTAGES YEMEN : le ministre allemand évoque le sort des 5 otages allemands enlevés en juin 2009
- - 8 janvier 2010 - OTAGES YEMEN : cinq Allemands et un Britannique, enlevés il y a 6 mois, toujours en vie
- - 17 novembre 09 - OTAGES YEMEN : tractations pour la libération de l’otage japonais
- - 2 janvier 2006 - OTAGES YEMEN : menaces sur les otages italiens
-
 Sites web intéressants
Sites web intéressants
 Sites web intéressants
Sites web intéressants
-
 TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
 TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
- - 10 mars 2011 - Antoine Falsaperla, otage le 23 mai 2009 à la frontière entre le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran
- - 28 novembre 2011 - OTAGE LIBAN : témoignage de Christian JOUBERT, ex-otage au Liban (20 minutes)
- - 21 novembre 2011 - OTAGE SOMALIE : Un ex-otage en somalie témoigne : « Parmi les pirates, des femmes et des gosses » (Source : El Watan)
- - {29 mai 2011 - OTAGE AFGHANISTAN : Mellissa Fung : Vingt-huit jours sous la terre (LIVRE)
- - 14 JUIN 2011 - OTAGE SOMALIE : "J’avais raison d’y croire", récit de neuf mois de captivité, par Isabelle Lambret
- - OTAGE AFGHANISTAN - AUTOMNE 2008 : "Under An Afghan Sky" TEMOIGNAGE de Mellissa Fung, journaliste de la BBC
- - 13 mai 2011 - 500 jours - Jean-Louis NORMANDIN : on compte les jours
- - 28 AVRIL 2010 - OTAGES DARFOUR : LE TEMOIGNAGE D’OLIVIER FRAPPE, OTAGE AU DARFOUR (Soudan) De nov 2009 à mars 2010 -RFI)
- - 22 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : « Pour une famille, c’est une sorte de tsunami » Interview de Roger LECOINTE, cousin d’Hervé GHESQUIERE pour le quotidien LA VOIX DU NORD
- - 14 janvier 2010 - OTAGES AL QUAIDA : Comment Al Qaïda traite ses otages Témoignages d’anciennes victimes
- - 19 juin 2010 - OTAGES LYBIE : Témoignage - Rachid Hamdani, ex-otage suisse : "Tout seul dans ma cellule, je m’attendais au pire"
- - 5 juin 2010 - TEMOIGNAGE EX-OTAGE : TEMOIGNAGE : Joséphine Dard : « Je vis encore dans la peur »
- - 24 FEVRIER 2010 - OTAGE MALI : L’« épouvantable » détention de l’ex-otage français au Mali
- - Jean-Paul Kauffmann raconte sa détention (Archives INA - Conférence de presse quelques jours après la libération)
- - Avril 2008 - OTAGE NIGERIA : TEMOIGNAGE - Frédéric DURAND, un marin de Lesconil (29), otage au Nigéria en 1996
- - 2000 - OTAGES PHILIPPINES : Témoignage des otages de Jolo
- - L’Express du 06/09/2004 : "LA VIE HUMAINE N’A PAS DE PRIX" Marianne Pearl
- - 5 juin 07 - OTAGE VENEZUELA : le témoignage de Christophe Beck, otage français au Vénézuela en 2006
- - 11 juin 09 - OTAGES DU MONDE : ce soir, pour la 100ème de Complément d’Enquête, Jean-Louis Normandin, ex-otage au Liban , témoigne.
- - Témoignage de Jean-Louis Normandin, otage au Liban, Président d’OTAGES DU MONDE
- - OTAGE VENEZUELA : Témoignage de Stéphanie Miñana, otage au Vénézuela en 2003
- - Témoignage de Roger Auque
- - Témoignage de Jean-Paul Kauffmann
-
 ZOOM SUR ...PIRATERIE MARITIME
ZOOM SUR ...PIRATERIE MARITIME
 ZOOM SUR ...PIRATERIE MARITIME
ZOOM SUR ...PIRATERIE MARITIME
- - 3 janvier 2014 - PIRATERIE MARITIME : La lutte contre la piraterie en Somalie coûte « entre 5 et 8 milliards d’euros » selon Jack Lang
- - 10 octobre 2013 - PIRATERIE MARITIME - OTAGES SOMALIE : Captain Phillips, la réalité quotidienne en Somalie
- - Juillet 2013 - IMB Piracy Report highlights violence in West Africa (Rapport sur les actes de piraterie maritimes en Afrique de l’Ouest)
- - International Chamber of commerce : des alertes en continu sur les actes de piraterie martime - Vu le site de la chambre internationale de commerce ( LIVE PIRACY REPORT)
- - 7 décembre 2011 - PIRATERIE MARITIME : 2011, année record pour les rançons récoltées par les pirates
- - 16 novembre 2011 - PIRATERIE MARITIME : L’Égypte autorise les équipes de protection embarquées dans le canal de Suez
- - jeudi 29 septembre 2011 - Combien coûte la lutte contre la piraterie maritime ?
- - 14 JUILLET 2011 - PIRATERIE MARITIME : Recrudescence de la piraterie sur les mers du monde
- - 19 janvier 2011 - PIRATERIE MARITIME :
- - 21 avril 2010 - PIRATERIE MARITIME 2010 : net recul au premier trimestre
- - 31 mars 2010 - OTAGES SOMALIE - PIRATERIE MARITIME : bond des actes de piraterie en mars 2010
- - 14 février 2010 - PIRATERIE SOMALIE : Patrick Forestier. Le commando de l’info" (Quotidien / LE TELEGRAMME)
- - 9 février 2010 : PIRATERIE MARITIME : Aux Seychelles, les scientifiques cantonnés à quai, à cause des pirates
- - PIRATERIE : BILAN 2009
- - 17 novembre 2014 - OTAGES MONDE - Barak Obama ordonne un réexamen complet des procédures en cas de prises d’otages « terroristes à l’étranger »}}
- - 25 août 2014 - SUR FRANCE INTER "Affaires Sensibles" : il y a 20 ans, la prise d’otages du vol ALGER/PARIS
- - 18 novembre 2013 - LES EVASIONS D’OTAGES DANS LE MONDE DEPUIS 1997
- - 16 septembre 2013 - CENTRE DE CRISE DU QUAI D’ORSAY - REPORTAGE DE FRANCE 3
- - 17 avril 2013 - « Jean-Louis NORMANDIN, président d’Otages du Monde " : Otages : il faut un débat national »
- - JUIN 2011- REPORTERS : PRISES d’OTAGES, COMMENT LIMITER LES RISQUES ?
- - 7 mars 2011 - LE DÉBRIEFING DES OTAGES ÉTAPE OBLIGÉE APR�?S LA LIBERTÉ
- - LES FRANÇAIS OTAGES DANS LE MONDE
- - Les bannières OTAGES DU MONDE
 Mobilisation pour Guy-Andre Kieffer, journaliste français disparu en Côte d’Ivoire
Mobilisation pour Guy-Andre Kieffer, journaliste français disparu en Côte d’Ivoire
-
 Information sur sa disparition en avril 2004
Information sur sa disparition en avril 2004
 Information sur sa disparition en avril 2004
Information sur sa disparition en avril 2004
- - 23 0CT0BRE 2010 - AFFAIRE GUY-ANDRE KIEFFER : une émission sur France Inter
- - 22 juillet 2008 - Article Libération - Kieffer, disparu encombrant L’enquête sur l’enlèvement du journaliste en Côte-d’Ivoire inquiète le clan Gbagbo. par THOMAS HOFNUNG
- - POUR CONNAITRE TOUTE LA VERITE SUR L’AFFAIRE GUY-ANDRE KIEFFER
- - Une chanson pour Guy-André Kieffer
- - Vérité sur Guy-André Kieffer
-
 L’actualité du dossier G.A. KIEFFER
L’actualité du dossier G.A. KIEFFER
 L’actualité du dossier G.A. KIEFFER
L’actualité du dossier G.A. KIEFFER
- - 7 janvier 2012 - COTE-D’IVOIRE : découverte d’un squelette qui pourrait être celui du journaliste Guy-André Kieffer
- - 6 janvier 2012 - DISPARU COTE-D’IVOIRE : Disparition de Guy-André Kieffer : début des analyses ADN
- - 16 AVRIL 2011 - MANIFESTATION A PARIS POUR LA VERITE SUR LA DISPARITION DE GUY ANDRE KIEFFER
- - 16 avril 2010 - COTE D’IVOIRE : DISPARITION GUY ANDRE KIEFFER :Six ans après la disparition de Kieffer, le principal suspect libéré (TV5 MOnde)
- - 16 AVRIL 2010 - DISPARU Côte-d’Ivoire : UN CONCERT POUR LA VERITE SUR LA DISPARITION DE GUY ANDRE KIEFFER
- - 3 0CT0BRE 09 : UN CONCERT POUR GUY-ANDRE KIEFFER
- - Juillet 08 - ARTICLE LIBERATION : Kieffer, disparu encombrant
- - 3 juillet 08 - OTAGES COLOMBIE : Le collectif ivoirien vérité Guy-André Kieffer se félicite de la libération en Colombie d’Ingrid Betancourt
- - 10 juillet 08 - DISPARU COTE D’IVOIRE : L’épouse du président ivoirien Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, est convoquée à Paris pour être entendue comme témoin dans l’enquête sur la disparition du journaliste Guy-André Kieffer
- - 16 juin 08 - DISPARU COTE-D’IVOIRE : le député breton Jean Gaubert attire l’attention de de la secrétaire d’État chargée des affaires étrangères et des droits de l’homme sur la disparition de Guy-André Kieffer en Côte-d’Ivoire
- - 16 juin 08 - DISPARU COTE D’IVOIRE : Le Collectif ivoirien "Vérité Guy André Kieffer" se réjouit qu’un officiel français ait discuté de la disparition de leur confrère avec le Chef de l’Etat Laurent Gbagbo.
- - 30 mai 08 - AFFAIRE GUY-ANDRE KIEFFER : 400 personnes au concert de soutien à Lyon
- - 10 mai 08 : Une soirée avec Kent, en soutien à Guy-André Kieffer, à Lyon , le 30 mai 08 (Article Libe Lyon)
- - SOUTIEN GUY-ANDRE KIEFFER : UN CONCERT A LYON LE 30 MAI 08
- - 13 avril 08 - DISPARU COTE D’IVOIRE : 4 ans après, la mobilisation pour Guy-André Kieffer se poursuit
- - UNE AFFICHE POUR GAK
- - 16 avril 08 - GUY ANDRE KIEFFER : RASSEMBLEMENT POUR LE 4eme ANNIVERSAIRE DE SON ENLEVEMENT
- - 16 avril 2014 - 10 ans de la disparition de GUY ANDRE KIEFFER - RASSEMBLEMENT deavnt la mairie du XXème de Paris
- - 3 mars 2013 _ COTE D’IVOIRE : Disparition de Guy-André Kieffer - Reportage ; un journaliste qui dérangeait
- - 25 novembre 2011 - DISPARITION Guy André KIEFEFER : appel à témoins
- - 16 avril 2011 - Près de 100 sympathisants à la marche pour la Vérité sur la disparition de GAK
 Michel Germaneau : otage français enlevé au Niger le 19 avril 2010
Michel Germaneau : otage français enlevé au Niger le 19 avril 2010
-
 MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
 MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
MICHEL GERMANEAU : OTAGE ENLEVE AU NIGER LE 19 AVRIL 2010
- - 21 août 2013 - OTAGES SAHEL : une rue "Michel Germaneau" à Marcoussis
- - 10 avril 2012 - OTAGES SAHEL : Révélations sur les circonstances de la mort de l’otage français Michel GERMANEAU
- - OTAGE SAHEL : 24 JUILLET : Il y a un an, AQMI annonçait le décès de l’otage français Michel Germaneau
- - 26 SEPTEMBRE 2010 - OTAGES NIGER : Michel Germaneau a été tué par Targui (Sources du nord du Mali) ] : Michel Germaneau aurait été tué par Targui (VU sur RIIONFO.NET
- - DECES DE MICHEL GERMANEAU : LES REACTIONS DES INTERNAUTES
- - 7 août 2010 - OTAGE NIGER : A Noaillan, près de Bordeaux, l’ultime hommage des amis de Michel Germaneau, otage d’Al Quaida
- - UN PORTRAIT DE MICHEL GERMANEAU : L’ingénieur sans frontières
- - 28 juillet 2010 - OTAGE MALI - MICHEL GERMANEAU - SUR FRANCE 24, L’INTERVIEW DE FRANCIS CHOURAQUI, PRESIDENT D’OTAGES DU MONDE
- - 26 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : Reportage du JT ARTE sur l’exécution de Michel GERMANEAU - L’avis du président d’Otages du Monde sur le raid tenté pour le libérer
- - 26 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : MICHEL GERMANEAU - TOUTES LES VIDEOS et REPORTAGES
- - 25 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : « Soit Michel Germaneau a été exécuté, soit les terroristes sont en passe de le faire » dit le maire de Marcoussis
- - 25 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : Michel Germaneau : pas de revendication précise
- - 23 JUILLET 2010 - MICHEL GERMANEAU, OTAGE AU MALI : LES VIDEOS ET REPORTAGES AUDIO
- - 23 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : Otage français : Paris confirme son rôle dans le raid mauritanien
- - 23 JUILLET 2010 - OTAGE MALI : raid militaire mené au Mali : la France confirme avoir apporté un "soutien technique"
- - La mobilisation pour Michel Germaneau s’amplifie !
- - LE CLIP DE SOUTIEN DES AMIS DE MICHEL GERMANEAU
- - 17 JUILLET 2010 - OTAGES NIGER UN REPORTAGE DE FRANCE 3 NATIONAL
- - 17 JUILLET 2010 - OTAGE NIGER : Un représentant d’une association iséroise enlevé au Niger (Le Dauphiné Libéré)
- - 13 juillet 2010 - REPORTAGE SUR MICHEL GERMANEAU AU JT DE FRANCE 2 (Philippe ROCHOT)
- - PRESENTATION DE ENMILAL, l’association de Michel GERMANEAU
- - 13 juillet 2010 - OTAGE FRANCAIS AU NIGER : Inquiétude au sujet de l’otage du Sahel
- - 12 juillet 2010 - OTAGES NIGER : Al-Qaeda menace de tuer Michel Germaneau, un otage français enlevé au Niger
- - Mai 2010 - OTAGE NIGER : Les amis de Michel Germaneau qualifient de "grostesque" l’accusation de trahison portée à son chauffeur
- - 2 juin 2010 - OTAGES SAHARA : Al Qaida transforme le Sahara en poudrière (Analyse Le Figaro)
- - 26 avril 2010 - OTAGES NIGER : Prise d’otage au Niger : AQMI défie Flintlock (article TEMOUST)
- - 28 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Enlèvement du tourisme français au Niger : Affaire Camatte bis ?
- - 23 avril 2010 - OTAGES NIGER : Un Français et un Algérien enlevés au Niger (article 20 minutes)
- - 19 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Enlèvement d’un Français et d’un Algérien au Niger : Les otages seraient détenus au Mali
- - 26 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Prise d’otages d’un français et de son chaufeur algérien : l’armée malienne en alerte maximale
- - 25 avril 2010 - OTAGES NIGER/MALI : Enlèvement d’un algérien et d’un français au Niger : Les otages transférés au nord du Mali
- - 25 avril 2010 - OTAGES MALI : PAIEMENT DE RANÇON POUR LES OTAGES ALGÉRIEN ET FRANÇAIS ENLEVÉS AU NIGER
- - 23 avril 2010 - OTAGES NIGER : Un Français et un Algérien enlevés dans le nord du Niger
OTAGES AFGHANISTAN : HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONNIIER, LIBRES !
-
 INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
 INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
INFORMATIONS SUR LA PRISE D’OTAGES DE HERVE GUESQUIERE ET STEPHANE TAPONIER
- - 13 mai 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : "Il faut hurler notre désespoir pour eux"
- - 12 et 3 MAI 2011 - OTAGES EN AFGHANISTAN : l’angoisse des parents des otages
- - 12 mai 2011 - 500 jours : émission spéciale sur la Chaîne parlementaire
- - 24 FEVRIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : La libération des otages en Afghanistan est complexe, dit Juppé
- - 29 décembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN :"Un otage, c’est un résistant" Jean-Louis Normandin, Président d’Otages du Monde, pour EUROPE1
- - 21 JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : le nouveau chantage de Ben Laden}} (LE PARISIEN)
- - 21 janvier 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : Ben Laden lie le sort des otages au retrait français d’Afghanistan
- - 10 JANVIER 2010 - OTAGES AFGHANISTAN :Fillon optimiste sur une "issue favorable"
- - 1er JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : REPORTAGES TV après la publication du communiqué des Talibans
- - 1er JANVIER 2010 - Otages en Afghanistan : les talibans accusent, Paris répond
- - 1er JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : Paris ne "prête pas attention à nos exigences", estiment les talibans
- - 23 NOVEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Les familles et proches de Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière reçus à l’Elysée
- - 16 novembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Le président de la république se dit "moins inquiets" pour Hervé et Stéphane que pour les otages français au Mali
- - 25 OCTOBRE 2010 - 300 JOURS DEJA... HERVE ET STEPHANE, OTAGES EN AFGHANISTAN - LE CONCERT DE SOUTIEN DE FRANCE TELEVISION
- - OTAGES AFGHANISTAN : Angers solidaire des journalistes otages en Afghanistan
- - 29 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : 9 mois de captivité - Rassemblement à Paris devant France TV (video)
- - 25 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : « Il y a des fausses libérations et donc des fausses joies » - Une interview de Georges Malbrunot
- - 24 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Otages en Afghanistan : un espoir de libération avant Noël
- - 10 septembre 2010 : appel des musulmans de France pour libérer les journalistes otages
- - 28 août 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un nouvel espoir en une libération prochaine pour les familles
- - 18 août 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : CLAUDY LEBRETON, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES COTES D’ARMOR ET PRESIDENT l’Assemblée des Départements de France, ECRIT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
- - 6 mois de captivité : les manifestations de mobilisation en France
- - 28 JUIN 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : mobilisation pour les 6 mois de détention, à Chambéry
- - OTAGES AFGHANISTAN : 177e jour de captivité : les soutiens se multiplient
- - 22 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes otages : Hervé Morin et Patrick de Carolis à Kaboul
- - 17 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Montauban soutient les journalistes otages
- - 14 juin 2010 - OTAGES DU MONDE : interview de Marlène MARY, membre du Conseil d’Administration de l’association Otages du Monde et déléguée régionale en PACA
- - 3 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : quand reverront-ils la France ? Une émission de la chaine parlementaire en replay
- -
 28 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENTS 150 JOURS - LES PHOTOS - LES VIDEOS - REVUE DE PRESSE
28 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENTS 150 JOURS - LES PHOTOS - LES VIDEOS - REVUE DE PRESSE - - Vendredi 21 mai - OTAGES AFGHANISTAN : les actions du we (Bretagne)
- -
 28 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, leurs portraits affichés à Rennes
28 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, leurs portraits affichés à Rennes - -
 7 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : VILLE DE BAYEUX : une banderole sur l’hôtel de ville
7 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : VILLE DE BAYEUX : une banderole sur l’hôtel de ville - -
 29 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un rassemblement à Marseille pour Hérvé et Stéphane
29 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un rassemblement à Marseille pour Hérvé et Stéphane - - 16 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Des nouvelles de Stéphane et Hervé, otages en Afghanistan (Télérama)
- - 18 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Entretien JF Julliard (Reporters sans frontières)
- - 19 Février 2010 - Otages Afghanistan : Journalistes france tv : le SNJ veut voir Hervé Morin
- - 21 février 2010 - OTAGES AFGANISTAN : Réaction de RSF après les déclaration du général Georgelin sur le coût des opérations menées pour la libération des 2 journalistes de France TV
- - 25 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : pas de "communication sur le coût" des recherches (Défense)
- - 28 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : « On ne fait pas le minimum pour les otages d’Afghanistan » (Dans le Grand Entretien de RUE 89)
- - 29 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : nouveaux rassemblements de soutien en France pour les 2 reporters de France TV
- - 8 AVRIL 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : interview de Philippe Rochot sur RTL
- - 11 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Nouvelle vidéo des deux journalistes français otages en Afghanistan
- - 11 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : une video des deux otages de France TV sur internet (FRANCE INFO)
- - 12 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Otages français : les taliban veulent procéder à un échange
- - 13 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : "La médiatisation des otages ne fait qu’augmenter leur valeur marchande". Georges Malbrunot
- - 22 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Grands reporters otages : message chaque jeudi dans les JT de France 2 et France 3
- - 25 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : 116 jours de détention pour les 2 reporters de France TV (manifestation à Montpellier)
- - 5 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Afghanistan : les journalistes en Kapisa, selon Bernard Kouchner
- - 19 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Rassemblement à Strasbourg pour les journalistes français enlevés en Afghanistan
- - 25 MAI 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Action de soutien St Brieuc / Art Rock : revue de presse
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Saint-Brieuc : les confrères de Stéphane et Hervé étaient à St Brieuc pour les soutenir, accueilli par le maire de la ville (la video)
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Saint Brieuc /Festival Art Rock : Olivia Ruiz dédie son concert aux 2 otages de France Tv
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA VILLE DE SAINT BRIEUC ET DU FESTIVAL ART ROCK (LA VIDEO DE FRANCE 3)
- - 22 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : La ville de St Brieuc - Bretagne) soutient Hervé et Stéphane et affiche leur portrait
- - 20 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : HERVE ET STEPHANE - Interview L’HUMANITE : Stéphane Bern « Ils ne sont pas partis prendre des vacances en Afghanistan »
- - 20 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : La mairie de SAINT-BRIEUC (Bretagne) affiche le portrait de Stéphane et Hervé à la veille du festival ART ROCK
- - 16 mai 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Négociations "difficiles" sur les otages français en Afghanistan
- - 28 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : soutien de la mairie de Saint-Ouen
- - 29 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : L’un des journalistes otages enseigne au Mont-Houy (Valentiennes - LA VOIX DU NORD)
- - 17 avril 2010 : OTAGES AFGHANISTAN : Les familles des otages reçues par Sarkozy
- - AVRIL 2010 - LE GROUPE DIONYSOS SOUTIENT HERVE ET STEPHANE, OTAGES EN AFGHANISTAN
- - 22 avril 2010 - OTGES AFGHANISTAN : rappel de la prise d’otages des 2 reporters deFrance TV sur les chaines du groupe tous les jeudis (la video)
- - REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DES INTERNAUTES
- - 14 avril 2010 - CREATION D’UN COMITE DE SOUTIEN POUR HERVE ET STEPHANE
- - 12 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : France Tv devrait diffuser la video des otages ce soir
- - 12 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : le SNJ-CGT de France Télévisions est inquiet
- - 8 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Les dernières nouvelles seraient rassurantes. (Video BFM TV°
- - MANIFESTATION DU 8 AVRIL : LE REPORTAGE DE FRANCE 3 Interview de Paul Nahon
- - LES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN A HERVE ET STEPHANE- 8 AVRIL 2010 à PARIS
- - 8 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Rassemblement à Paris pour deux reporters otages en Afghanistan
- - 8 avril 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES AMIS DE STEPHANE ET HERVE
- - 29 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : MANFESTATION DE SOUTIEN A PARIS
- - 27 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Au FIGRA, un élan unanime pour ne pas oublier les journalistes de France 3 en Afghanistan
- - 29 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : NOUVELLE JOURNEE DE SOUTIEN A HERVE ET STEPHANE POJUR LE 90e JOUR DE PRISE D’OTAGE
- - 19 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : JOURNEE DE MOBILISATION DES CLUBS DE LA PRESSE POUR LES 2 REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN
- - 19 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Montpellier - 250 personnes pour soutenir les otages français retenus en Afghanistan
- - 19 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : NOUVELLE MOBILISATION A LILLE
- - 14 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Les journalistes otages en Afghanistan (Emission MEDIA LE MAG sur France 5)
- - 14 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : un reportage sur MEDIA LE MAG sur France 5
- - 9 mars 2010 - OTAGES AFGNANISTAN : rassemblement à Toulouse
- - 2 mars 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes enlevés : "preuves de vie très récentes", selon le SNJ
- - 9 mars 2010 - DES RASSEMBLEMENTS EN FRANCE POUR LE SOUTIEN AUX OTAGES EN AFGHANISTAN
- - SOUTIEN AUX JOURNALISTES OTAGES EN AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENTS DE SOUTIEN LE 9 MARS
- - 22 février 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Vives réactions après les propos du patron des armées sur le soût des otages
- - 22 février 2010 - Journalistes otages en Afghanistan : la polémique relancée sur le coût des recherches (L’express)
- - 16 févier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Questions médias : réflexion sur les otages journalistes (TELERAMA)
- - 28 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : près de 200 journalistes à Paris pour la liberté de la presse
- - 27 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes otages : message de Patrick de Carolis
- - 26 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN - LIBERTE DE LA PRESSE : manifestation de journalistes jeudi (Reporters sans Frontières)
- - 26 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Journalistes otages : la situation est “périlleuse”, selon Sarkozy
- - 20 janvier 2010 - POLEMIQUE JOURNALISTES - OTAGES : un communiqué de la SCAM (Société civile des auteurs multimedias) : une polémique indigne
- - 19 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : la chonique de Stéphane Guillon FRANCE INTER
- - 18 janvier 2010 - LES COMMUNIQUES EN REACTION AUX PROPOS DE L’ELYSEE CONCERNANT LES GRANDS-REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN
- - 15 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Arnaud Hamelin, Président de la Fédération française des agences de presse (et de l’agence Sunset Presse) publiait un communiqué en réaction aux propos présumés de Nicolas Sarkozy
- - 7 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : L ’UNESCO condamne les attaques contre des journalistes en Afghanistan
- - 7 janvier 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Otages France 3 : L’ire de Sarkozy - Les journalistes de la chaine choqués par les propos
- - 5 janvier 2010 - OTAGES FRANCAIS AFGHANISTAN : Nahon "optimiste" au sujet des journalistes français
- - 31 décembre 09 - OTAGES AFGHANISTAN : Deux journalistes de France Télévisions enlevés en Afghanistan
- - 31 décembre 09 - OTAGES AFGHANISTAN : Deux journalistes français enlevés en Afghanistan
-
 LES ACTIONS DE SOUTIEN
LES ACTIONS DE SOUTIEN
 LES ACTIONS DE SOUTIEN
LES ACTIONS DE SOUTIEN
-
 7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
 7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
7/8/9 août 2010 - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (BRETAGNE - MORBIHAN)
-
 AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
 AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
AOUT 2010 - LE SOUTIEN DU FESTIVAL D’AURILLAC - AUVERGNE (CANTAL)
-
 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES 2010 - CARHAIX BRETAGNE
- - 19 JUILLET 2010 - OTAGES DU MONDE : interview de Jonathan BOISSAY pour le site du festival des Vieilles Charrues
- - Jean-Philippe QUIGNON, co-président du festival, adresse un message de soutien aux otages
- - MERCI AUX ARTISTES !
- - Des festivaliers solidaires !
- - Toutes les photos des Vieilles Charrues !
- - 30 DECEMBRE 2010 - OTAGES AFHANISTAN : un an de captivité des 2 journalistes français ( Interview de Martine Gauffeny, Déléguée Générale OTAGES DU MONDE, sur France 3 Bretagne)
- - 30 JUIN 2011 -MOELAN SUR MER (BRETAGNE) LE CINEMA LE KERFANY FETE LA LIBERTION D’HERE ET STEPHANE
- - 26 JUIN 2011 - SOUTIEN AUX OTAGES DU MONDE au festival des Droits Humains de L’HAY les ROSES ( Val de Marne)
- - 29 JUIN 2011 : RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LA LIBÉRATION D’HERVÉ ET STÉPHANE
- - 27 JUIN 2011 - 18 MOIS DE CAPTIVITE POUR HERVE ET STEPHANE : Un exploit sportif en Picardie pour les otages du Monde
- - 11 JUIN 2011 - Nuit de la Photo à Orange
- - 12 MAI 2011 - 500 jours - MOELAN SUR MER (BRETAGNE - 29) : le coup de pouce aux otages du cinéma LE KERFANY
- - 13 mai 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : les manifestations parisiennes
- - 12 mai 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : 500 jours de captivité - le soutien de BAYEUX
- - 12 mai 2011 - Le coup de pouce aux otages de la ville de Saint-Brieuc et des briochins (22 - Bretagne)
- - 6 MAI 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : le soutien de RUTH SOUFFLER et SANDY SCORDO, championnes de Karaté
- - 28 AVRIL 2011 - "10.000 dessins d’enfants" pour la liberté de Ghesquière et Taponier
- - 24 février 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : soutien en Amérique centrale...
- - 10 février 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : mobilisation à MIRAMAS (13 - PROVENCE)
- - 2 FEVRIER 2011 - Rassemblement à Paris pour les 400 jours de captivité d’Hervé Guesquière et Stéphane Taponier
- - 28 JANVIER 2011 - PERNES LES FONTAINES : soutien des SUBARUS lors du passage du 14ème rallye Historique de Monte Carlo
- - HERVE ET STEPHANE : RASSEMBLEMENTS PREVUS EN FEVRIER-MARS
- - 11 JANVIER 2011 -OTAGES AFGHANISTAN : UN COMITE DE SOUTIEN CREE A L ASSEMBLEE NATIONALE
- - 7 JANVIER 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : A Avignon, soutien du Conseil Général
- - 29 DECEMBRE 2010 - 1 AN DE CAPTIVITE POUR HERVE ET STEPHANE : RASSEMBLEMENT A MARSEILLE
- - 29 décembre 2010 - 1 an déjà pour Hervé et Stéphane : les bretons se mobilisent à AURAY
- - 29 DECEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : ACTIONS DE SOUTIEN EN FRANCE le 29 décembre 2010 marquant l’année de détention d’Hervé Guesquière et de Stéphane Taponier
- - 25 DECEMBRE 2010 : OTAGES SAHEL ET AFGHANISTAN -REPORTAGE DE FRANCE BRETAGNE CE 25 DECEMBRE
- - 25 DECEMBRE 2010 - JOUR DE NOEL : SOUTIEN DES MONTAGNARDS AUX OTAGES
- - 23 DECEMBRE 2010 - OTAGES EN AFGHANISTAN : 80 000 SIGNATURES DE LA PETITION REMISES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
- - 14 DECEMBRE 2010 - MOELAN SUR MER (Bretagne - 29), la mairie et 32 COMMERCES AFFICHENT LES PORTRAITS D’HERVE ET STEPHANE !
- - 16 décembre 2010 - "UN DESSIN POUR LEUR LIBERTE" - PERN LES FONTAINES - (Vaucluse)
- - 16 décembre 2010 - MOELAN SUR MER - BRETAGNE (29) - OTAGES AFGHANISTAN : le soutien des sauveteurs en mer
- - 7 DECEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : RASSEMBLEMENT A LYON
- - 1er DECEMBRE 2010 - BAYEUX LANCE L’OPERATION "UN DESSIN POUR LEUR LIBERTE"
- - 14 décembre 2010 - SOIREE DE SOUTIEN A MOELAN SUR MER (29-BRETAGNE)
- - 24 NOVEMBRE 2010 - DES DESSINS D’ENFANTS POUR LES OTAGES EN AFGHANISTAN - Otages du Monde partenaire de cette action
- - 29 novembre 2010 -SOUTIEN HERVE ET STEPHANE - LILLE - Conférence- débat
- - 30 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DU MONDE DE LA VOILE A LA ROUTE DU RHUM
- - 22 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE PLOUBAZLANEC (22- BRETAGNE)
- - 25 OCT 2010 - UNE EMISSION SPECIALE SUR FRANCE E /RFI
- - 23 OCTOBRE 2010 OTAGES AFGHANISTAN - LILLE : La mobilisation s’amplifie en faveur de la libération des otages d’Afghanistan - La Voix du Nord
- - 22 OCTOBRE 2010 : OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE PLOUBAZLANEC (22- BRETAGNE)
- - 25 OCTOBRE 2010 - CONCERT DE SOUTIEN AU ZENITH
- - 8 OCTOBRE 2010 - PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANT DE GUERRE : rassemblement de soutien pour Hervé et Stéphane
- - 4 OCTOBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE PAIMPOL ( BRETAGNE - 22)
- - 16 SEPTEMBRE 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : soutien de la mairie de TOMBLAINE (Meurthe et Moselle)
- - 24 septembre 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : les associations de soutien reçues à l’Elysée
- - SUR LA BLOGOSPHERE...
- - 2 septembre 2010 - LE CONSEIL GENERAL DES COTES-D’ARMOR ELEVE LA BANDEROLLE DE SOUTIEN SUR SA FACADE
- - LA VILLE DE LANNION (22- BRETAGNE) AFFICHE LA BANDEROLLE DE SOUTIEN
- - 2 SEPTEMBRE 2010 - RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN A PARIS
- - STEPHANE ET HERVE : 250e JOUR DE DETENTION : RASSEMBLEMENT A PARIS
- - 23 AOUT 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : LES SOUTIENS BRETONS SE MULTIPLIENT
- - 21 MAI 2010 - FESTIVAL ART ROCK A SAINT BRIEUC (22 -BRETAGNE) : LE SOUTIEN D’OLIVIA RUIZ ET DE LA MAIRIE DE SAINT-BRIEUC
- - 1 AOUT 2010 - LA NUIT DE LA PHOTO - GUIDEL (56 - BRETAGNE)
- - 6 AU 8 AOUT 2010 - FESTIVAL DU BOUT DU MONDE - CROZON (29 - BRETAGNE) - SOUTIEN AUX 2 REPORTERS OTAGES EN AFGHANISTAN
- - VAUCLUSE - 11 JUILLET 2010 - 128 SUBARU ONT COURU POUR HERVE ET STEPHANE
- - 15 JUILLET 2010 - CONCERT DE SOUTIEN EN BRETAGNE ANNE VANDERLOVE, marraine de l’association, a chanté pour les otages du monde
- - 7 juin 2010 - OTAGES AFGHANISTAN : Bayeux soutient les otages d’Afghanistan
-
- - 28 février 2014 - Hervé Ghesquière raconte aux enfants sa vie d’otage en Afghanistan
- - 23 novembre 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : FRANCE 3 - EMISSION PIECES A CONVICTION "SPECIALE AFGHANISTAN"
- - 30 août 2011 - OTAGES AGHANISTAN : Stéphane Taponier - Retour sur terre après une vie d’otage
- - TOUTES LES PHOTOS, TOUTES LES VIDEOS SUR LA LIBERATION D’HERVE ET STEPHANE
- -
12 MAI 2011 - OTAGES AFGHANISTAN : LE SOUTIEN DES BRETONS, A MOELAN-SUR-MER
TEMOIGNAGES d’otages et de familles d’otages
 Témoignage de Jean-Louis Normandin, otage au Liban, Président d’OTAGES DU MONDE
Témoignage de Jean-Louis Normandin, otage au Liban, Président d’OTAGES DU MONDE
Le 8 mars 1986, 4 journalistes français sont enlevés à Beyrouth : Georges Hansen, Jean-Louis Normandin, Philippe Rochot et Aurel Cornea sont pris en otages au Liban par un groupe armé.Georges Hansen et Philippe Rochot sont libérés trois mois plus tard en juin 86. Puis, c’est au tour d’Aurel Cornea à noël 86. Jean-Louis Normandin quant à lui reste prisonnier jusqu’au 27 novembre 1987, date où il est enfin libéré avec Roger Auques.
Entre 1982 et 1991, plus de 150 rapts d’occidentaux ont lieu au Liban par une trentaine de groupes révolutionnaires. Parmi les otages, 10 trouvent la mort en captivité dont Michel Seurat, chercheur au CNRS, exécuté fin 85 ou début 86.

Jean-Louis Normandin retourne, pour la première fois, sur les lieux de son enlévement pour Complément d’enquête, de France 2.
Voir la video sur France 2 - Un reportage de Joël Bruandet & Vincent Bouffartigue.
- Lire aussi l’interview de Jean-Louis Normandin dans PARIS MATCH Le jour où...
J’ai tenu tête à mes ravisseurs. Par Jean-Louis Normandin.
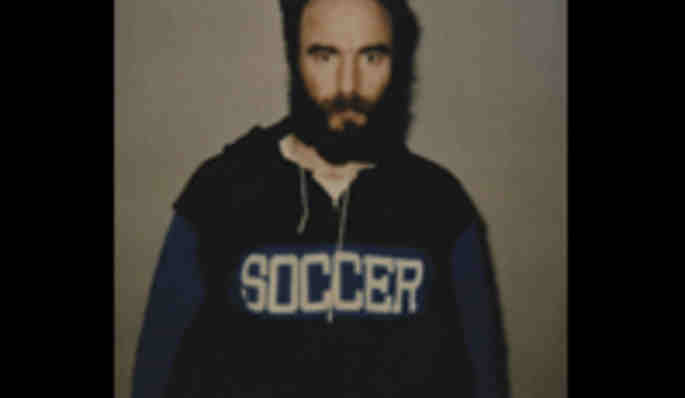
Le 8 mars 1986, je suis enlevé au Liban avec trois collègues d’Antenne. 2. 628 jours coupé du monde, entièrement à la merci de mes geôliers. Pourtant, un jour, face à un de leurs caprices, j’ai dit « non ». Tout a changé. Un grain de sable pouvait gripper le mécanisme infernal de la détention.
Julien Jouanneau - Parismatch.com -actu-match | Mardi 13 Janvier 2009
Dès le premier jour de l’enlèvement, notre univers avec Philippe Rochot, Georges Hansen et Aurel Cornea se limite à une chaîne et quatre murs. Les journées sont rythmées par trois visites aux toilettes, seuls moments où nous sommes désentravés. Quelques lueurs s’infiltrent par les interstices de la porte et une armada de sons extérieurs nous parviennent, souvent menaçants : déflagration d’obus, impacts de balles contre le mur, le vacarme des chars qui rasent et font frémir notre geôle. Les explosions me glacent le sang. Puis règne le silence. Le casting de nos ravisseurs cagoulés est si éclectique que nous leur affublons entre nous des surnoms : « Mister Goodfood », celui qui nous conseille de bien manger, « Nevermind », celui qui ne nous écoute pas, ou « Bimbo », celui qui s’assoit et tripote des jouets pendant des heures, comme un gosse, avec un kalachnikov à ses côtés. Certains n’ont pas de surnom car ils sont littéralement bêtes et méchants : les plus dangereux.Je conserve étonnamment la notion du temps : je sais qu’on est déjà en juin 1986. Georges et Philippe ont été déplacés il y a quelques jours, je ne sais où. Un après-midi, je tire vigoureusement sur ma chaîne de bagnard de 2 mètres, attachée à un radiateur fixé au mur, et je parviens à coller l’oreille sur la porte. Je risque de me faire surprendre. Je discerne des cris, les exclamations typiques d’un... match de foot. Le quart de finale de la Coupe du monde, entre la France et le Brésil, à la télé ! Je perçois une voix distincte, celle de Jacques Chirac ! Le Premier ministre annonce la libération de Rochot et Hansen ! Je reste bouche bée, le front contre la porte. Jamais je ne les aurais imaginés libres. L’espoir ne meurt donc pas. Cette délivrance confirme que nos ravisseurs ne sont que de purs menteurs, guidés par la volonté perverse de désinformer. Mais l’idée d’évasion nous apparaît trop compliquée, voire suicidaire. Difficile de tuer des militaires armés alors qu’on a perdu une dizaine de kilos, puis d’errer barbus en pyjama dans les rues d’un quartier qui nous est inconnu. Mieux vaut ne pas risquer une exécution, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes.
Mars 1987, Aurel est libre depuis trois mois. Je me retrouve avec deux compagnons d’infortune américains. J’imagine sans cesse la manière dont je vais mourir. Résultat, je n’ai plus aucun rapport à la réalité, la sensation de néant perdure et je m’interdis toute émotion. Je me transforme en une espèce de sous-marin, où je peux enfouir tous mes sentiments et mes souvenirs pour réussir à survivre. Le plus pénible est de sauvegarder ma santé mentale. Nos ravisseurs jouent avec nos nerfs : ils se relaient de façon irrégulière, par équipes de trois ou quatre, et je dois recommencer le processus d’« apprivoisement » avec chaque nouvelle équipe. Dissimulés par leur cagoule qui ne laisse entrevoir que leurs yeux et leurs lèvres, ils finissent par oublier les principes mêmes d’humanité. Ainsi, l’un d’eux veut, pour s’amuser, nous faire faire du sport. Il intime l’ordre à un des deux Américains, 60 ans, enchaîné et épuisé, d’effectuer des pompes. Je reste debout, le regard fixe. L’homme cagoulé claque des doigts pour me signifier « couche-toi ». Sous le coup de la colère, je lui rétorque en français : « Non, je ne me couche pas, et si tu veux, tu tires, fais ce que tu veux, mais je ne me couche pas. Tu n’as qu’à tirer. » Je l’affronte les yeux dans les yeux. Déconcerté, il se crispe et tourne les talons. En situation normale, je serais incapable de dire ça. Mais le désespoir et la dignité façonnent la détermination. Plusieurs minutes défilent. Je suis susceptible de recevoir une rafale en plein crâne. Un brouhaha émerge derrière la porte. Elle s’ouvre. Quatre ou cinq ravisseurs pénètrent et me font face, kalachnikov à la main. Ce sont visiblement des chefs. Je crois mon heure sonnée. Mais une discussion s’engage, qui dure trente minutes. Je réponds et explique que je n’admets pas un tel comportement, mais que je les respecte. Je reste ferme, leur rappelle que je ne fais pas de crise de nerfs, que je ne tombe jamais malade et que je suis, si l’on peut dire, un otage modèle. Mais qui a droit à son périmètre. Tout change : je deviens un interlocuteur, le « leader syndical » de notre groupe. J’instaure une espèce de contrat de confiance. Ce ne sera qu’un grain de sable dans le mécanisme infernal de ma détention, mais c’est lui qui va me permettre de tenir pendant les huit mois qui me restent à « tirer ». Dans les moments de silence, je m’imagine réfugié dans une maison sur une île, comme un retour en moi. Après ma libération, en novembre 1987, je finis par habiter sur l’île aux Moines. Personne ne peut prendre les rêves en otages.
Agé de 56 ans, Jean-Louis Normandin est rédacteur en chef adjoint à France 2. Il est retourné sur les lieux de son enlèvement pour la première fois en 1996 avec son fils Antoine. Il est le vice-président d’Otages du monde (www.otages-du-monde.com ), qui entend sensibiliser le public à la situation des prises d’otages, et aider les otages libérés et leurs familles.


